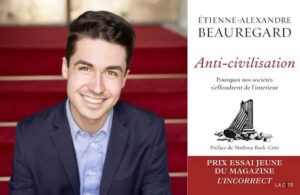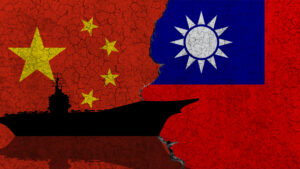La diplomatie suisse déboussolée

Ignazio Cassis accueilli par Volodymyr Zelensky lors de sa visite à Kyiv, en octobre 2022. – © X/©ignaziocassis
L’ex-diplomate valaisan Georges Martin, autrefois dans les hautes sphères du DFAE, a mis les pieds dans le plat. Lors de l’émission de radio «Les Beaux Parleurs», à l’occasion de la sortie de son livre au titre un brin pompeux – Une vie au service de la Suisse. Il a tranquillement déclaré, en substance, que notre diplomatie ne sait plus où elle va. La «conférence de la paix» annoncée à Davos par le chef du Département, fixée à fin mars, se présente mal. Elle ne sera, selon Martin, qu’un raout de plus du «fan-club de Zelensky», ignoré d’ailleurs par les Etats-Unis. Du côté de la Chine, de l’Inde et bien d’autres, malgré visites et courbettes, c’est l’indifférence polie. Prétendre chercher une voie de paix en ignorant l’une des parties au conflit, sur la base du programme d’un seul camp, c’est absurde. Pire, une tromperie sur les mots.
Il manque une tête pensante au sommet. Une direction froide, réaliste, qui ne laisse pas flotter la politique au vent des émotions collectives, qui montent et descendent, changent parfois de direction. Lorsque l’action diplomatique se mène à coups de communication, dans le souci de la popularité immédiate, sans la moindre discrétion, sans contacts secrets, elle perd toute crédibilité. M. Cassis devrait apprendre à tenir sa langue. Et s’il veut partager ses partis-pris, le faire dans les codes d’un métier dont il ignore manifestement les bases.
Exemple de la politique menée au coup de sang. Le Conseil fédéral mijote une un texte «interdisant le Hamas». Qui ne s’est jamais manifesté en Suisse. Cette gesticulation juridique ne changera pas un iota à la situation au Moyen-Orient. Mais cela coupera tout espoir de voir un jour notre diplomatie proposer ses services pour tenter un accord sur ce terrain. Certes elle était déjà mal partie avant cette mesure. On aurait pu cependant réserver l’avenir. Quand on songe qu’en 2010, du temps de Micheline Calmy-Rey, le DFAE invitait de hauts dirigeants du même Hamas, notamment à Einsiedeln où ils rencontrèrent un abbé, cela dans une louable tentative de leur faire préférer la voie politique à celle du terrorisme, on mesure l’ampleur du changement de cap.
Sur le versant de la défense, à portée hautement politique aussi, là, c’est la pataugeoire. Depuis son accession à cette responsabilité la conseillère fédérale mène le département avec une petite équipe de proches, avec une obsession, se rapprocher le plus possible de l’OTAN. Multipliant les visites auprès des chefs du club atlantiste. Fermant les yeux sur les pratiques irrégulières de Ruag, vivement dénoncées ces jours par la commission des finances et nombre de parlementaires. A propos de 94 blindés Leopard achetés à l’Italie, où ils se trouvent encore, sur un terrain loué à prix faramineux. Promis, sans accord du Conseil fédéral, à l’Allemagne soit-disant pour remplacer ceux qu’elle livre à l’Ukraine. Cela sur fond d’une opacité budgétaire dans l’armée, non moins vivement critiquée au Parlement.
Il est piquant de constater comment la maison est dirigée. Dans l’entre-soi. Viola Amherd a confié les rennes de Ruag à une amie, sans expérience du domaine, Brigitte Beck. Qui a dû démissionner l’an passé. Et la présidence du conseil à Nicolas Perrin, beau-frère de la plus proche conseillère de la conseillère fédérale, Brigitte Hauser-Süess, qui lui aussi vient d’annoncer son départ. Pour ne pas nuire à la réputation de l’entreprise, a-t-on dit. Ou plutôt celle de la patronne qui prétend n’avoir rien su des manigances de cette belle équipe, à deux pas de son bureau.
Sur le fond, les turbulences autour du DFAE et du DDPS posent en filigrane la question de la neutralité, agitée surtout par l’UDC. Ce concept élastique, aux infinies interprétations, finit par tout embrouiller. C’est une autre exigence qu’il convient de faire valoir: la défense des intérêts du pays. Priorité pour les militaires comme pour les diplomates.
Demandons-nous donc ce qui vaut mieux pour la Suisse, sur le temps long. Devenir un satellite, même grognon à l’occasion, de l’Alliance atlantique? En devenir un membre un jour? Nous ancrer exclusivement dans cet «Occident» dont d’immenses pans du monde se distancent? Ou trouver son chemin propre, comme autrefois? Le champ de nos intérêts est large. La sécurité bien sûr, mais aussi le commerce, l’espace académique et la recherche, la vie sociale avec des communautés diverses en notre sein.
Baliser notre carte du monde en étiquetant les pays comme fréquentables ou pas? Les bons et les méchants, les démocraties et les dictatures? Attention, à ce jeu on s’empêtre vite dans les contradictions. Sanctions à tout va pour la Russie qui a agressé l’Ukraine, aucune pour Israël qui occupe durablement et violemment des territoires qui ne sont pas les siens. Battre froid la Chine comme on nous le demande et courtiser l’Arabie saoudite guère plus respectueuses des droits de l’homme. Prendre les Etats-Unis comme modèle universel de démocratie alors que leur système donne actuellement un si piètre visage? Brandir nos «valeurs», de tolérance notamment, pour condamner les sociétés qui ne les partagent pas? Là, il y a un bug.
Et que l’on ne vienne pas objecter que le rapprochement avec l’Union européenne nous dictera la voie. En politique étrangère, elle est beaucoup plus diverse que ne le dit sa présidente mégalomane. Ce club compte aussi des pays neutres… et des rebelles d’occasion. Voyez l’Espagne à propos de la guerre de Gaza. Les opinions publiques sont loin de voir les événements actuels à travers les mêmes lunettes. Voyez les Polonais qui entrent en bisbille avec l’Ukraine jusqu’à bloquer parfois le trafic frontalier.
L’approche moralisatrice, en politique internationale ne mène qu’à l’isolement. A l’impuissance dans nos efforts de paix. A l’abandon de nos intérêts bien concrets. Il est temps de définir nos repères avec franchise, avec hauteur de vues.
Enfin n’allons pas non plus nous gargariser du terme de souveraineté. Elle n’est absolue pour personne. Un autre notion paraît préférable: la dignité. Opposée à la soumission, à la vision imposée par les puissants, au conformisme induit par l’émotion dominante du moment.
À lire aussi