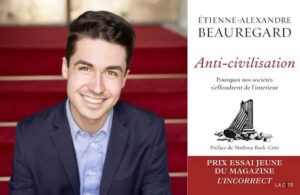La clé de la Mer Noire a été conçue à Montreux en 1936. Pour s’approcher de l’Ukraine, les USA veulent la réviser

CC via Wikimedia Commons
Dans le climat instable de l’entre-deux-guerres, plusieurs puissances souhaitaient un tel accord: l’Australie, la Bulgarie, la France, l’Allemagne, la Grèce, le Japon, la Roumanie, l’Union soviétique, la Grande-Bretagne et la Yougoslavie. L’Italie fasciste n’en était pas et les Etats-Unis n’envoyèrent même pas des observateurs.
La norme s’appliquait néanmoins et s’applique encore à tous les pays. La Turquie y tient. C’est elle qui laisse passer ou pas les bateaux. Les navires de commerce ont un accès libre, sans paiement de péages, sous réserve cependant d’une limite de tonnage. Tout comme les bâtiments militaires des pays non côtiers. Ceux-ci sont à l’obligation d’annoncer leur passage à la Turquie six jours avant. Leur nombre simultané est aussi restreint, neuf au maximum, et pour une durée maximale de 21 jours. Les porte-avions et les sous-marins ne sont pas admis à franchir les détroits. Ces dernières années, il y eut pourtant des exceptions, en faveur de la Russie, qui invoquait des raisons de maintenance, prévues dans les textes. Ce qui a fort irrité les Américains qui souhaitent envoyer sans entraves leur armada devant les rivages russes et ukrainiens. D’où la tentation des Etats-Unis, forte depuis janvier 2022, d’exiger la révision de la convention de Montreux… dont ils ne sont pas signataires mais dont ils subissent les effets. Ce qui ne plaît guère à la Turquie: elle souhaite rester neutre dans le conflit entre l’Occident et la Russie. Paradoxalement cette dernière voudrait bien, elle aussi, que l’accord international soit revu et assoupli en sa faveur. L’accès de ses navires armés de la Mer Noire vers la Méditerranée est pour elle une priorité stratégique.
Le sujet est âprement discuté à Ankara, pour une raison plus économique que militaire. Car le gouvernement Erdogan a le projet de creuser un nouveau canal, près d’Istanbul, pour alléger et accroître le transit. Il a été question de ne pas lui appliquer la convention de Montreux afin de percevoir des péages, comme c’est le cas de Suez, grâce à quoi l’Egypte encaisse des milliards. Mais d’ici à ce que ce passage soit en service, il se passera bien des années, et la situation intérieure comme extérieure peut réserver bien des surprises.
Reste qu’aujourd’hui, le pouvoir d’Erdogan est à la fois considérable et embarrassant. S’il décide de laisser passer les grosses unités armées, il devra le faire à la faveur des Etats-Unis et de la Russie… qui redoute pour des raisons politiques de voir les porte-avions US géants au large de ses côtes. Bien que l’enjeu militaire soit restreint: les forces américaines ont tous les moyens d’atteindre n’importe quelle cible à distance, depuis bien plus loin. Le rôle de la Turquie aujourd’hui, qui condamne l’invasion de l’Ukraine, qui a fourni à celle-ci des drones armés, n’est pas encore clair.
Ces derniers mois, plusieurs navires de guerre russes et même un sous-marin, contrairement à la convention, ont rejoint la Mer Noire depuis la Méditerranée. Certains se trouvent depuis l’attaque du 24 février devant Odessa où des explosions ont eu lieu, où l’électricité est en partie coupée, comme le réseau téléphonique.
Le contrôle de cette mer, ainsi que de la mer d’Azov qui la jouxte, est une priorité stratégique historique de la Russie. Convention de Montreux ou pas.
À lire aussi