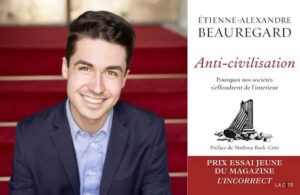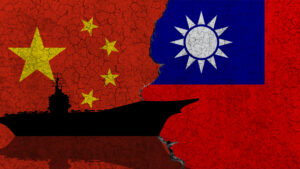A coups de diplomatie et de canon, la Turquie tisse sa toile sur l’ex-Empire ottoman

Recep Tayyip Erdogan estime que la Turquie devrait avoir une place privilégiée dans la nouvelle gouvernance du monde. – © DR
La Turquie essaye de minimiser son rôle dans le renversement spectaculaire de Bachar el-Assad. Mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir. En 2016, après la bataille d’Alep gagnée par les forces loyalistes à Assad épaulées par la Russie et le Hezbollah libanais, les islamistes du HTS se réfugièrent dans le coin nord-ouest de la Syrie, à Idlib. La seule voie d’approvisionnement était à travers la Turquie. Celle-ci, soucieuse d’endiguer l’arrivée de réfugiés syriens, favorisa l’acheminement d’aide humanitaire depuis son territoire. Elle y déploya aussi quelques unités militaires. On vit défiler des experts occidentaux qui s’employèrent à transfigurer le terroriste Abou Mohammed al-Joulani, décrété ainsi par Washington, en combattant de la liberté façon Che Guevara sans cigare. Pendant ce temps, la milice islamiste, qui compterait 30’000 soldats, était entraînée et équipée. On devine par qui. Le 12 décembre, à peine quatre jours après la chute d’Assad, Ibrahim Kalin, le puissant chef des services secrets turcs, priait à la mosquée des Omeyyades de Damas. Tout un symbole. Construite au début du VIIIe siècle, ce joyau architectural abrite les reliques de Saint-Jean Baptiste. Juste à côté se trouve le tombeau de Saladin, celui qui chassa les croisés de Jérusalem en 1187.
La plume et le canon
La prise de Damas par leurs alliés du HTS est un succès majeur pour les Turcs. L’étape suivante sera d’évincer les milices kurdes associées au PKK turc du nord-est de la Syrie où elles bénéficient de la protection américaine et des ressources pétrolières syriennes, capturées en 2016.
La Turquie, malgré ses difficultés économiques – inflation chronique de 50 à 75%, déficit budgétaire à plus de 5% du PIB, dépendance face aux hydrocarbures russes – n’hésite pas à investir dans ce qu’elle considère être l’intérêt supérieur de la nation. Elle a développé massivement son industrie de défense au cours des dix dernières années. Ses exportations d’armes ont augmenté de 25% en 2023. Mais Ankara investit aussi dans sa diplomatie. L’alliance de la plume et du canon dans la projection de l’influence turque dans le monde n’aurait pu être mieux illustrée qu’au début de la guerre en Ukraine. En 2022, alors qu’il menait une médiation entre Poutine et Zelensky, Erdogan refilait des drones à l’Ukraine. Et ce Président d’un pays membre de l’OTAN encaissait vingt milliards de Moscou pour une concession afin de construire et d’exploiter une centrale nucléaire sur la côte méditerranéenne. L’Oncle Sam fronce les sourcils, bien sûr. Mais la position géostratégique de cet allié compense largement sa turbulence. Ou encore: alors que ses alliés du HTS célébraient leur victoire à Damas, le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, rencontrait au Qatar les deux puissances défaites, la Russie et l’Iran. Dans l’esprit turc, il n’y a pas de contradiction, il n’y a que des intérêts. Ankara a battu ses deux puissants voisins sur le sol syrien, mais tient à entretenir de bonnes relations avec eux. Puissance militaire et puissance diplomatique constituent deux vecteurs de l’influence turque dans le monde. Où celle-ci commence-t-elle? Où s’arrête-t-elle ? Quels sont les ressorts qui animent Erdogan et ses troupes?
«The world is bigger than five»
En 2021, le Président turc a publié un livre intitulé «The world is bigger than five» qui est un plaidoyer pour une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu’il reflète la diversité culturelle, religieuse et géographique d’un monde devenu multipolaire. Même s’il ne le dit pas, il est évident que Recep Tayyip Erdogan estime que la Turquie devrait avoir une place privilégiée dans la nouvelle gouvernance du monde qu’il appelle de ses vœux. A cheval entre deux continents, héritière d’un empire multiculturel allant du cœur de l’Europe à l’Océan indien, capitale du monde musulman pendant des siècles, la Turquie veut se débarrasser de la tutelle américaine imposée après les deux guerres mondiales. Elle veut jouer sa propre partition et estime avoir vocation à un rôle global. Napoléon n’aurait-il pas dit que si le monde était un Etat, Istanbul serait sa capitale?
La question kurde en tête des priorités
Pour réaliser ses rêves de grandeur, il faut commencer sur le pas de sa porte. La priorité des priorités turques, c’est la question kurde. Attention: Ankara nie l’existence d’un problème kurde. Le problème, c’est le PKK, une organisation terroriste d’inspiration bolchévique selon la Turquie, qui poursuit un combat séparatiste depuis la Syrie où elle s’appelle YPG et bénéficie du soutien américain. L’offensive lancée par HTS le 27 novembre a été accompagnée d’une autre offensive, vers l’est, le long de la frontière turco-syrienne celle-là, afin de créer une zone tampon de 30 kilomètres libre de forces kurdes à l’intérieur de la Syrie. Les Américains sont intervenus diplomatiquement pour stopper l’avancée des forces affiliées à Ankara, dénommées «Armée nationale syrienne», alors qu’elles avaient déjà franchi l’Euphrate. Erdogan peut envisager de négocier en position de force après sa victoire à Damas et alors que Trump arrive à la Maison-Blanche, lui qui a annoncé vouloir retirer les 900 ou 1000 soldats américains qui restent en Syrie. Mais peut-être la Turquie préférera-t-elle finir le job avant l’investiture de l’imprévisible macho à la mèche blonde?
La diplomatie turque sur tous les fronts
La politique extérieure de la Turquie n’a pas qu’une orientation géographique. Elle agit tous azimuts, à 360 degrés. On a parlé de la Syrie. On n’a pas dit que la normalisation dans cette partie du Proche-Orient pourrait mener à la construction d’un pipeline depuis le Qatar jusqu’en Europe. A travers la Turquie. Que la paix en Ukraine pourrait aussi faire de l’ouest du pays un hub pour les hydrocarbures russes. Du conflit israélo-palestinien («Gaza, c’est Adana», a martelé Erdogan, rappelant le destin ottoman commun des deux villes) aux confins de la Chine (les Ouighours sont considérés par les Turcs comme des cousins) en passant par la Méditerranée orientale, les Balkans, le Caucase ou encore l’Asie centrale et même, on vient de le voir avec l’accord Ethiopie-Somalie signé à Ankara le 11 décembre, l’Afrique, la diplomatie turque donne le tournis. Exemple symbolique: la Chine. Loin des inefficaces incantations occidentales sur le génocide ouïghoure, Hakan Fidan a pris la peine, lui, de visiter en juin 2024 la région autonome ouïghoure du Xinjiang chinois, une première pour un ministre d’un pays membre de l’OTAN. Pékin veut cajoler Ankara, étape de choix pour les nouvelles routes de la soie comme Istanbul le fut pour les anciennes. Les Chinois comprennent l’influence turque sur ces lointains cousins occupant ce qui s’appelait une fois le «Turkestan Chinois».
Un triumvirat de choc
Dans sa quête de renaissance, la Turquie d’Erdogan peut s’appuyer sur un triumvirat d’hommes forts, animés des mêmes pulsions: une spiritualité profonde ancrée dans une mouvance soufie et le désir irrépressible de renouer avec le passé ottoman du pays. Hakan Fidan, ministre des affaires étrangères après avoir passé dix ans à la tête des services secrets, Ibrahim Kalin, successeur de Fidan aux services après avoir conseillé Erdogan, et Erdogan lui-même accumulent davantage d’expérience qu’aucun de leurs collègues occidentaux. Leurs valeurs religieuses sont un fioul au moins aussi puissant que les valeurs woke prédominantes chez leurs homologues européens. Surtout, ils ont un avantage crucial sur ceux-ci: ils s’offrent le luxe de la patience stratégique.
À lire aussi