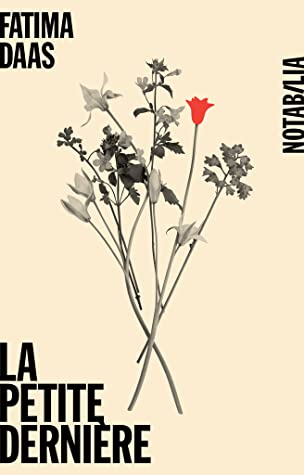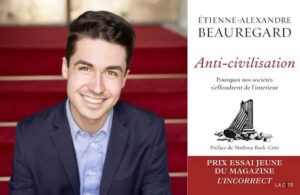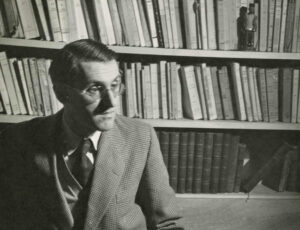Moi, Fatima, lesbienne, musulmane, normale
Fatima Daas. – © Olivier Roller
Le «droit à la différence» restera comme la grande illusion antiraciste. Il n’y a pas de droit à la différence, il y a un droit à être. «La petite dernière» en apporte une énième et originale confirmation. Ce roman autofictionnel raconte la trajectoire de Fatima Daas (auteure et narratrice partagent le même pseudonyme), une jeune femme aujourd’hui âgée de 25 ans, née en France de parents venus d’Algérie, ayant grandi et vivant à Clichy-sous-Bois, localité de Seine-Saint-Denis connue comme étant le point de départ des émeutes de banlieues de 2005 et le décor des «Misérables», le film césarisé de Ladj Ly.
Engagée, dit-elle en interview, dans l’intersectionnalité, ce courant anglo-saxon opposé à l’universalisme «à la française», Fatima Daas n’en livre pas moins une histoire inscrite dans ce qu’elle réprouverait, sans doute, en tant que militante. L’avantage du roman sur le militantisme, c’est qu’il ne ment pas. Il dissimule, mais il ne ment pas. Ecrire sur soi, c’est en découdre avec sa condition.
«Pas de ça chez nous»
Fatima Daas ne pouvait pas être lesbienne. Impossible. Impensable. En cause, le poids, le fameux poids de la tradition, le machisme ambiant, le «pas de ça chez nous», nous les musulmans. Ces données préemballées qui font les vérités et les préjugés à la fois. Si la dimension culturaliste est bien présente dans cet environnement normé, le propos du roman, émancipateur, est, lui, universel.
Ils sont cinq: le papa et la maman, les trois sœurs. Fatima est «la petite dernière». Ahmed, le père, pantin autoritaire, aurait voulu que sa benjamine fût un fils. Kamar, la mère, femme au foyer, l’impuissance faite abnégation, s’emploie à transformer ce don du ciel en vraie fille, qui aimera le rose et qui se mariera. Elle a des goûts masculins, Fatima. Dans le quartier, elle donne le change. Au point d’humilier un jour un garçon efféminé – la fille garçonne, ça passe, parfois c’est même un drôle d’atout, le gars pas gars, en revanche… Homophobe, Fatima. Pas fière. Pas bien dans sa peau. Asthmatique, elle effectue des séjours à l’hôpital, lesbienne empêchée, elle voit une psy.
Le temps passe, l’adolescente s’enhardit, tend des perches. A des proches, à sa mère. Va voir des imams. Elle leur parle à la troisième personne de son goût pour les filles. Se fait passer pour une autre. Elle teste son monde. Les réactions? Paternalistes, douces, pudiques, entendues. On évite le réalisme maghrébin de la dureté. C’est l’un des intérêts de ce livre organisant les non-dits à propos d’un non-dit. L’esquive plutôt que les pieds dans le plat. Pas de grosse huile qui tache. Le seul à l’«ouest», c’est ce père en sa pantomime de l’ordre, paradoxalement le personnage suscitant la plus grande émotion. Il croit commander à tout, il ne maîtrise rien. On dirait du Kechiche, le cinéaste.
Fatima, un pied dans l’interdit, un autre en Occident, connaît ses premiers émois. Elle culpabilise, c’est péché. Jusqu’à quel point ce «péché» ne sublime-t-il pas le rejet de son homosexualité, autrement dit son acceptation au prix de la pénitence? On peut le supposer et cela ne serait pas chose exceptionnelle.
Une affirmation de soi par étapes
Fatima est «musulmane». «Je m’appelle Fatima. Je suis musulmane.» L’auteure mouline habilement l’anaphore du début à la fin. De très brefs chapitres, tout en progression dramaturgique, une affirmation de soi par étapes, par acquis. Et une identité musulmane qui se veut sinon centrale, du moins constitutive. Ce martèlement s’adresse au lecteur autant qu’à Fatima. «Je suis musulmane» sonne moins comme une certitude que comme un tentative de persuasion: je suis lesbienne et je peux être musulmane; je suis musulmane et je peux être lesbienne. Certainement cette insistance religieuse a-t-elle un petit parfum subversif, alors que l’islam nourrit çà et là de l’inquiétude et de l’hostilité.
L’on comprend que l’«islam» est ici le compromis identitaire permettant le passage de la société des origines à la société d’accueil. Le legs dans la grande traversée imaginaire de la jeune femme. Ainsi la «trahison» n’est-elle pas totale. Née en France, pays de l’ancien colon, la deuxième génération de l’immigration maghrébine, percluse de dilemmes, a, dans l’ensemble, fait de l’islam un refuge autant qu’un moyen de payer sa dette aux parents. L’islam peut donc être en son sein un mot pour un autre.
D’une écriture tenue, tendue, plaisante, où la forme correspond au fond, «La petite dernière» donne aussi peu que possible dans un genre qui serait étiqueté «banlieue». Les moments les plus forts sont pour notre part ceux qui l’unissent à sa famille.
Ce roman d’amour comporte un enseignement dont l’antiracisme – pardon d’insister – ferait bien de tenir compte. Oui, le racisme existe et le pire qu’il puisse produire est la mésestime de soi. Mais ce que montre ce livre, qui s’ajoute à d’autres récits en lien avec l’immigration, c’est qu’on ne s’émancipe jamais que des siens, des pesanteurs de son milieu. Le «système», si souvent conspué par les extrêmes, est le garant de la liberté de mœurs.
Alors, pourquoi, chez certains, ce ressentiment persistant et venant de loin à l’égard du pays d’accueil, la France en l’occurrence? Parce que l’universalisme, sur la défensive, n’intègre pas assez, mais aussi, pour ne pas se sentir redevable au pays jugé coupable du sort des parents, vus comme des personnes vulnérables ballotées par l’histoire. «La petite dernière» peut par moments donner du grain à moudre à cette vision, mais chez l’auteure et narratrice, le pli de la normalité française est trop marqué pour donner au ressentiment plus de poids qu’il n’en a. Fatima, smalltown girl.
Fatima Daas, «La petite dernière», Editions Noir sur Blanc, 187 pages.
À lire aussi