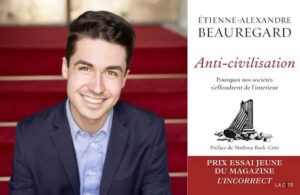Groenland, indépendance et développement touristique: aubaine ou catastrophe?
Ilulisat: vue de la ville depuis un brise-glace. – © Cécile Wyler
Les résultats des élections parlementaires du 11 mars sont clairs: les Groenlandais ne veulent plus être soumis à la souveraineté danoise et encore moins devenir le 51e Etat américain. Devenir indépendants n’ira cependant pas sans poser de sérieux problèmes.
Colonie danoise, devenue territoire autonome en 1979, le Groenland ou Kalaallit Nunaat (Terre du Peuple) comme l’appellent les Inuits, est un territoire cinquante fois grand comme la Suisse. Une bonne partie de ses 57 000 habitants (l’équivalent de la ville de Bienne) vivent dans des petites localités que l’on n’atteint que par avion ou bateau, le réseau routier du pays – climat et montagnes obligent – ne dépassant pas 160 km.
Très attachés à leur culture et à leurs traditions, les Inuits, un peuple de chasseurs-pêcheurs, n’ont pas oublié les traitements violents dont ils ont été victimes encore récemment. Nuna, la tante de mon guide raconte: «Dans les années 1960, le Danemark voulait réduire le taux de natalité des Inuits. Des milliers de femmes, dont ma mère le lendemain de ma naissance, se sont fait implanter un stérilet sans qu’elles n’en soient informées. Enfant, j’ai vécu à Copenhague, «adoptée» de force par une famille danoise, et pendant 8 ans je n’ai eu aucun contact avec ma famille. J’ignorais même que j’étais Inuit. Quand j’ai enfin pu rentrer au Groenland, il m’a fallu apprendre ma propre langue, que je parle encore aujourd’hui avec un petit accent danois!»
Je t’aime, moi non plus
Les discriminations envers les Inuits sont loin d’avoir disparues, ce qui explique l’ambivalence de nombre d’habitants qui, d’un côté souhaitent ardemment l’indépendance, mais d’un autre sont conscients que leur pays dépend des subventions danoises et craignent d’avoir à renoncer aux prestations sociales qu’offre le Danemark qui, soit dit en passant, s’est très généreusement servi des ressources naturelles du Groenland, sans grande contrepartie.
Comme le précise Aaja Chemnitz, une des deux représentantes des Inuits au Parlement danois et présidente du Comité du Groenland: «Les subventions que nous touchons couvrent quelque 60 % de nos dépenses publiques et être indépendants implique qu’il nous faille trouver de quoi remplacer ces subventions et plus encore.»
Plus encore? Oui, parce que le pays manque d’infrastructures. Aux yeux des Groenlandais, le Danemark a toujours traité sa province arctique avec un certain mépris et, donc, nombre de villages n’ont pas accès à des installations basiques tels qu’électricité ou égouts. Il manque notamment des écoles et des hôpitaux, et celles et ceux qui souhaitent poursuivre des études doivent se rendre à l’étranger.
Conséquence: le personnel des dispensaires et hôpitaux, tout comme les enseignants, sont majoritairement des «expats» danois. Les constructions (logements, ports, aéroports) restent confiées à des entreprises étrangères, réalisées avec du personnel étranger, et les Inuits se sentent spectateurs d’une croissance qui leur échappe et leur coûte cher.
Moins bien payés que les «expats», les Inuits n’ont souvent plus les moyens de se loger à Nuuk (la capitale), Sisimuit ou Ilulissat, les trois petites villes du pays, dans lesquelles les chances de trouver du travail sont meilleures, car le coût des logements a explosé, tout comme le prix de la nourriture et des services, ce qui forcent de plus en plus d’habitants à se nourrir de «fast food», meilleur marché mais source de maladies.
Le prix de l’indépendance
«Etre indépendant ne va pas être facile mais je m’en fiche!», affirme Jan Cortsen. «J’en ai marre d’être un citoyen de seconde zone dans mon propre pays!» Né en 1978 à Ilulissat (3e ville du pays avec quelque 5000 habitants), il poursuit: «Ma mère avait 15 ans à ma naissance et travaillait dans une usine de transformation de poissons. Je n’ai jamais connu mon père. Nous étions très pauvres et mon enfance a été chaotique. Petit, je n’avais pas le droit de parler Inuktitut, notre langue».
Jan, qui n’a jamais quitté Ilulissat, a créé sa petite entreprise de tourisme en 2018. Il confirme: «Dans mon pays, nous, les Inuits, sommes discriminés et nous devons constamment nous battre pour nous faire une petite place au soleil. Dans le domaine du tourisme, nos concurrents sont des grosses entreprises danoises. Elles font venir à bas prix des étudiants danois qui jouent au guide pour une saison ou deux, ne paient souvent pas d’impôts au Groenland et ne soutiennent donc aucunement notre communauté.»
Tourisme ? Oui, mais…
Jan – qui s’est donné beaucoup de peine à apprendre l’anglais – est convaincu que l’avenir économique d’un Groenland indépendant passe par le développement du tourisme. Il n’est pas le seul, puisque dès cet été, Nuuk, la capitale, sera desservie par un vol non-stop au départ de New-York, en plus des vols provenant d’Islande et du Danemark, et Ilulissat inaugurera en 2026 un aéroport capable d’accueillir des gros porteurs.
«OK pour une croissance, mais pas n’importe comment», précise Qannuk, un tour opérateur basé à Nuuk. Il explique: «Ce qui se passe actuellement est absurde: nous attendons quelque 50 000 touristes cet été, le double des années précédentes, mais sans les capacités d’accueil nécessaires. Nuuk dispose d’à peine six cents lits d’hôtel et Ilulissat, la région la plus visitée du pays, en compte à peine la moitié. Ça va être un gros bordel!» Amarissoq, la directrice du plus grand hôtel d’Iulissat (septante-huit chambres) confirme: «Je reçois quotidiennement des demandes mais nous n’avons plus une seule chambre de libre entre fin juin et fin août.»
Maire de la commune d’Avaanaata, (treize fois la Suisse et 11 000 habitants, dont ceux d’Ilulissat), Palle Jeremiassen tire (déjà) la sonnette d’alarme. Certes, le tourisme apporte des emplois et des devises, mais aussi de gros inconvénients. «Notre pays est en train de se transformer à cause du réchauffement climatique et de la fonte accélérée des glaciers. Plus cela s’accélère, plus il y a de monde qui veut visiter notre pays avant que…»
«Les bateaux de croisière, toujours plus nombreux et super polluants déversent parfois 3500 touristes à la fois quelques heures durant dans des villages de quelques centaines d’habitants. Je vous laisse imaginer le chaos… Et cet été, ils seront au moins 80 000 à débarquer.»
Palle s’inquiète aussi des conséquences du réchauffement climatique sur la vie de ses ouailles, essentiellement chasseurs-pêcheurs. «La saison de chasse, qui se pratique avec des chiens de traîneaux sur les étendues glacées, est toujours plus courte et cette glace qui fond de plus en plus tôt modifie l’ensemble de notre écosystème. Le tourisme ne fait qu’amplifier ce phénomène.»
Terres rares : le regard de Chimène
Si le réchauffement climatique est source de grosses inquiétudes, il représente aussi des opportunités qui attisent l’intérêt de nombreux pays, dont les Etats-Unis et le Canada. Le dégel dégage de nouvelles voies navigables, permettant notamment de rejoindre l’Asie sans passer par le cap Horn. Surtout, il permet l’exploitation facilitée − et donc bien plus rentable − des richesses du sous-sol Groenlandais.
A ce sujet, Aaja Chemnitz est soucieuse: «Notre pays regorge de ressources naturelles: pétrole, rubis, or, métaux précieux, et surtout des terres rares dont la Chine a aujourd’hui un quasi-monopole. C’est ce qui explique l’agressivité du gouvernement américain. M. Trump – et il n’est pas le seul – sait que nous avons besoin d’investissements et d’expertise pour les exploiter. Mais nous devons tout faire pour que l’exploitation de ces ressources, estimées à des centaines de milliards de dollars, ne devienne pas l’exploitation des Inuits.»
Nuna, candidate écologiste battue lors des dernières élections est également inquiète. «Nous vivons depuis toujours avec et dans la nature. Notre environnement est unique, nos paysages grandioses et notre biodiversité fragile. Il nous faut absolument trouver un équilibre entre la protection de l’environnement, le développement touristique et l’exploitation de notre sous-sol.»
Sera-t-elle entendue par le nouveau gouvernement groenlandais et par celles et ceux qui convoitent les richesses de ce pays? Rien n’est moins sûr. Ah, et juste pour la petite histoire: au cas où les Etats-Unis entendraient faire une offre de rachat du Groenland, le Financial Times estime qu’il faudrait bien débourser quelque 1100 milliards de dollars.
Visiter le Groenland, mode d’emploi
Ne tardez pas trop. Le pays est «à la mode» et la demande dépasse l’offre. Les infrastructures touristiques sont rares et souvent de qualité très moyenne. En été, tout est bondé et les moustiques se régalent.
Entre octobre et avril, période idéale pour voir des aurores boréales, compter sur des retards et annulations fréquentes des vols internes, notamment à cause de la météo. Prenez donc un peu de marge, surtout pour le vol du retour sur le continent européen.
Je ne suis pas un fan des agences de voyages dont le prix des forfaits est pour le moins opaque mais mieux vaut passer par une agence spécialisée vu le service offert en cas de problème.
Le Groenland est une destination coûteuse. Nombre d’activités (motoneige, chiens de traîneaux, navigation dans les icebergs, balades en raquettes ou skis) doivent être réservées longtemps à l’avance.
Favorisez les entreprises locales telles que ilulissatlocalguide.com Vos guides inuits seront bien plus intéressants à écouter que les «importés» danois.
Autres liens utiles: visitgreenland.com et guidetogreenland.com.
À lire aussi