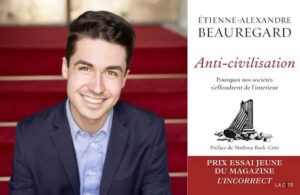Que faire avec l’Afrique? Outre la France, l’Europe s’interroge. La Suisse aussi
Le général Abdourahamane Tiani, qui a pris le pouvoir au Niger, s’exprime à la télévision nationale, le 28 juillet dernier. – © ORTN – Télé Sahel / France 24
Les quelques centaines de Français et Européens incités à quitter dare-dare le Niger après la prise de pouvoir des putschistes se sont demandé s’ils faisaient bien. Aucun Blanc n’avait été molesté. Le danger était plus politique que physique. Dans les chancelleries européennes et africaines, la perplexité grandit aussi. Décréter une cascade de sanctions, fermer les frontières, couper les aides, priver le vilain petit canard d’approvisionnement électrique, comme le fait le Nigéria, tout cela est spectaculaire, mais à quelles fins? «Rétablir l’ordre constitutionnel», comme on dit à Paris? Cela fait sourire les Africains qui connaissent trop bien les pratiques de la «Françafrique» aujourd’hui en débandade. Ironie de l’actualité: au même moment, le président du Sénégal, célébré comme un modèle de démocratie, vient de mettre son rival en prison pour l’écarter de la prochaine élection. L’Elysée et le Quai d’Orsay n’ont pas bronché.
La grande frousse des Européens devant les tollés anti-colonialistes grandissants se cristallise sur l’influence de la Russie. Ce n’est pas elle pourtant qui a mis le feu, même si elle a pu l’attiser ici et là. Quant aux fort-à-bras de la milice Wagner, là où ils ont pris pied, ils sont peu nombreux, occupés surtout à protéger le putschiste en chef local de ses rivaux. Occupés à mettre la main sur le commerce des matières premières précieuses, enlevé à l’ex-protecteur-profiteur. Il y a de quoi irriter les Occidentaux, pas forcément de quoi chambouler la géostratégie mondiale. La Russie n’est pas très en forme, semble-t-il… Les sommets pompeux, à St-Petersbourg comme autrefois à Paris, ne marquent pas forcément la réalité sur le terrain, sur l’immense espace africain.
Le péril le plus grand, le plus insaisissable, c’est évidemment l’avancée des divers groupes djihadistes à partir du Sahara, toujours plus vers le sud. La stratégie des Français et de leurs alliés a totalement échoué. Les rebelles islamistes avancent partout. Ils ont toutes raisons de se réjouir de ce qui se passe au Niger. La junte en place peut faire de beaux discours, mais dans l’état du pays, pauvre de chez les pauvres, privé maintenant d’aides économiques et militaires, elle n’a aucun moyen de freiner les progrès des rebelles islamistes sur cet immense territoire. Et même si les pressions internationales ramenaient le président élu au pouvoir, cela ne changerait rien à la donne. D’autant plus qu’au Tchad voisin, aussi en crise politique, la situation n’est guère meilleure.
Que doivent faire les Européens? Ils n’y pensent guère, n’ont encore aucune stratégie. Ils répètent leurs bonnes intentions, disent soutenir les efforts de construction démocratique, poursuivre les contributions humanitaires… Mais les mots commencent à sonner creux dans le chambardement actuel.
L’an passé, le chef de la diplomatie suisse, Ignazio Cassis, a passé trois jours au Niger en compagnie de Peter Maurer, alors patron du CICR. Ils y ont péroré avec une belle assurance… moins de mise aujourd’hui. Ce pays est l’un de ceux où la DDC (aide au développement) est la plus active. Avec 25 projets notamment à proximité du Nigéria et du Tchad: alimentation, développement local, éducation, formation professionnelle… et gouvernance locale. En collaboration avec une multitude d’autres organisations humanitaires. Les Suisses vont-ils rester? Tout l’indique. Dix sont partis. Il en reste «deux douzaines», selon le DFAE. Mais la DDC reste muette sur ses intentions. Ces louables efforts ne changeront pas grand-chose au tableau général mais il n’y a aucune raison objective de les interrompre. A moins de vouloir imiter à tout prix les Français et les Allemands, si peu inspirés.
Si les Européens ne songent pas sérieusement à la relation africaine qu’ils ont à réinventer dans le contexte mondial, ils se trouveront largués, là comme en tant d’autres domaines. Ballottés entre d’autres puissances.
À lire aussi