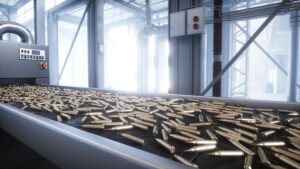Vous voulez la paix, nous attendons la vengeance

Emmanuel Macron et le président israélien Isaac Herzog, à Jérusalem le 24 octobre dernier. – © Amos Ben Gershom / Government Press Office – CC BY-SA 3.0
De me heurter, même, lorsqu’il s’agit des appels à la paix postérieurs aux pogroms du 7 octobre. Faut-il y voir l’effet de mes liens affectifs et familiaux avec Israël? Il s’agirait alors de mettre cela de côté, pour mener une véritable réflexion. Il se trouve que je n’en ai aucun avec l’Ukraine, et que le même désir de revanche, d’assister à une réplique, m’avait étreinte, quoique moins fort, au matin du 24 février 2022.
Nous discutions dernièrement avec l’équipe de BPLT des prochains articles à publier, et j’ai été une fois de plus stupéfaite de voir mes confrères s’accrocher à de minuscules espoirs de paix pour le Moyen-Orient. Je n’ai pu m’empêcher de leur faire remarquer que cela n’était pas à l’ordre du jour. Le Premier ministre Netanyahu a qualifié dernièrement de «capitulation» l’idée même d’un cessez-le-feu, et c’est aussi mon sentiment.
La capitulation. Ce mot frappe fort les consciences françaises, et nous y reviendrons.
Cette particularité est saisissante. Sitôt les premiers coups de feu tirés, où que ce soit et par qui que ce soit, le premier réflexe en Suisse est de préparer la paix, d’organiser des négociations, de faire cesser les combats. La tradition de neutralité et l’humanitaire y sont bien sûr pour beaucoup. Car en France, cette idée ne nous effleure pas d’abord. Faut-il en conclure que nous sommes un peuple belliqueux? Je tacherai de me passer de généralisations abusives. Mais le fait est que les appels à la paix les plus éloquents viennent ces temps-ci des rangs de la France Insoumise, où ils passent, à tort ou à raison, c’est un autre débat, pour le faux-nez de l’antisémitisme. Car ne pas soutenir la riposte d’Israël et plaider pour un cessez-le-feu reviendrait à lui retirer le droit à la riposte, ou le droit à se défendre, et finalement à exister. Nous attendons la vengeance, nous réclamons vengeance, pour ou contre Israël, pour ou contre la Palestine, pour ou contre le Hamas, suivant les points de vue, mais d’un bout à l’autre de l’échiquier politique, dans presque toute la société, nos passions guerrières sont éveillées, le mot de paix, inaudible, incongru, synonyme de reddition.
Certes, la France n’a pas voulu prendre part à la guerre d’Irak en 2003. Le plaidoyer de l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin avait marqué les esprits, et la popularité du président Chirac avait monté en flèche après ce refus. L’histoire et l’opinion ne sont heureusement pas monolithiques.
Dès le début de l’invasion russe en Ukraine, en revanche, il a été clair pour nos dirigeants et pour une grande majorité d’entre nous que notre devoir était de soutenir l’Ukraine, alors même qu’aucun traité international ne nous y obligeait. Cela n’a fait l’objet d’aucun débat au Parlement, de très peu de discussions entre nous, citoyens, qui nous sentions plutôt fiers de participer au combat des Ukrainiens contre l’envahisseur, et avons mobilisé de grandes ressources de solidarité pour accueillir les quelques réfugiés parvenus jusque chez nous. Cette absence de débat a ulcéré mes confrères suisses, tandis que je m’étonnais même que cette question se pose, tant notre engagement pour l’Ukraine semblait évident. Pire, la neutralité helvétique, qui a pourtant fort vacillé devant l’invasion russe, pouvait apparaître comme une lâcheté (c’est ainsi que l’ont exprimé certains de mes amis suisses), un refus de défendre l’Occident, voire une complaisance avec la Russie. Elle rappelait même, pour les plus mauvais esprits, les petits arrangements bancaires entre la Suisse et l’Allemagne nazie…
«Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà», disait Pascal. Mais comment expliquer cette profonde différence entre nous, voisins et de même langue, qui confine quelquefois à l’incompréhension totale?
Lorsque nous tentons, entre Suisses et Française, de démêler cette incompréhension, le spectre de la Seconde guerre mondiale surgit. S’il est peu pertinent de tracer des parallèles entre l’actuelle guerre menée par Israël contre le Hamas et la guerre de 1939-1945, le mot de «capitulation» employé par Benjamin Netanyahu résonne particulièrement. Nous ne sommes pas remis du traumatisme, de l’humiliation de 1940. Si les Alliés ont finalement consenti à compter la France au rang des vainqueurs, si le culte voué au général De Gaulle et à la Résistance, à juste titre, permet de panser un peu nos plaies, le fait est que la France de Vichy et l’armistice signée par Pétain ont laissé une tache indélébile. Nous ne nous pardonnons pas d’avoir participé avec zèle à la Shoah. Nous ne nous pardonnons pas d’avoir capitulé devant l’Allemagne, alors notre ennemi séculaire. Cette «étrange défaite», comme l’a écrit Marc Bloch, pourrait bien avoir façonné nos réflexes, nos passions, nos réactions.
Ne chercherions-nous pas à nous venger de nous-mêmes et de notre propre histoire en nous jetant à corps perdu dans les conflits armés des autres? Ne chercherions-nous pas à effacer le stigmate de la capitulation en prenant parti, en nous engageant, par des paroles ou des actes, aux côtés de tel ou tel belligérant? Les débats, dans ces circonstances, sont en effet très loin des perspectives dépassionnées que l’on entend en Suisse. Nous allons trop loin. Que l’on se souvienne des propos de Bruno Le Maire qui voulait «mettre la Russie à genoux» (économiquement s’entend), que l’on se rappelle la formule employée par Emmanuel Macron lors de la pandémie de Covid-19: «Nous sommes en guerre». Le langage des armes, au propre comme au figuré, nous est doux à l’oreille. Notre hymne national le chante haut: «aux armes, citoyens! formez vos bataillons!» La neutralité ne fait pas partie de notre histoire ni de notre identité; et je crois ne pas trop m’avancer en disant que nous, Français, ne la comprenons tout simplement pas.
Comme nous nous targuons aussi d’être le «pays des droits de l’homme», il nous faut bien donner un coup de main à l’humanitaire suisse. Mais cela n’est pas incompatible avec la guerre: si les convois peuvent entrer, même sous les bombes, nous nous en satisfaisons. Nous réclamons à Israël une «pause humanitaire», et nous sommes pleinement et fermement solidaires de ses opérations visant à détruire le Hamas… pourvu qu’elles s’efforcent d’épargner les civils gazaouis, ce qui, ne nous leurrons pas, est une gageure.
D’autres pays semblent déterminés dans leurs réactions par les cicatrices de leur histoire. La projection du drapeau israélien sur la porte de Brandebourg, en Allemagne, au lendemain du 7 octobre, avait frappé les esprits: ce soutien inconditionnel et sincère est aussi une manière de rompre toujours davantage avec l’horrible passé allemand.
Mais n’y voyons ni essentialisation, ni fatalisme. Certes les Suisses ne me changeront pas, les Français ne changeront pas, nous portons fièrement les couleurs de nos marchands d’armes autant que les salissures et les grandeurs de notre histoire. La guerre, où qu’elle soit, réveille nos pires passions, même confortablement assis dans nos canapés occidentaux, et nous l’avons rappelé ici maintes fois en guise d’avertissement. En avoir conscience, sans doute, est déjà un pas vers la paix, c’est s’extraire de la rage fanatique, c’est aménager les possibilités du dialogue.
À lire aussi