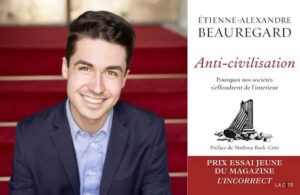Niger: les trous de l’info
Marche de soutien à la junte militaire et au général Abdourahamane Tchiani à Niamey (Niger) le 30 juillet dernier. On peut lire de nombreux slogans anti France sur les pancartes des manifestants. – © General_Tchiani via X
Ces temps-ci les Occidentaux ne cessent de répéter, non sans raison, combien le droit international, le respect des frontières nationales sont essentiels à l’équilibre du monde. Fort bien. Mais là, au Niger, on envisage de bazarder d’un coup ces principes? Plus question de feu vert du Conseil de sécurité des Nations-Unies! Allez-y les gars! Renversez donc ces méchants militaires!
Ladite intervention n’aura pas lieu. Parce qu’au sein de la CEDEAO, certains gouvernements s’y opposent, dans d’autres c’est l’opinion publique qui la voit d’un très mauvais œil. Même au Nigeria qui était en pointe. Même au Sénégal, le chouchou de la France, où la tension politique intérieure est extrême à l’approche des élections: l’accès à internet sur les portables y a été coupé, l’irritation populaire est grande.
Nombre d’experts disent le risque qu’aurait une telle opération militaire d’enflammer une Afrique saisie de colère anti coloniale, le risque aussi que les groupes islamistes qui rongent ces pays tirent profit du chaos annoncé.
Il y a un autre aspect de la donne qui est bien peu ou pas évoqué dans le vacarme des médias. C’est le rôle des Etats-Unis. Qui ont encore plus de mille soldats au Niger, reclus sur leurs bases. Dont ils ne sortaient guère avant le putsch, peu enclins à crapahuter dans le désert contre les rebelles, préférant gérer des systèmes électroniques d’observation qui, soit dit en passant, n’ont pas suffi à prévenir les services de renseignements des intentions de l’armée locale. Il faut lire Foreign Policy pour prendre la mesure de l’embarras américain. On y apprend que l’un des chefs du coup d’Etat, le général de brigade Moussa Salaou Barmou, a été formé outre-Atlantique dans le cadre d’un vaste programme du Département de la Défense US. Comme des dizaines d’officiers africains. Dont sept au moins se sont retrouvés au sein de juntes militaires putschistes. L’éditorialiste du magazine, Matthew Koenig, directeur aussi de l’«Atlantic Council’s Scowcroft Center for Strategy and Security» se désole et constate l’échec de cette politique d’influence. Mais pourquoi diable celle des Russes paraît-elle avoir plus de succès? Le revers a de quoi secouer Washington. Sa représentante envoyée en hâte à Niamey, Victoria Nuland, a reçu un accueil glacial. Celle-là même qui tire depuis longtemps tant de ficelles à Kiev subit un camouflet en Afrique. Mais les manœuvres continuent dans l’ombre.
Autre «oubli» dans le panorama généralement dressé. L’alarme internationale est grande à propos du Niger car ce pays se trouve sur le trajet du gazoduc prévu et déjà entrepris qui doit relier le Nigeria, avec ses réserves gigantesques de gaz naturel, à l’Algérie. Puis à l’Europe. Européens et Américains s’apprêtent à investir des milliards dans le projet, devenu vital depuis le sabotage de Nord Stream et l’arrêt de la fourniture russe. Si le nouveau pouvoir de Niamey stoppe ce transit, ou le freine, ou renchérit l’opération, cela fera mal. D’où la tentation, pour tant de pays, de le renverser. A moins qu’au bout du compte, tous acceptent la nouvelle donne au nom de leurs intérêts très concrets, d’un bout à l’autre de la chaîne.
Et l’uranium, ce trésor du NIger? Pour l’entreprise française qui l’exploite, Orano (ex-Areva), quel désastre… Paris assure pouvoir s’en passer. Il est vrai que le précieux combustible des centrales nucléaires n’est pas inclus dans les sanctions contre la Russie qui continue d’en fournir à la France. L’hypocrisie n’a pas de limites.
Enfin on peut s’étonner qu’un autre «détail» soit peu évoqué: le Niger utilise, comme quinze autres pays d’Afrique occidentale, le franc CFA. La monnaie créée par la France au moment de la décolonisation. Elle est arrimée à l’euro, gérée par la Banque de France qui détient ces réserves. Cela fait grincer depuis longtemps au sud du Sahara… Si les putschistes nigériens relancent l’idée d’en sortir et de se tourner vers une autre devise, cela fera hurler à Paris. Dont on voit, sur ce sujet aussi, les raisons de s’alarmer. Alors la belle chanson sur le but proclamé, «le rétablissement de la démocratie», merci, mais basta.
À lire aussi