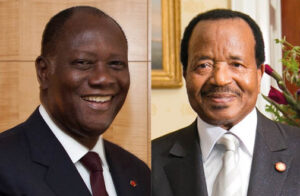Inde: la démocratie doit-elle avoir peur de Narendra Modi?

Le Premier ministre Narendra Modi au sommet des BRICS 2018 à Johannesburg. – © Kremlin.ru – Source officielle
L’Inde, plutôt discrète jusqu’à récemment sur la scène internationale, est un pays avec lequel il va désormais falloir compter. Car le pays, qui vient de devenir le plus peuplé du monde, est aussi, depuis l’année dernière, passé au 5ème rang des puissances économiques mondiales grâce à une croissance de son PIB de près de 7% – un record mondial. A ce rythme, l’Inde dépassera bientôt l’Allemagne et le Japon pour se hisser dans le trio de tête à côté de la Chine et des Etats-Unis. C’est d’ailleurs à Delhi que se tiendra en septembre, sous sa direction, la 18ème rencontre du G20.
L’Inde est aussi de plus en plus influente géopolitiquement. Depuis sa prise de fonctions en 2014, son Premier ministre, Narendra Modi, a fait le tour du monde à la rencontre de ses dirigeants et a su se rendre indispensable pour les Occidentaux, qui misent sur l’Inde pour faire contre-poids à la Chine. Rien que ces deux derniers mois, Modi a été reçu en grande pompe en Egypte et à Washington, avant d’être l’invité d’honneur des festivités du 14 juillet à Paris. Tous prêts à fermer les yeux sur sa politique intérieure.
Vers un Etat national hindou
Car à l’interne, la politique de Narendra Modi est plus controversée. On lui reproche, ainsi qu’à son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), le Parti du peuple indien, de se servir de son pouvoir à des fins idéologiques pour faire de l’Inde – Etat fédéral et laïc par sa Constitution – un Etat nationaliste hindou. Reléguant ainsi les citoyens issus d’autres religions, musulmans en tête et, dans une moindre mesure, les chrétiens, à un statut de seconde zone.
Or, si la Constitution indienne ne reconnaît aucune religion d’Etat, l’Inde ne compte pas moins de sept religions officielles. Elle est surtout le troisième pays musulman du monde par sa population après l’Indonésie et le Pakistan. Une communauté devenue la première cible de Narendra Modi. Il lui est d’ailleurs reproché d’avoir encouragé, en 2002, un pogrom anti-musulman qui fit près de 2’000 morts au Gujarat.
Modi et la rhétorique nationale-populiste
Alors à la tête du Gujarat, Modi s’était fait le chantre de la défense des hindous. Il s’était également rallié les grands industriels – dès lors prêts à financer ses campagnes électorales – grâce à une politique de défiscalisation favorable aux investisseurs, s’érigeant ainsi en homme du développement. Mais aussi en homme du peuple, lui le fils d’épicier, face aux élites institutionnelles.
Un dispositif politico-idéologique qu’il a érigé en modèle lors de sa campagne pour les élections nationales de 2014 et transposé à l’échelle du pays après son accession au poste de Premier ministre. Or, même s’il est assez malin pour éviter les provocations anti-minorités en public, son discours, qui repose sur la peur, la diabolisation de l’islam et la glorification de l’hindouisme, fait mouche dans un pays où plus de 80% de la population est de religion hindoue. Il a ainsi été réélu avec une large majorité en 2019.
A ce titre, le conflit indo-pakistanais au Cachemire, de même que les nombreux attentats perpétrés en Inde depuis le début du XXIème siècle par des mouvements islamistes, servent la politique de Modi. De même qu’ils expliquent en partie son succès lors des élections de 2014 face au parti historique du Congrès – créé par Gandhi et Nehru en 1947 – hélas rongé par la corruption, mais surtout défenseur d’un Etat laïc.
Les nationalistes en guerre contre les musulmans et le Taj Mahal
Dans les Etats dirigés par les nationalistes hindous, de nombreuses «mesures» ont dès lors été prises contre la communauté musulmane: interdiction des mariages interreligieux, dissuasion d’occuper des logements dans les quartiers à majorité hindoue, lynchage des éleveurs musulmans transportant des bovins au nom de la protection de la vache, animal sacré de l’hindouisme, etc.
Les nationalistes hindous supportent par ailleurs mal l’idée que le monument le plus emblématique d’Inde, le Taj Mahal, ait été construit par un empereur musulman. Au point que le célèbre mausolée de marbre blanc, qui attire chaque année six millions de visiteurs, n’apparaît plus dans le guide touristique régional. Dans le même esprit, les gouvernements de certains Etats favorables à Modi ont fait effacer des livres scolaires l’histoire des dynasties mogholes (musulmanes) qui ont envahi et dirigé l’Inde pendant trois siècles. Ils ont également supprimé les chapitres sur la démocratie. Et même le programme de chimie, la science ne faisant pas bon ménage avec les mythes hindous.
Une gouvernance de plus en plus autoritaire
On reproche aussi à Modi d’imposer à l’Inde un système de gouvernance autoritaire et d’essayer de soumettre, par des moyens discutables, les institutions. A commencer par les tribunaux régionaux.
Le chef de l’opposition, Rahul Gandhi, a ainsi été reconnu coupable de diffamation par un tribunal du Gujarat – et un juge proche de Modi – pour avoir associé ce dernier à deux criminels notoires lors d’un discours électoral en 2019. Il a été expulsé du Parlement en conséquence. La sentence le rend inéligible pour six ans, ce qui devrait l’empêcher de se présenter aux élections de 2024. Ses sympathisants dénoncent un muselage de l’opposition. Le principal opposant de Modi peut cependant encore tenter de faire annuler sa condamnation par les juridictions supérieures. Affaire à suivre.
On accuse également Modi d’accroître son contrôle sur les médias indépendants, fort nombreux en Inde, cela dit. En février dernier, les locaux de la BBC à Bombay et Delhi ont été perquisitionnés par les autorités fiscales quelques semaines après la diffusion d’un documentaire critique du Premier ministre. Le média britannique ne serait pas le seul. Des associations de défense des droits auraient également été perquisitionnées par le fisc, selon Reporters Sans Frontières.
L’extrémisme religieux en Inde, un phénomène récurrent
Ainsi, selon certains experts, Modi serait en train de transformer «la plus grande démocratie du monde» en une «autocratie électorale». On le compare à Erdogan ou à Netanyahou, parfois à Donald Trump ou à Jair Bolsonaro. Certains vont même jusqu’à parler de «dictature douce» et de déclin démocratique.
En réalité, les dérives autoritaires et l’extrémisme religieux ne sont pas nouveaux en Inde. La création de l’Inde moderne elle-même est entachée par le fanatisme et les violences interethniques: lors de l’indépendance, en 1947, la partition de l’Empire britannique des Indes en deux entités distinctes – l’Union indienne, majoritairement hindoue, et le Pakistan, musulman – avait jeté 12 millions de musulmans et d’hindous sur les routes de l’exode et de la mort. Les violences entre communautés qui avaient accompagné ces déplacements avaient fait plusieurs centaines de milliers de victimes.
Le Mahatma Gandhi, qui prônait une plus grande tolérance religieuse, avait alors vu se dresser contre lui les fanatiques de tous bords. Il fut assassiné par un extrémiste hindou pour avoir pris la défense des musulmans. Le meurtrier était membre du RSS, l’Association nationale patriotique des volontaires, une organisation paramilitaire créée dans les années 1930 qui ne cache pas son discours anti-minorités, et dont Narendra Modi est un membre éminent depuis son plus jeune âge. C’est dire que l’extrémisme hindou ne date pas d’hier.
Depuis lors, les conflits entre hindous et musulmans – et les massacres aussi – ponctuent l’histoire de l’Inde. D’autres communautés religieuses, dont les chrétiens et les sikhs, ont fait l’objet de persécutions. En 1984, Indira Gandhi, alors Première ministre, avait ordonné une opération militaire controversée contre les sikhs séparatistes du Penjab qui avait coûté la vie à près de 1’500 personnes. Ce qui lui avait valu d’être assassinée par ses propres gardes du corps sikhs.
Le spectre de la dérive autoritaire
Les dérives autoritaires marquent elles aussi l’histoire du pays. Indira Gandhi, encore elle, n’avait-elle pas, de 1975 à 1977, imposé l’état d’urgence en raison de troubles internes, suspendant ainsi les libertés publiques et les élections? C’est elle également qui imposa dans le pays, dans le but de réduire sa croissance démographique, une campagne de stérilisation forcée qui toucha des centaines de milliers d’hommes issus des classes défavorisées.
Le culte de la personnalité qui entoure la famille Nehru-Gandhi (à ne pas confondre avec le Mahatma Gandhi), dont sont issus tous les dirigeants du parti du Congrès, a lui aussi assombri la démocratie indienne. D’autant que le Congrès a conservé le pouvoir presque sans relâche de 1947 à 2014. Dans ce contexte, le fait que le BJP ait pu s’imposer à la tête du pays en 2014 face au Congrès est considéré par certains observateurs comme une preuve du renouveau de la démocratie indienne.
Enfin, les minorités religieuses ne sont pas les seules à être persécutées. Bien que la Constitution de 1947 condamne le système des castes, les dalits – ou «intouchables» – qui représentent la plus basse caste dans l’hindouisme, continuent d’être maltraités et sont régulièrement victimes des crimes les plus atroces.
La démocratie en danger?
La démocratie indienne est-elle en danger? La question divise. Car l’Inde est un Etat fédéral qui garantit une large autonomie aux Etats. Or le pouvoir de Modi et du BJP concerne principalement les Etats situés au nord du pays, ceux du sud leur étant moins subordonnés.
Certains experts rappellent par ailleurs que la Constitution indienne impose la discrimination positive en faveur des minorités – l’Inde est le premier pays à avoir imposé des quotas en termes d’accès à l’université et à la fonction publique. Elle garantit également la représentation dans l’espace public de toutes les religions sur un pied d’égalité. De fait, dans les centres urbains, les temples hindous côtoient les églises chrétiennes, les mosquées et les monastères bouddhistes.
Certains vont même jusqu’à penser que la tentative de Narendra Modi pour se débarrasser de Rahul Gandhi, son opposant le plus sérieux aux élections nationales de l’an prochain, a choqué l’opinion et pourrait se retourner contre lui. Même s’il reste pour l’instant favori.
Ce qui est certain, c’est que les Indiens, y compris de nombreux hindous, sont très attachés à leur démocratie et souhaitent son maintien. La participation aux élections se situe généralement entre 58% et 67%.
On a toujours dit de l’Inde qu’elle était un pays ingouvernable. Que sa taille et sa diversité culturelle portaient en elles les germes de la division. Plus de septante ans après sa création, l’Inde est toujours là. Et la vitalité de son système démocratique nous invite à repenser la nature même de la démocratie.
À lire aussi