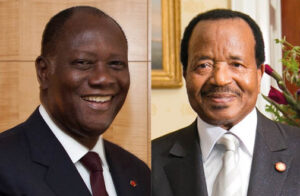«Des ex-combattants de Daesh descendent vers le Sahel»

Combattants de Daesh dans le nord du Burkina Faso. – © aharan_kotogo – CC BY-SA 4.0
Catherine Morand: Vous étudiez la stratégie des groupes djihadistes dans le Sahel depuis plusieurs années. Celle-ci a-t-elle évolué?
Lassina Diarra: Depuis 2017, date à laquelle les groupes terroristes se sont reconstitués dans le Sahel – tout particulièrement le Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans, affilié à Al-Qaida – ceux-ci sont passés à une stratégie de conquête territoriale, ce qui n’était pas le cas auparavant. Celle-ci s’accompagne d’une moblisation doctrinale, un endoctrinement ethnique également, en direction de la communauté peule, qui forme le gros des troupes djihadistes. Cette communauté marginalisée, agropastorale, qui pratique la transhumance, est en quête de reconnaissance sociale, d’une redéfinition de son identité. On constate également que les groupes tentent désormais de réduire le nombre de combattants des cellules de combattants, les katibas, pour éviter de se faire repérer.
Le Mali, le Burkina Faso, le Sahel en général, attirent-ils aujourd’hui les rescapés de l’Etat islamique?
Lors de mes recherches, j’ai en effet pu constater que des ex-combattants de Daesh descendent vers le Sahel pour grossir les rangs de leur antenne sahélienne de l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS), qui s’est reconstituée après la mort de leur chef. Ces nouveaux combattants venus de la zone islamique irako-syrienne forment à la technique de combat, à la fabrication d’engins explosifs, fournissent des équipements militaires, réorganisent les systèmes de communication.
Quelles sont les conséquences pour la région du départ des militaires français au Mali et au Burkina Faso?
Les forces françaises ont éliminé certains chefs djihadistes, ce qui a ralenti de facto le développement du projet expansionniste des groupes terroristes. Leur départ complexifie davantage la lutte contre le terrorisme, avec des djihadistes qui gagnent du terrain au Mali et au Burkina Faso, et des armées nationales qui peinent à les contenir. Mais ce qu’il faut surtout relever, c’est que durant des décennies ces pays n’ont pas été capables de construire un système politique pour viabiliser l’Etat sur l’ensemble de leur territoire. Les dirigeants sahéliens ont bâti un système politique lubrifié par une corruption endémique qui a privé des régions entières des services de base minimums.
C’est sur cette délégitimation de l’Etat que les groupes djihadistes proposent une alternative à la population. Au Mali, même les espaces reconquis sur les djihadistes par l’armée nationale avec l’aide des Français n’ont pas conduit à des programmes sociaux, qui auraient pu ramener une certaine confiance des populations dans l’appareil étatique.
Comment jugez-vous l’action des militaires français dans la région?
Il faut noter que la France a toujours été un partenaire stratégique important pour les Etat sahéliens et l’Afrique de l’Ouest. On se souvient du rôle de la France en 2013 au Mali, qui est intervenue à la demande du gouvernement malien pour stopper la progression djihadiste et reconquérir les villes maliennes tombées entre les mains des terroristes.
Après, il n’a pas été demandé aux forces francaise de se substituer aux forces armées nationales; la lutte contre le terrorisme devait relever des armées nationales et la France n’intervenir qu’en appui. La durée de leur présence a conduit à une sorte d’enlisement, que les acteurs du nationalisme populiste ont utilisé.
Quelle part du territoire du Burkina Faso est désormais sous le contrôle de groupes djihadistes?
Officiellement les djihadistes contrôlent plus de 40% du territoire burkinabè, ce qui ne ne s’accompagne pas pour autant d’une gouvernance ou d’une administration systématiques. Ils mettent la pression sur les territoires, exploitent ses ressources, et organisent le blocus des grandes villes pour empêcher le ravitaillement des populations, pour qu’à terme, elles se désolidarisent de l’Etat. Quand la population est coupée de l’Etat, le renseignement ne fonctionne plus, et cela devient difficile pour l’armée nationale de mener des opérations.
Comment cela se passe-t-il dans les zones placées sous leur contrôle?
Les djihadistes se financent sur les activités des trafiquants ordinaires, qui paient un droit de passage. Ils organisent aussi le trafic de bétail, exploitent les sites d’orpaillage et vendent des armes. Aujourd’hui, pour 150’000 francs CFA (un peu plus de 220 francs suisses, ndlr), tu as une kalachnikov, alors qu’avant, elle coûtait dans les 800’000 francs CFA. Les zones qu’ils contrôlent servent de camps d’entraînement, avec deux volets, opérationnel et idéologique. Et aussi de prison à ciel ouvert pour des captifs, des militaires ou des volontaires qui combattaient pour l’Etat, qu’ils cherchent à intimider pour obtenir une allégeance, un gage de loyauté, une sorte de pacte de non trahison.
Le Niger est-il actuellement davantage épargné par les groupes djihadistes que le Burkina et le Mali?
Le Niger compte moins d’attaques terroristes avec violence que ses voisins. Dans sa lutte contre le terrorisme, le Niger mène un travail de fond, sur l’ensemble du spectre, avec des centres de déradicalisation, la réinsertion des ex-combattants terroristes. Accompagné par un maillage opérationnel important du territoire, ce qui permet au Niger d’être un peu à l’abri des attaques djihadistes, sans pour autant être parvenu à les éradiquer complètement.
Y a-t-il eu une accélération des attaques en direction des pays dits côtiers que sont le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire?
Oui, sur les frontières de ces Etats, dans les parties nord, les incursions et les attaques de djihadistes se sont multipliées. Aujourd’hui, le Bénin est le maillion faible des Etats côtiers, atttaqué qu’il est sur deux fronts avec deux organisations terroristes différentes: à l’ouest, par l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), l’antenne sahélienne de Daesh; et à l’est par le Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) affilié à Al-Qaida. Au Togo également, on constate un déplacement massif des populations dans le nord du pays. Quant à la Côte d’Ivoire, grâce à sa présence militaire renforcée, elle a réussi depuis un an à contenir des incursions djihadistes dans le nord du pays; ce qui l’inquiète aujourd’hui, c’est une infiltration de terroristes dans le flux important de réfugiés en provenance du Burkina Faso.
Une réponse sécuritaire suffit-elle pour contenir la menace terroriste?
En regardant la concentration des forces militaires présentes dans le Sahel depuis 2013, force est de constater que ce militarisme croissant n’a pas été capable d’apporter une réponse efficace au terrorisme. Les djihadistes eux, se basent sur les aspirations et les frustrations de la population, et font la promesse d’y apporter des réponses concrètes. C’est un discours qui séduit face à un Etat central, davantage dans une démarche militariste. Les Etats doivent également apporter des réponses concrètes aux préoccupations de la population. C’est ce que fait notamment la Côte d’Ivoire, qui multiplie les projets sociaux, tout particulièrement en direction des jeunes, dans la partie nord du pays.
Peut-on parler d’un agenda identique des djihadistes et du groupe de mercenaires russe Wagner, qui s’attaquent tous deux à la présence française et occidentale, tout en convoitant les mines d’or de ces pays?
Par définition les groupes terroristes poursuivent un but théocratique, la confesionnalisation de l’Etat; ils s’intéressent aux ressources naturelles, construisent un discours populiste, pour délégitimer les forces étrangères et appeler les populations locales à les chasser hors du territoire. Mais Wagner n’est pas pour autant un allié des groupes terroristes. Tous deux ont un agenda différent, même si les méthodes peuvent paraître les mêmes.
À lire aussi