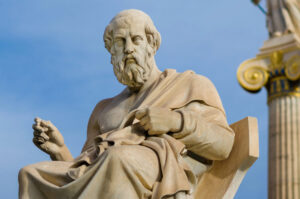PS français: une impuissance qui vient de loin

Des militants au meeting de Benoit Hamon, candidat PS à l’élection présidentielle de 2017, le 28 août 2016 à Saint-Denis. – © Marion Germa
Sans surprise, ses rivaux de la gauche très plurielle ont rejeté cette invitation-surprise née de l’affolement devant l’effondrement des sondages mettant la candidate socialiste en lamentable posture.
Vendredi, elle tente une nouvelle volte-face en déclarant participer à la Primaire Populaire, initiative d’un collectif de citoyens de gauche las des étripages d’appareils. Or, cela faisait trois mois que ce collectif tentait d’obtenir d’elle – ainsi que des autres candidats – sa participation à une primaire ouverte pour désigner un seul candidat de la gauche. Jusqu’à vendredi (10 décembre), elle avait repoussé cette demande d’un escarpin dédaigneux. Aujourd’hui, Anne Hidalgo s’en empare comme d’une planche d’un salut qui est loin de lui être assuré (consulter le site de la Primaire Populaire).
L’ultime nonosse de Méluche!
Mais si elle ne devait être rejointe que par Arnaud Montebourg cette primaire à gauche ne signifierait pas grand-chose. Elle ne soulèverait de l’intérêt que si Yannick Jadot décide d’y participer, ce qu’il a toujours refusé. Le candidat communiste Fabien Roussel, lui aussi, a rejeté la Primaire car sa candidature a pour premier objet de remettre le PCF sous les projecteurs, après avoir stagné pendant longtemps dans l’ombre de Jean-Luc Mélenchon. Quand à ce dernier, la campagne 2022 est «sa grande dernière», son ultime nonosse à ronger. Et gare à qui voudrait le lui ôter de ses crocs! Ils ne sont pas encore tous émoussés.
Bref, la gauche reste coincée au fond de la piscine. Elle en ressortira un jour, sous une forme ou une autre. Il n’en va pas de même du Parti Socialiste, en tant que tel. Il représente si peu de chose qu’une brise mauvaise pourrait effacer ses dernières traces sur le sable de l’Histoire.
D’autres partis social-démocrates résistent en Europe
Moult médias prétendent qu’il s’agit d’une crise qui traverse tous les partis socialistes démocratiques (social-démocrates). Certes, l’effondrement de l’empire soviétique leur a flanqué un sacré coup dans les gencives. Lorsque la menace du communisme autoritaire de l’URSS faisait trembler dans leurs chausses les dirigeants capitalistes, les socialistes démocratiques disposaient d’un argument massue pour les convaincre d’instaurer un Etat social, plus ou moins perfectionné, et de lâcher quelques concessions économiques, péniblement arrachées la plupart du temps: «Si vous continuez à rester sourds à nos revendications, l’Ogre rouge viendra vous casser le crâne avec son marteau et couper le cou avec sa faucille».
Cette peur du rouge s’est éteinte en même temps que l’étoile bolchévique au sommet du Kremlin.
Toutefois, la plupart des partis socialistes démocratiques1 en Europe, après avoir accusé le coup, ne se sont pas écroulés politiquement; huit d’entre eux figurent, aujourd’hui même, dans les gouvernements suivants: Allemagne, Suède, Danemark, Espagne, Portugal, Suisse, Belgique et Luxembourg.
On ne pourrait même pas expliquer leur résistance électorale par le fait qu’ils vivent dans des cultures protestantes: la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne et le Portugal sont issus de cultures catholiques. Ni par l’absence d’un Parti communiste historiquement fort qui aurait passé jadis le socialisme démocratique sous l’éteignoir, comme en France et en Italie: le Parti communiste portugais reste un acteur important de la vie politique de son pays alors que les socialistes sont au pouvoir (du moins pour le moment, des élections anticipées se dérouleront le 30 janvier prochain).
Une spécificité française
Il y a donc une spécificité française dans cet effondrement du PS. Pourquoi ? Comme toujours, les réponses sont aussi nombreuses qu’entrelacées. Une piste: le caractère particulier du PS français par rapport à ses voisins. Le Plouc avait avancé cette hypothèse le 14 avril 2016 dans un papier intitulé «Comment le PS français est régulièrement tué par ses renégats» (lire ici).
Moins arrimés aux syndicats ouvriers que d’autres partis socialistes (même s’il y a eu des liens parfois étroits avec Force Ouvrière dans les années 1950 ainsi qu’avec les enseignants de la FEN), le PS français a toujours eu beaucoup de mal à incarner la classe des travailleurs dans son ensemble.
Contrairement à la plupart des pays d’Europe, le syndicalisme français, fin du XIXème et début XXème siècles, répugnait à s’allier aux partis politiques même de gauche. En témoigne la Charte d’Amiens adoptée le 13 octobre 1906 par la CGT qui, sous l’impulsion des anarcho-syndicalistes, proclame «l’indépendance des syndicats à l’égard des partis et des sectes». Cette situation particulière n’a pas facilité la coordination entre la base ouvrière et son expression politique à l’aube du XXème siècle.
De même, le PS n’a pas connu la même pérennité que nombre de ses voisins (le Parti socialiste suisse existe depuis 1888, le Parti social-démocrate des travailleurs suédois depuis 1889, sans interruption et la social-démocratie allemande, depuis 1875 avec une interruption dans la clandestinité pendant le nazisme).
Les trois morts du PS
Fondé en 1905, le PS – sous ce nom et, auparavant, sous celui de Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) – a connu trois morts, suivies de renaissances sous une autre forme: de 1905 à 1920 avec la scission majoritaire qui allait donner naissance au Parti communiste français et à une SFIO réformiste sous la houlette de Léon Blum; de 1920 à 1969 avec l’extinction de la SFIO qui s’est décrédibilisée, notamment, par son rôle dans la guerre d’Algérie; semblant de résurrection en 1971, avec le PS transformé en écurie présidentielle par et pour François Mitterrand.
Mais alors, il s’agit surtout d’un parti «à l’américaine» et non pas d’une formation sociale-démocrate, bras politique des syndicats de salariés. Cette séquence se meurt actuellement après le quinquennat décevant de François Hollande.
La révolution française invente la gauche et la droite
Pour comprendre cette spécificité, il faut sans doute creuser encore plus profondément. Peut-être jusqu’à la Révolution française, matrice de la modernité. Ce n’est pas un hasard si c’est elle qui a offert un nom – le clivage gauche-droite – à une opposition qui remonte sans doute à l’aube de l’humanité, entre tenants de la conservation et partisan du mouvement.
En effet, la gauche et la droite sont nées en politique vendredi 11 septembre 1789 lorsque l’Assemblée constituante s’est prononcée sur le véto à donner ou non au roi Louis XVI pour qu’il suspende la promulgation des lois votées par les députés. Afin de faciliter le compte des voix, les partisans du véto se sont placés à la droite du président de l’Assemblée et les opposants, à sa gauche. La formule perdurera et fera le tour de la planète.
La passion des idées
La Révolution française s’est transformée en vaste chaudron où sont entrées en ébullition toutes les grandes idéologies qui traverseront les siècles jusqu’à nous: l’anarchisme, le socialisme, le communisme, le libéralisme, le conservatisme, le nationalisme. D’où cette passion des idées qui rend la France si riche et si fragile.
Cette turbulence a aussi créé des scissions au sein de chaque camp. Celui du changement, la gauche, en a été particulièrement affecté. Car lorsque l’on prône le progrès, on imagine forcément le monde que l’on veut faire advenir. D’où débats, discussions, fâcheries … Et plus si mésentente persistante. Alors qu’à droite, il s’agit avant tout de conserver le monde en son état. Il est donc plus facile de se mettre d’accord sur le réel présent.
Cela dit, chez l’humain rien n’est simple; la droite se divisera aussi sur l’état des lieux et sur ce qu’il convient de faire pour le conserver. Parfois, il faut que tout change pour que rien ne change, disait Tancredi à son oncle dans Le Guépard de Tomasi di Lampedusa. Mais en règle générale les divisions internes de la droite seront moins nombreuses et moins clivantes que celles apparues à gauche.
Le moment-clé de la division de la gauche
Le moment-clé de la division au sein de la gauche est survenu au mois de juin 1848, juste après la Révolution de février qui chassa Louis-Philippe de son trône. Le gouvernement, formé de républicains modérés et de militants de gauche, a réprimé dans le sang la foule des ouvriers qui protestaient contre la fermeture des Ateliers nationaux. Bilan: 3’000 blessés et tués chez les insurgés, 1600, du côté des forces de l’ordre, 1’500 émeutiers fusillés et 4’000 transportés de force en Algérie (source: la revue numérique Hérodote)
Le gouvernement révolutionnaire avait pris toute une série de réformes « sociétales », pour reprendre l’expression actuelle, telles que la liberté de presse, le droit de vote pour tous les hommes, l’abolition de l’esclavage, la suppression de la peine de mort pour motif politique. De belles réformes, on en conviendra. Mais qui ne nourrissaient pas les affamés. Les Ateliers nationaux créés dans le mouvement de la révolution de 1848 fournissaient du travail aux nombreux chômeurs parisiens. Leur suppression sans solution de rechange a suscité la révolte et créé un large fossé entre, d’une part, la gauche réformiste et intellectuelle et d’autre part, la gauche populaire et révolutionnaire.
«Sociétal» et «social» sont dans un bateau qui tangue
Ce clivage entre une gauche «sociétale» et les aspirations à la justice sociale des couches les plus corvéables des travailleurs, nous le retrouvons encore aujourd’hui.
Au début du premier septennat de François Mitterrand, le gouvernement de Pierre Mauroy (un rescapé de la SFIO) a pris une série de réformes sociales importantes, comme le précise un de nos correspondants. Mais, progressivement le PS va privilégier le «sociétal» au détriment du «social». Résultat: le vote ouvrier en faveur du Front National.
Dès lors, ce PS-là doit débarrasser le plancher pour laisser place à une autre forme de socialisme, sous cette dénomination ou une autre. En tenant compte de ce facteur aujourd’hui essentiel: transformer les rapports humains pour qu’ils s’adaptent au dérèglement climatique, tout en assurant la justice sociale.
Vaste programme. Mais si personne ne le commence, nous payerons très cher le prix de la discorde.
1L’appellation «social-démocrate» est normalement réservée aux partis de langues germaniques. Ainsi, en Suisse, il est appelé Sozialdemokratische Partei der Schweiz en allemand, Parti Socialiste Suisse en français, Partito Socialista Svizzero en italien et Partida socialdemocrata da la Svizra en romanche, langue d’origine latine parlées dans certaines vallées des Grisons mais proches géographiquement des vallées germanophones. C’est surtout en France que le terme «social-démocrate» a pris une tournure péjorative, dans le sens «mou du genou», lancée par les communistes et les mouvements gauchistes.
À lire aussi