Trafic de stupéfiants: comment l’économie légale se rend co-responsable

Société constituée on ne peut plus légalement, EncroChat fournissait des services idéaux pour les trafiquants. Shutterstock
Clotilde Champeyrache, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
La réalité est bien moins binaire. Le comprendre devient un impératif afin de mieux combattre la banalisation de la consommation de stupéfiants en France et ailleurs. Cette consommation affecte nos économies, nos systèmes de santé et même nos démocraties avec les sommes d’argent dont dispose le commerce illégal à des fins de corruption, comme l’expliquait récemment au Point le directeur du Centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants regroupant six pays européens.
Trois exemples de détournement d’outils légaux au profit des narcotrafiquants illustrent comment l’économie légale fournit – parfois sciemment – des instruments de développement des activités criminelles, dont le trafic de stupéfiants. Il s’agit des trust and company service providers, des fournisseurs de messagerie cryptée et des infrastructures portuaires.
Déclarer légalement une entreprise de couverture
Le terme de « sociétés-écrans » revient régulièrement lorsqu’il s’agit de trafic de stupéfiants, qu’elles servent de façade légale pour l’activité illégale ou d’outil de blanchiment de l’argent sale.
Des prestataires légaux, les trust and company service providers (TCSP) (« prestataires de services aux sociétés et fiducies »), offrent en toute légalité des services d’enregistrement et de domiciliation des sociétés et fiducies permettant de garantir l’opacité sur la propriété réelle des entités. En quelques clics sur Internet, il est possible d’immatriculer une société dans une place offshore pour une somme modique et sans même forcément se déplacer.
Ces prestataires agissent en toute liberté malgré des rapports du Groupe d’action financière (Gafi) pointant la responsabilité de ces sociétés dans le blanchiment d’argent. Le Gafi est l’organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
En particulier, ces TCSP peuvent proposer, moyennant finance, des « directeurs désignés » (nominee directors), c’est-à-dire des personnes dont le nom apparaitra dans les registres en lieu et place du nom du véritable propriétaire (beneficial owner). Ils ne disposent d’aucun pouvoir opérationnel et décisionnel dans la société, n’ont pas non plus de droit d’accès ou de regard sur les comptes bancaires de la société : dit autrement, ce sont des hommes de paille. Cette option est évidemment fort appréciée des narcotrafiquants.
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
L’approvisionnement de la France se fait via des organisations internationalisées pour l’import de gros. Ce sont ces organisations qui ont des sociétés-écrans. La lutte est compliquée car elle suppose de s’immiscer dans la souveraineté des places offshore. Le traçage des flux financiers est aussi difficile du fait de la multiplication des juridictions dans lesquelles les sociétés et les comptes bancaires associés sont créés.
Des « WhatsApp » pour gangsters
Les fournisseurs de messagerie cryptés ne peuvent pas non plus se dédouaner de certaines responsabilités. L’opération d’infiltration d’EncroChat menée en 2020 sous l’égide d’Europol et d’Eurojust l’a bien mis en évidence. Elle a permis aux forces de l’ordre de divers pays associés d’accéder à plus de 120 millions de messages cryptés largement émis par des acteurs du narcobanditisme. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs jugé que les éléments collectés ainsi par des moyens classés secret défense pouvaient être utilisés dans un procès sans porter atteinte aux droits de la défense.
C’est grâce à une société légale, EncroChat, vite surnommée « le WhatsApp des gangsters », qu’ils ont été envoyés. Les activités de cette entreprise de télécommunications des Pays-Bas ont cessé en juin 2020 juste après la révélation de l’infiltration du système par les forces de l’ordre.
Aujourd’hui placée sous enquête, l’entreprise proposait des téléphones modifiés aux fonctionnalités propres à attirer spécifiquement des organisations criminelles. Sans micro, ni caméra, ni GPS, ces téléphones n’étaient pas traçables. Ils étaient également reliés à un système de messagerie chiffrée.
Via ce canal, les criminels géraient divers points du trafic : organisation logistique de l’acheminement des stupéfiants, règlements des factures, approvisionnement en armes, location de services illégaux tels que des tueurs à gages… Toutes ces opérations pouvaient être réalisées en des temps record. Outre le cryptage des messages, le système offrait un ensemble d’options utiles aux activités criminelles. On retrouvait notamment la possibilité d’utiliser un code PIN spécifique pour effacer toutes les données du téléphone et pour afficher de fausses interfaces de nature à dérouter les enquêteurs qui se saisiraient de l’objet.
Assurant que l’offre de tels services n’était pas problématique, les dirigeants d’EncroChat ont toujours prétendu que le cryptage, le non-traçage et l’effacement des données répondaient à des besoins typiques des journalistes ou bien des activistes, donc de personnes craignant que leurs actions soient espionnées sans pour autant s’inscrire dans l’illégalité.
L’analyse par les forces de l’ordre des messages interceptés montre cependant que la quasi-totalité d’entre eux conduit à des membres d’organisations criminelles comme la Mocro-Maffia néerlandaise ou le cartel de Sinaloa. Sans boutiques, ni revendeurs officiels, il était d’ailleurs quasi nécessaire d’être coopté par le membre d’une organisation criminelle pour acquérir un « Encro ».
Des ports qui ne s’estiment pas responsables
Nombre de messages décryptés par les autorités concernaient l’organisation du transport des stupéfiants, notamment de la cocaïne. Or le mode principal d’acheminement des drogues reste la voie maritime. Cela pose la question stratégique des zones portuaires et de l’utilisation en ces endroits d’infrastructures légales par des organisations criminelles.
Récemment, l’actualité a braqué les projecteurs sur les ports d’Anvers et de Rotterdam, principaux ports européens et portes d’entrée de la cocaïne en Europe. Des saisies ont toutefois montré que d’autres ports européens sont concernés, en particulier, pour ce qui est de la France, Le Havre, Brest et Montoire-de-Bretagne.
Le commerce mondial ne cesse de croître et passe à 90 % par les voies maritimes. D’après la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) ce sont plus de 11 milliards de tonnes de marchandises qui circulent annuellement dans le monde sur des porte-conteneurs et des vraquiers. Loin de se répartir harmonieusement entre les différents ports, l’activité commerciale maritime est extrêmement polarisée avec de grands ports se livrant une concurrence sans merci pour capter toujours plus de flux.
 Avec seulement 2 % de containers inspectés à Rotterdam, la porte est ouverte pour faire circuler en quantité importante des marchandises illégales. Guilhem Vellut/Flickr, CC BY-SA
Avec seulement 2 % de containers inspectés à Rotterdam, la porte est ouverte pour faire circuler en quantité importante des marchandises illégales. Guilhem Vellut/Flickr, CC BY-SA
Cela se traduit par une course au gigantisme des infrastructures – en réponse aussi au développement des capacités de charge des nouvelles générations de super porte-conteneurs – et à la rapidité de traitement du dépotage des cargaisons. Le port de Rotterdam se targue ainsi de fonctionner 24h/24, 365 jours/365 et de prendre en charge un conteneur toutes les six secondes.
Naturellement, la quête d’une extrême fluidité dans la circulation des marchandises s’accommode mal du ralentissement induit par d’éventuels contrôles sur la nature – légale ou non – des marchandises. Au nom de l’efficience économique, le choix a clairement été fait de peu contrôler : environ 2 % des marchandises seulement sont inspectés, totalement ou partiellement, à Anvers et Rotterdam, au détriment de la sécurité.
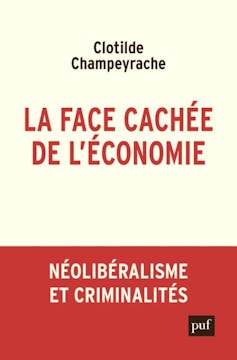
Cela ouvre des possibilités majeures de dissimulation de marchandises illégales au milieu des chargements légaux avec un risque de détection faible. À cela s’ajoutent des stratégies pour dévier d’éventuels contrôles, là aussi en exploitant les failles de l’économie légale. Les organisations criminelles vont exploiter leur capacité de corruption pour obtenir la complicité de professions clefs comme les dockers, les douaniers, les transporteurs. Cette corruption passe par des pots-de-vin mais aussi par des pressions (menaces, éventuelles violences) sur les personnes.
Si le rôle des ports dans l’entrée de stupéfiants sur nos territoires est avéré, la route semble pourtant encore longue pour que les autorités portuaires en endossent pleinement la responsabilité si l’on en croit cet extrait du rapport annuel d’activité 2021 du port de Rotterdam :
« Le crime lié aux stupéfiants au port a régulièrement été dans l’actualité l’année dernière. S’attaquer à la criminalité subversive est un défi posé à la société dans son ensemble qui, à strictement parler, n’est pas de la responsabilité de l’Autorité du Port de Rotterdam. »
Pourtant, une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants doit intégrer le fait que l’économie légale fournit des « facilitateurs » auxquels il convient également de s’attaquer dans une logique d’entrave aux trafics.![]()
Clotilde Champeyrache, Associate Professor in Economics, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
À lire aussi
















