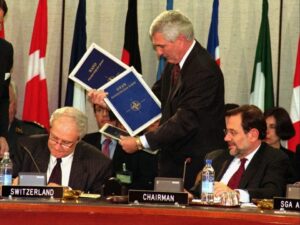Référendum contre la loi Covid: que retenir de la campagne?
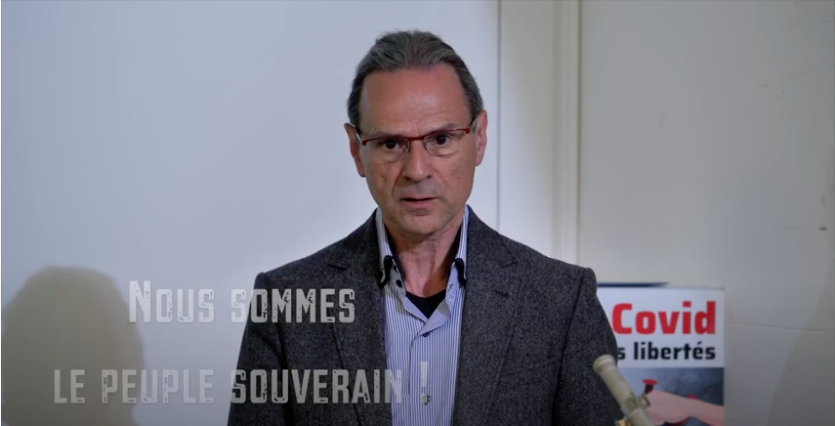
Werner Boxler lors de la conférence de presse des Ami.e.s de la Constitution, le 29 avril dernier. – © DR
De quoi parle-t-on?
En septembre dernier, le Parlement a adopté la loi d’urgence dite loi Covid-19. Cette loi, qui comporte 14 articles, constitue la base légale des arrêtés d’urgence pris par le Conseil fédéral de mars à juin 2020. Depuis lors, la loi a été modifiée à plusieurs reprises. Elle est un fourre-tout : elle régit les questions de l’asile et la fermeture des frontières, l’introduction des médicaments et vaccins sur le marché Suisse, la santé en général, le droit du travail, la culture, les sports, les droits médiatiques et la question des indemnités. La loi sur l’état d’urgence est temporaire jusqu’à fin 2021 et fournit, ne l’oublions pas non plus, une base au gouvernement pour réintroduire la «situation extraordinaire» si nécessaire. Certains articles, principalement ceux qui concernent le volet financier de la crise, sont amenés à prendre fin en décembre 2031. Si la loi est rejetée par le peuple, lors du référendum du 13 juin, elle deviendra invalide, ainsi que tous les amendements, dans un délai de trois mois, soit le 25 septembre.
Les arguments des opposants à la loi Covid-19
Les intervenants de la conférence de presse des «Les Ami.e.s de la Constitution», Astrid Stuckelberger, Philippe Saegesser, Michelle Cailler et Werner Boxer ont porté un regard nuancé sur la crise sanitaire, qui est devenue, à leurs yeux, une crise politique. Ils soulignent trois points:
- Le risque de prolonger les prescriptions par nécessité. Il existe un danger de glisser progressivement vers l’autoritarisme, c’est-à-dire une situation dans laquelle l’État prend ses décisions de moins en moins en consultation avec le peuple. Les opposants font référence à 1939, la dernière fois que la loi d’urgence a été introduite. Il a fallu deux initiatives pour revenir à la démocratie directe. C’était seulement en 1952, 13 ans plus tard.
- La loi Covid-19 crée une inégalité de droits: les personnes vaccinées ne doivent pas être mises en quarantaine, alors que les personnes non-vaccinées le doivent.
- Pour les opposants, cette loi est un «chantage».
Les arguments des partisans
Lors de la conférence de presse du Conseil fédéral, M. Parmelin a surtout insisté sur les indemnités et a dit clairement qu’en cas de NON, le 13 juin, il n’y aurait plus de base légale au versement des indemnités (le «chantage» que dénoncent les opposants). M. Berset, quant à lui, a insisté sur le fait que la loi Covid-19 est essentielle dans le secteur de la santé et qu’elle inclut des mesures garantissant la fourniture de biens médicaux tels que des équipements de protection. Elle sert également de base légale pour la prise en charge du coût des tests et la création d’un certificat de vaccination infalsifiable et uniforme.
Même son de cloche entendu lors de la conférence de presse des partis politiques, unis sur cette question. Aucun des grands partis politiques ne recommande de rejeter la loi le 13 juin, leur principal argument étant le cadre légal des aides financières. Seule l’UDC a décidé de laisser libre choix dans le vote.
Ce que l’on dit peu: une motion au Conseil national sur les aides financières en cas de NON
Le fait est que même en cas de vote négatif, le soutien financier sera maintenu jusqu’au 25 septembre 2021. D’ici là, le Parlement peut transférer la question des indemnités dans une loi distincte ou la garantir par un arrêté fédéral. Cela a été très peu mentionné: une motion à cet effet a déjà été introduite au Parlement le 19 mars dernier, pour assurer le bon déroulement du versement des subventions, et les articles correspondants peuvent être transférés dans une loi ordinaire. La motion de Pirmin Schwander (UDC) au Conseil national demande le transfert des aides financières dans une loi séparée. Un NON à la loi Covid 19 n’aurait donc pas d’impact sur l’indemnisation des entreprises et des personnes touchées par les fermetures forcées.
D’autres critiques
Une étude intéressante a été publiée le 6 avril par le Centre pour la démocratie d’Aarau (ZDA).
L’équipe de la chercheuse en démocratie Sarah Engler montre une image surprenante de la démocratie suisse pendant la pandémie. Le Conseil fédéral a pris le pouvoir d’une manière unique par rapport aux démocraties établies d’Europe centrale et du Nord. De plus, au printemps dernier, la votation prévue pour la mi-mai a été reportée sans ménagement à l’automne, sans que l’exécutif ne dispose d’une base d’autorité claire pour le faire, comme le souligne l’avocate bâloise Nadja Binder Braun dans un rapport d’expertise. Dans l’indice de l’étude ZDA, la Suisse se classe à proximité de l’Albanie, de la Croatie et de la Roumanie.
Et chez nos voisins
En ce moment même en France, le parlement discute d’un projet de loi sur un nouveau régime transitoire, permettant au gouvernement de maintenir fermés un certain nombre d’établissements recevant du public et qui se garde le droit, si la situation venait à se dégrader, de déclarer à nouveau l’état d’urgence sanitaire. La France est loin d’entrevoir la fin des dispositifs légaux d’urgence.
Le Parlement et le Bundestag en Allemagne ont adopté, il y a deux semaines, une loi «frein d’urgence fédérale» qui permet au gouvernement de Berlin de décréter des fermetures d’écoles, magasin, musées etc,. et d’instaurer un couvre-feu national, si jamais la situation venait à se dégrader. Et ce dans un pays où les «Bundesländer» ont toujours bénéficié d’une grande indépendance dans la gestion de la crise.
Nos deux grands voisins discutent et votent donc des lois qui centralisent le pouvoir dans les mains de l’exécutif. Loin du peuple. Dans ces deux pays — d’une haute qualité démocratique —, la concentration des pouvoirs est manifeste. Et le risque est aussi présent en Suisse, puisque le Parlement a tendance à suivre inconditionnellement le Conseil Fédéral.
Electeurs, informez-vous!
Le parti pris de notre politique et la présentation potentiellement inexacte ou tronquée des faits par les médias influencent grandement l’attitude des Suisses. Bon pour la Tête s’est efforcé de donner des pistes de réflexions durant cette pandémie, a parlé dans ce journal non seulement des «Ami.e.s de la Constitution» mais aussi de tous les collectifs et associations qui se sont créés durant la pandémie. La mobilisation civile est considérable. Une preuve en est aussi ce récent dépôt du 22 avril 2021 au Parlement d’une pétition de plus de 50’000 signatures, demandant au gouvernement de créer une commission d’enquête extraparlementaire indépendante chargée d’examiner la déclaration de l’état de situation extraordinaire.
Il revient donc aux électeurs de s’informer. Sur la question du vote de la loi Covid-19, le seul moyen d’y voir clair, est, par exemple, de regarder soi-même les conférences de presse.
À lire aussi