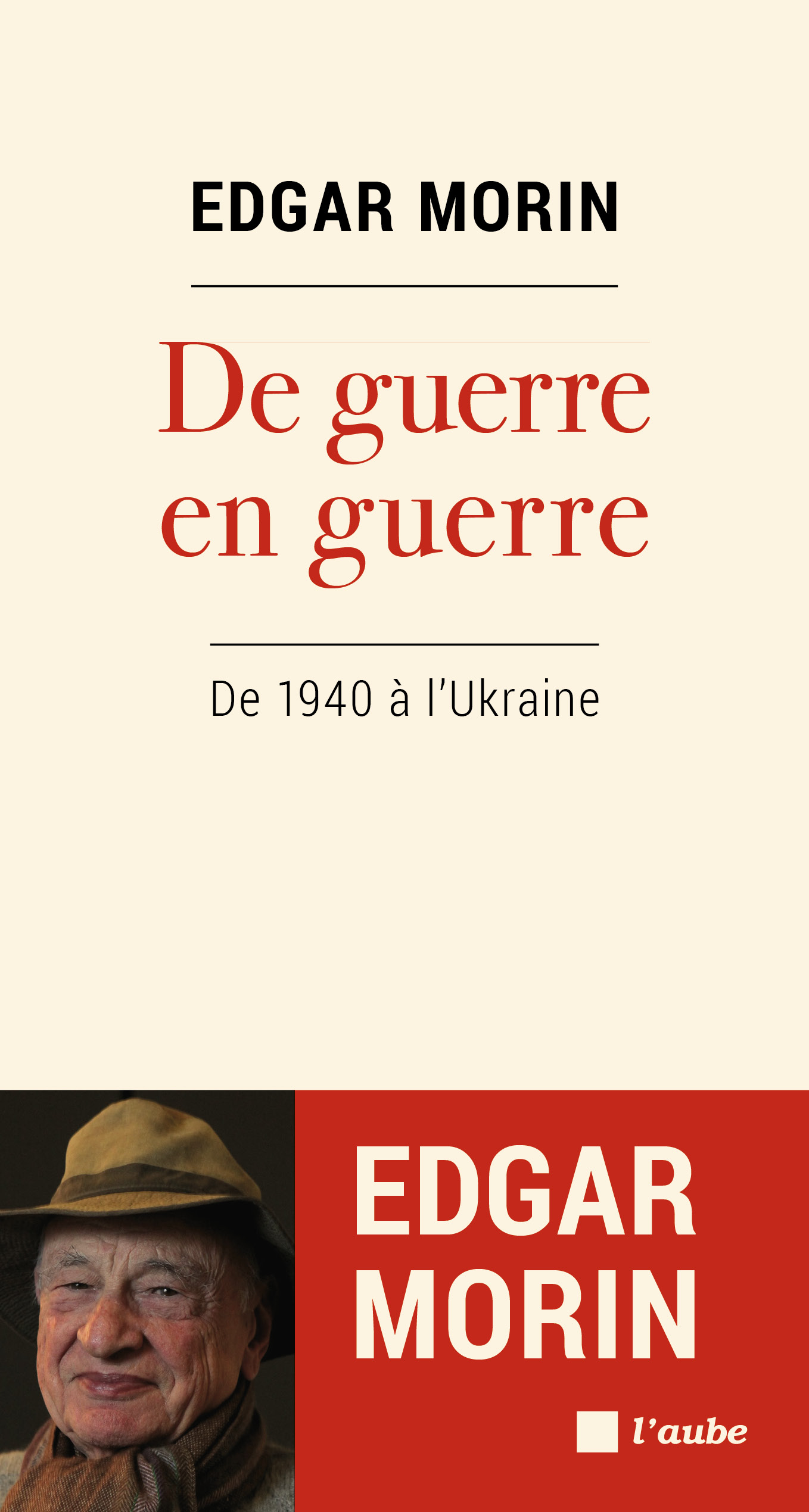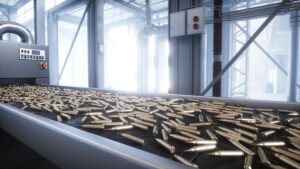Morin: «De guerre en guerre, de 1940 à l’Ukraine»

Dresde. Les cadavres de victimes après les bombardements aériens des 13 et 14 février 1945. Derrière, les ruines des bâtiments détruits. – © Bundesarchiv
Edgar Morin raconte sa réaction en traversant les villes détruites par les Alliés à la toute fin du conflit, alors qu’ils avaient déjà gagné. Se disant simplement: «C’est la guerre». La petite Pforzheim, 17’000 morts, où il fut en poste. La grande ville d’art, Dresde, 300’000 morts, sans parler des autres. «C’est bien plus tard – depuis l’invasion de l’Ukraine – que monta en moi la conscience de la barbarie des bombardements accomplis au nom de la civilisation contre la barbarie nazie.» L’Allemagne nazie a commis des crimes effroyables. L’URSS qui se saigna pour l’abattre fut coupable, là aussi, d’atrocités. Mais comment ne pas penser à «l’anéantissement aveugle de centaines de milliers de civils par les aviations alliées»? Réponse sobre: «Il a fallu que des années, des décennies s’écoulent pour qu’il devienne clair que si juste que fut la résistance au nazisme, la guerre du Bien comporta du Mal en elle.»
Suivent ensuite quelques courts chapitres éclairants. Sur l’hystérie de guerre, «faite de la haine de l’ennemi et de sa totale criminalisation», telle qu’elle apparut en 1914-1918. Sur les mensonges de guerre. Le plus sordide, celui de Staline, qui attribua aux nazis le massacre des officiers polonais à Katyn, perpétré en fait par les Soviétiques. Il y en eut, jusqu’à aujourd’hui, tant d’autres. L’espionnite, la chasse aux traîtres avérés ou supposés. La criminalisation globale du peuple ennemi, de sa langue, de sa culture.
En philosophe et historien, Morin démonte aussi le mécanisme de la radicalisation de la guerre. L’escalade dans sa propre dynamique, échappant à toute raison. Ce fut maintes fois le cas, aussi bien lors de la guerre d’Algérie que dans le conflit israélo-palestinien ou l’éclatement de la Yougoslavie. A chaque fois les camps ennemis se persuadent qu’il n’y a qu’une seule issue possible, la victoire. Mais quelle victoire? Et pour quel lendemain? En s’accrochant à leur récit, sans le contextualiser, enfermés dans une version volontairement simpliste, les belligérants, de part et d’autre, peuvent se réserver de mauvaises surprises. «A considérer le siècle précédent et le nôtre jusqu’à présent, je peux certifier que tous les événements majeurs ont été inattendus», assure Morin qui en dresse la liste. Avec une exception cependant: en 2014, après la révolution de Maidan, il avait écrit que l’Ukraine allait se trouver dans une situation explosive. Ce furent en effet huit ans de guerre civile dans le Donbass. Puis l’agression russe du 24 février 2022.
Que les chasseurs de «poutinophiles» masqués passent leur chemin. Morin n’a pas la moindre complaisance envers le Kremlin. Mais il résume froidement la situation: «il y a trois guerres en une: la continuation de la guerre interne entre pouvoir ukrainien et province séparatiste, la guerre russo-ukrainienne, et une guerre politico-économique internationalisée anti-russe de l’Occident animée par les Etats-Unis.» Et il conclut sur la nécessité impérative et urgente du dialogue. Mais voilà… «Parler de cessez-le-feu, de négociations, est dénoncé comme une ignominieuse capitulation par les belliqueux, qui encouragent la guerre qu’ils veulent éviter à tout prix chez eux.» Il s’étonne que les Européens, les premiers concernés, manifestent si peu de volonté à imaginer et promouvoir une politique de paix.
Cet ouvrage, clair et vite lu, est à mettre entre toutes les mains. Car outre ses réflexions, l’auteur résume en quelques pages le défilé des guerres européennes et mondiales de 1914 à nos jours. Mieux qu’aucune école ne peut le faire. Les cancres en histoire n’ont plus d’excuses.
«De guerre en guerre. De 1940 à l’Ukraine», Edgar Morin, Editions de l’Aube, 100 pages.
À lire aussi