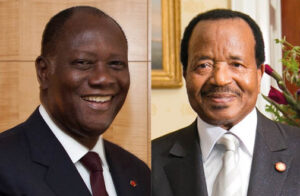Les blessures profondes de la France

« La France victorieuse » (1814), François-Antoine Gérard, Jardins du Carrousel. – © DR
Pour ce faire, Werly n’a pas couru les think tanks et les états-majors de partis à Paris. Il a sillonné le terrain, des mois durant, le long de la ligne (1’200 km de la frontière suisse à l’Espagne) qui séparait la France occupée et la «zone libre», entre juin 1940 et mars 1943. Au lendemain de la défaite de juin 1940, la France se trouvait cassée, humiliée, épuisée. Elle sut pourtant, dans les décennies qui suivirent la fin de la guerre, se redresser et s’affirmer. Comment? Par la force des messages politiques? En partie, pas seulement. Par «l’héroïsme» aussi des petites gens, du peuple anonyme qui se mit au travail pour survivre, repartir, trouver enfin un certain confort. Sera-ce possible, une fois encore, dans cette France prise aujourd’hui pour une grande part dans le vertige du déclin, de la colère et de la haine?
Richard Werly était l’autre jour désigné par l’ambassadeur de Suisse à Paris comme «le plus suisse des Français et le plus français des Suisses», honoré en l’occurence par la médaille de «chevalier des Arts et Lettres». Cette double appartenance, familiale et professionnelle, lui a permis d’aborder les états d’âme de nos voisins avec à la fois recul et intime proximité, avec une empathie qui l’a fait plonger au cœur des drames et des espoirs. De petites villes en villages, sur cette ligne de démarcation près de laquelle il passa son enfance, Werly a écouté les élus locaux, les attablés des cafés, les passants plus prompts à parler d’eux que les Parisiens fixés sur leur portable. Et le tableau est sombre. Les petits commerces qui ferment, les médecins qui se font rares, les trains qui se font attendre, les fins de mois qui inquiètent, les traites des crédits en retard, les petits paysans sans relève, les jeunes qui s’en vont vers les villes plus prometteuses… Une colère sourde qui subsiste après l’évanescence des «gilets jaunes». La haine? Leur éphémère pasionaria, Ingrid Levavasseur, s’explique posément: «C’est le système qui nous pousse à cette haine. On se dit d’abord que tout ça est de notre faute, qu’on n’y arrive pas parce qu’on est trop mauvais, trop peu compétents, trop peu ceci trop peu cela. Puis l’on réalise qu’ils se sont foutus de nous, que la réalité que nous vivons n’est pas celle qu’on voit à la télévision. Ce que l’on finit par haïr en France, ce n’est pas l’autre: c’est la réalité que nous affrontons parce que personne ne nous aide à la surmonter. On ne peut pas passer sa vie à accepter une défaite qui, après tout, n’est pas la nôtre.»
La défaite. Werly tient son lien entre les deux époques. «La France de 1940 est assommée par une défaite militaire impensable, et pourtant on ne peut plus réelle. La France de 2021, en tout cas une partie d’elle, se croit condamnée à la défaite. Ce n’est pas la même chose, mais…» Il évoque alors par le détail cet épisode historique. Cette ligne de démarcation par laquelle on tentait de fuir du Nord au Sud, croisement des combinards véreux et des résistants solidaires. La compromission des uns, l’abnégation des autres, la rencontre des courages et des lâchetés. Curieusement, la mémoire est négligée de cette fracture, avec son lot de tragédies – comme ces 26 Juifs tués et jetés au fond d’un puits par des miliciens pro-nazis, forfait que les habitants du lieu refusent aujourd’hui de marquer par une plaque «pour ne pas raviver les tensions». Avec aussi des gestes de dévouement admirables. Bien peu s’arrêtent à la médiathèque de Vichy qui les remémore et auprès d’autres petits musées où des obstinés sauvent de l’oubli images et témoignages. Ignorés parce qu’ils ne sont pas assez glorieux?
On a beaucoup parlé d’un archipel qui diviserait la France entre communautés d’origines diverses et antagonistes. Une vieille dame qui a vécu cette époque interpelle Werly: «C’est quoi votre histoire d’archipel? C’est parce que les gens ne se parlent plus qu’ils ont le sentiment de ne plus vivre dans le même pays.» En cause notamment, le vacarme médiatique. La télévision est une messe et on ne se parle pas beaucoup à la messe. Le journaliste arpenteur se défend de son pessimisme. Il veut croire que «la France du vide, si elle se remplit à nouveau d’emplois, de population et de convivialité, engendrera mécaniquement des passerelles entre les îles de l’archipel français…»
Mais cette mécanique-là, il faudra plus que des discours pour la mettre en marche. Quand le président Macron, au fond des provinces, devant des maires désemparés, martèle le mot «confiance», il voit des mines atterrées devant lui. Les Français ont un rapport contradictoire à l’Etat, sûrement pas dominé par la confiance. Ils en attendent beaucoup, trop peut-être, et en même temps sont excédés par son pouvoir sur leur vie quotidienne. Tracasseries administratives de toutes sortes, empilement confus des compétences entre les communes, les rassemblements de communes, les régions et le dédale des pouvoirs gouvernementaux. Macron n’est pas le premier à avoir promis la simplification, mais on ne l’entrevoit guère. D’où peut-être la tentation chez certains de voir émerger carrément un homme fort, ou une femme à poigne, qui ferait marcher tout le monde au pas. On se souvient des foules qui acclamaient Pétain au cri de «Maréchal, nous voilà!» Résonnance aujourd’hui? «Comment ne pas constater une certaine résonance, entre le débat actuel sur la mondialisation et la prétendue mainmise de l’Union européenne sur la France… et l’idéologie de la révolution nationale pétainiste fondée sur le triptyque souverainiste “Travail, Famille, Patrie”?»
La France n’en est pas là. Mais elle ferait bien, suggère Werly, de se souvenir de son passé qui peut, par certains côtés, éclairer le présent et même donner des raisons d’espoir.
Et si la Suisse aussi cultivait mieux sa mémoire, si possible débarrassée des mythes trop flatteurs? Même avec une histoire totalement différente, avec un système politique aux antipodes de la France, l’exercice serait salutaire. On y apprendrait le sens critique face aux discours trop rassurants, la dignité des efforts passés qui renvoient à ceux promis pour demain à tous les Européens.
«La France contre elle-même. De la démarcation de 1940 aux fractures d’aujourd’hui», Richard Werly, Editions Grasset, 234 pages.
À lire aussi