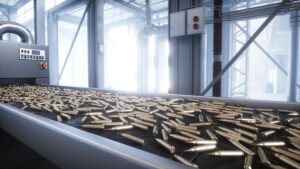La paix? Un gros mot!

Le Secrétaire d’Etat américain à la Défense Lloyd J. Austin III et le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov lors d’une réunion stratégique au siège de l’OTAN, le 15 juin 2022. – © US Secretary of Defense/Source officielle
De quelle victoire parle-t-on? Chasser jusqu’au dernier soldat russe du territoire ukrainien tel qu’il était tracé avant 2014? Aucun stratège réaliste n’y croit. La Crimée, vieille terre russe, le restera, selon l’évidente volonté de ses habitants. Les républiques séparatistes, lieux de toutes les tensions et de toutes les agressions depuis huit ans, charnières ultra-sensibles des deux frères ennemis, ne retourneront pas sous l’autorité exclusive de Kiev. Leur trouver un statut autonomiste est plus difficile que jamais mais c’est bien la seule voie imaginable à long terme.
Parler de paix? C’est devenu un gros mot, une provocation, une lâcheté. Pas seulement dans les pays les plus engagés, en Suisse aussi. Dernier en date: le malheureux Martin Baume, conseiller national zurichois, Vert-libéral, essuie une pluie de critiques acerbes pour avoir plaidé en faveur d’un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine, pays auquel il est très attaché. Sa femme en est originaire. Le «Tagi» l’interroge sur le ton réservé aux suppôts de Poutine, qu’il condamne pourtant sans ambiguïtés. Il veut maintenir cet espoir, non pas tant pour sauver l’économie européenne, mais d’abord pour mettre fin aux souffrances des peuples pris dans la tornade. Mais pan sur le bec!
Dans l’excitation belliqueuse entretenue aujourd’hui, songer à l’avenir est vu comme une dérobade. On est passé près pourtant du versant de l’espoir. Quelques jours seulement après le déclenchement de la guerre, il fut sérieusement envisagé, à Kiev comme à Moscou, de stopper la machine infernale. Avec les négociations d’Istanbul.
Pour préparer la rencontre, le chef de la délégation ukrainienne souhaita l’avis d’un connaisseur occidental de la Russie, l’ex-chancelier Gerhard Schroeder. Il l’approcha par l’intermédiaire du CEO de Ringier à Zurich, Marc Walder. Le contact a été établi en Turquie. Schroeder s’entretint aussi avec le négociateur russe. La négociation formelle était plus que difficile à mettre en route. Quelques palabres par vidéo, quelques échanges de notes… Les partenaires étaient loin d’une franche discussion autour de la table mais peu à peu s’esquissaient des solutions. Neutralité de l’Ukraine, garantie par les puissances européennes, départ des troupes russes, statut d’autonomie pour les provinces séparatistes. Quant à la Crimée, il était question d’un nouveau référendum… dans quinze ans. Le journal allemand Bild Zeitung, fréquemment utilisé par les communicants de Zelensky pour faire passer le point de vue de Kiev en Allemagne, alla jusqu’à titrer: «La paix? Peut-être dans quelques jours!»
L’ami allemand de Poutine lui rendit visite à Moscou. Celui-ci lui dit qu’il était favorable à un tel accord mais qu’il doutait, dans le jeu des rapports de force internationaux, qu’il puisse voir le jour.
Cela se confirma. Soudain, malgré les efforts du président Erdogan, tout fut gelé. Pas de déclaration de rupture, mais pas de nouvelles dates pour poursuivre les tentatives d’accord. Les négociations étaient soudain enterrées. Pourquoi?
Il y avait au Kremlin des durs qui les voyaient d’un mauvais œil mais Poutine avait les moyens de les contenir. A Kiev en revanche, tout un pan du pouvoir, l’aile nationaliste la plus déterminée, très présente au sein de l’armée, était hostile à tout accord. Mais en fait, ce sont les Américains qui sifflèrent la fin de la bien précaire récréation. Leur influence, pour ne pas dire leur autorité, sur le gouvernement ukrainien ne date pas d’hier mais elle se trouva plus déterminante que jamais avec le déclenchement du conflit. Il n’était dès lors plus question de trouver quelque «solution» mais d’affronter la Russie jusqu’à la mettre à genoux. Dans une guerre menée par procuration, avec des afflux d’armes et d’argent, avec l’envoi de «conseillers» et de mercenaires divers, mais sans risquer la vie d’un homme en uniforme de l’OTAN.
Après ces mois d’horreurs, il sera infiniment plus difficile de renouer un dialogue. Et pourtant, un jour, il le faudra bien. Même si, pour l’heure, l’Occident tente de dresser un nouveau rideau de fer face à la Russie.
La question du gaz illustre avec ironie nos contradictions. Même après les premières sanctions, Poutine assurait que les contrats de Gazprom seraient honorés avec tous ses clients, amis ou pas. Vint alors une déclaration solennelle: le but ultime de l’Occident est de renoncer totalement aux hydrocarbures russes. La réponse de Moscou a une certaine logique: si désormais vous voulez fermer le robinet, quand et où vous voulez, à votre guise, nous pouvons faire de même… Et voilà que plusieurs pays, Allemagne en tête, tremblent à l’idée de se trouver privés de chauffage l’hiver venu. Les coups de gueule, les réactions à chaud, cela plaît au public sur le moment, mais mieux vaudrait réfléchir aux décisions politiques à moyen et long terme. Celles qu’a prises l’UE dans la hâte ne freinent pas Poutine, on le sait, mais porteront des coups d’une gravité extrême à son économie.
Voilà donc l’Europe dans le désarroi. La Russie aussi. Elle peine au plan militaire, son armée révèle ses faiblesses, le peu de motivation des troupes, les problèmes de commandement, la vétusté de ses équipements. La grande puissance dont on nous répète qu’elle menace tout le continent – même l’Espagne renforce sa défense! – arrive tout juste à grignoter quelques minuscules territoires dans le Donbass et au sud après des mois de combats. Face à une Ukraine puissamment déterminée à se défendre mais qui est aussi menacée d’épuisement. Les sanctions se distinguent, comme tant de fois dans l’histoire, par leur inefficacité. Elles causent certes des problèmes aux pays visés mais n’ébranlent pas le moins du monde les régimes que l’on souhaite voir tomber. En revanche, dans ce cas, elles entraînent des casse-têtes chez les Européens. Pas seulement du côté des énergies. Pas seulement du côté de l’inflation qui a maintes autres causes. Mais plus largement au plan géopolitique: les Occidentaux découvrent que de vastes pans du monde, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, n’entrent pas dans leur discours et tendent plutôt à se distancer d’eux, notamment au plan monétaire.
Le grand projet d’une organisation de la sécurité et de la coopération en Europe (OSCE) est mort du fait de la négligence occidentale, puis du déclenchement de la guerre où la Russie, elle aussi, s’est montrée singulièrement irréfléchie. Le bilan des Nations Unies n’est pas plus réjouissant. Que son système n’ait pas pu stopper le conflit était attendu. Mais même ses plus modestes tentatives de panser quelques plaies ont échoué: ce sont les Turcs et les Russes qui œuvrent à libérer l’exportation des céréales par la mer Noire, pas l’ONU.
Les risques d’une guerre à coups de missiles intercontinentaux, évoqués de part et d’autre, sont minimes. Ce n’est pas cette apocalypse qui nous menace. Mais bien un pourrissement généralisé des relations internationales à partir de l’abcès ukrainien. Au fur et à mesure que ses effets se manifesteront, assistera-t-on, au-delà des déclarations passionnées, à un progressif retour à la raison? On ne peut que l’espérer, sans grandes illusions. Et cela ne peut passer que par la négociation entre les belligérants, l’urgence absolue à cette heure.
À lire aussi