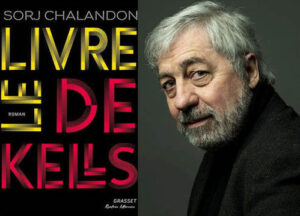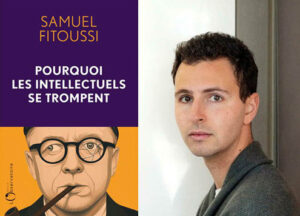La boîte à outils de Dantzig n’est (très) utile qu’à l’inutile

Edward Burne-Jones, « Le Miroir de Vénus », 1875. – © Museu Calouste Gulbenkian
C’est d’abord une question de langage, vu que le mot a un double sens évoquant la polysémie des mots-valises, lesquels mériteraient eux aussi une théorie de théories à la Dantzig. On a bien lu: théorie de théories et non théorie des théories, étant établi que la théorie, complot de l’intellect humain, désigne aussi son dénombrement. Il y a de fait, au monde, plein de théories comme il y a, sur terre, une théorie d’humains dont certains sont de véritables théories sur pattes.
J’en connais un qui est le parangon du genre, en la personne de l’écrivain ex-libraire et ex-éditeur à L’Age d’Homme Claude Frochaux, auteur du formidable maelstrom théorique de L’Homme seul et qui théorisait déjà à plein régime dans sa petite librairie d’anar du vieux quartier de Lausanne, il y a de ça plus de cinquante ans.
Or notre ami Claude me soutenait une fois de plus, l’autre jour, comme nous évoquions l’évident déclin de la littérature actuelle de langue française par rapport à celle de la première moitié du XXe siècle, que l’année 1960 marquait un tournant, pour les créateurs contemporains, écrivains et artistes, au-delà duquel les natifs de millésimes ultérieurs n’avaient plus guère de chance d’égaler leurs aînés…
Point d’écrivain remarquable né en 1970, en 1975, en 1980 voire en 1990? Hélas non selon la théorie de Frochaux. Et Charles Dantzig n’y échapperait même pas, puisqu’il est né en 1961…
Pour ma part, je ne crois pas un instant à la validité de cette théorie, et pourtant elle me dit quelque chose, et d’abord sur Frochaux lui-même, raisonnant comme pas mal de gens de sa génération d’accord pour répéter «après nous le déluge», estimant que la Grande Culture Occidentale a pris fin avec les années 60-70 correspondant à leur propre jeunesse, sans regarder vraiment ce qui s’est fait après eux; et ensuite pour ce que représente la notion même de théorie, et plus encore la notion de réalité augmentée dont parle la Littérature depuis des siècles, et probablement pour d’autres siècles à venir, dont Charles Dantzig scrute les mille facettes avec une fantaisie imaginative qui fait la pige à la théorie de Frochaux et de ses semblables fossoyeurs.
Rappel à ce propos: quand on demandait à Soljenitsyne ce qu’il pensait de la mort du roman, il répondait que le «roman», sous quelque forme que ce soit, vivrait tant que l’homme vivrait…
Comme un immense inventaire sensible
Je suis revenu à Charles Dantzig après deux ou trois ans d’éloignement voire de rejet. Après son éblouissant Dictionnaire égoïste de la littérature française, le volume suivant, intitulé Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale, m’avait déçu. Le premier m’avait parfois agacé par ses faiblesses occasionnelles de jugement, ses exécutions sommaires (notamment de Céline) et ses appréciations superficielles voire débiles, mais c’était peu de chose par comparaison avec le deuxième opus accumulant les énormités sur Dostoïevski, Hemingway, Dante ou Ezra Pound, entre tant d’autres, assez insupportable aussi par la morgue narcissique et le ton crâne et désinvolte de l’auteur.
Cependant, me suis-je aussi dit, la lecture de Dantzig est si multiple qu’il y a aussi du bon dans ses pires pages, et puis il évolue (comme nous toutes et nous tous) et bonifie à ce qu’il me semble, comme je l’ai remarqué, par la suite dans son ébouriffante Encyclopédie capricieuse du tout et du rien et, plus récemment, dans son Traité des gestes.
Je me rappelle maintenant ce que me disait Patricia Highsmith de Simenon, qu’elle respectait d’abord pour son humble assiduité au travail. Et c’est ce que je dirai aussi de Dantzig: qu’il travaille et que, bien au-delà de ce que le labeur peut avoir de seulement laborieux, son travail relève de l’envol du savoir et de l’hypersensibilité poreuse, puis du crawl joyeux d’un poisson-volant littéraire en haute altitude poétique – cette image un peu kitsch me venant d’une autre relecture récente, de la Lettre aux hirondelles et à moi-même du génial Ramón Gómez de La Serna, auquel Dantzig s’apparente à mes yeux de lecteur-abeille faisant miel d’un peu tout.
Or reprenant ces jours la lecture de Théories de théories, qui m’a d’abord agacé, je me suis surpris à m’y intéresser de plus en plus, malgré de nombreux désaccords relevant de l’opinion ou du goût, puis y trouvant de plus en plus de points de rencontre et me réjouissant même de n’être pas d’accord avec l’auteur.
Dès l’introduction de Théories de théories, Dantzig rappelle donc le double sens du mot, et le lecteur fera, dans la foulée, la distinction entre théorie et système (la première n’aboutissant pas forcément au second), théorie et idéologie, théorie et opinion, théorie et discours ou conversation, théorie et argumentation ou prédication, le livre modulant bel et bien, et sur tous les tons, les multiples aspects et acceptions de ce prodigieux produit de l’imagination humaine, dans une perspective poétique immédiatement balisée par les titres des diverses sections de l’ouvrage, à savoir: Fluide, Satin, Girouette, Trompette, Griffe, Fouet, Fers, Bouche, Miroir, Coffre, Caresse, Ivresse, Baume – chacun de ces titres n’ayant (presque) aucun rapport logique ou «évident» avec les théories qu’il regroupe, qui sont d’ailleurs des variations «musicales» sur des motifs thématiques plus que des théories.
Ainsi des sections Trompette (théories de la barbe, des excentriques, des grandes vieilles actrices de théâtre ou des gens), de Fers (théories de la brutalité visuelle, des placards, du confinement ou théorie d’instructions aux enfants), et, pour le détail – le détail étant ce qui compte le plus chez Dantzig – dans Satin, la théorie des 666 fenêtres donnant sur les fantasmes érotiques de l’amateur de mecs décoratifs, la théorie de l’homme qui aimait la lune dans la section Girouette, ou bien encore une splendide évocation de la peinture de Francis Bacon, un autre succulent morceau avec la théorie du second Gatsby, des coups de canif aux salauds (Griffe) et, dans la section Caresse, de superbes développements sur le génie, la nécessaire folie de l’écrivain ou l’amusement en art qu’on retrouve chez Manet (son dieu pictural), Balzac, Shakespeare ou Oscar Wilde évidemment, etc.
Je m’étais dit un jour que, finalement, Charles Dantzig serait sauvé par la poésie ou par la galaxie littéraire anglo-saxonne, et je vois ici que cela s’avère un max…
Quand le grand art s’amuse
Il y a de nombreux personnages en colocation dans la maison Dantzig, et sa théorie du moi (dans la section Miroir) n’est éclairante qu’en mince partie alors que l’autoportrait se trouve réfracté par le livre entier à travers les adhésions et les rejets de l’écrivain qui ne cesse de déborder à tout moment et partout comme un fleuve follet, à la fois gamin (Théories TOTO) et sûrement homme blessé à l’intime, journaliste et philologue, moraliste et fantaisiste, pratiquant l’esprit de finesse ou piétinant plus lourdement dans l’argument, érudit sourcilleux et chantre folâtre de l’inutile ou militant LGBT plus convenu – mais ses contradictions nous l’attachent finalement à proportion de son originalité revendiquée et réelle.
Le meilleur de l’écrivain me semble dans son art de l’évocation autant que dans sa passion du détail, cocasse ou touchant, et sa façon de tout classer sur ses rayons comme des pots de confitures, et de les étiqueter avec des formules, des aphorismes, des éléments de jugements parfois réducteurs et parfois irrésistibles de drôlerie, dans la filiation du Journal de Jules Renard, des maximes de La Rochefoucauld ou des pensées cyniquement lucides de Chamfort.
Dans ma dernière chronique, j’ai parlé du foisonnant «rastro» d’Antonio Muños Molina, autre inventaire de la ville-monde qui rappelle la brocante merveilleuse (tel étant le sens du mot espagnol rastro, titre d’ailleurs d’un livre de Ramón Gómez de La Serna) où grappille l’auteur du Promeneur solitaire dans la foule.
Quoique plus proche de Voltaire que de Rousseau, Charles Dantzig, meilleur poète en prose qu’en vers (un peu comme Rimbaud, dont il dit la même chose…), partage enfin, avec un Philippe Sollers (avec la même suffisance française de baron des lettres et de l’édition, en tout cas pour la galerie) un réel amour de la Littérature et du Grand Jeu à laquelle notre enfance prolongée est conviée, aujourd’hui plus que jamais et, théoriquement, «pour toujours»…
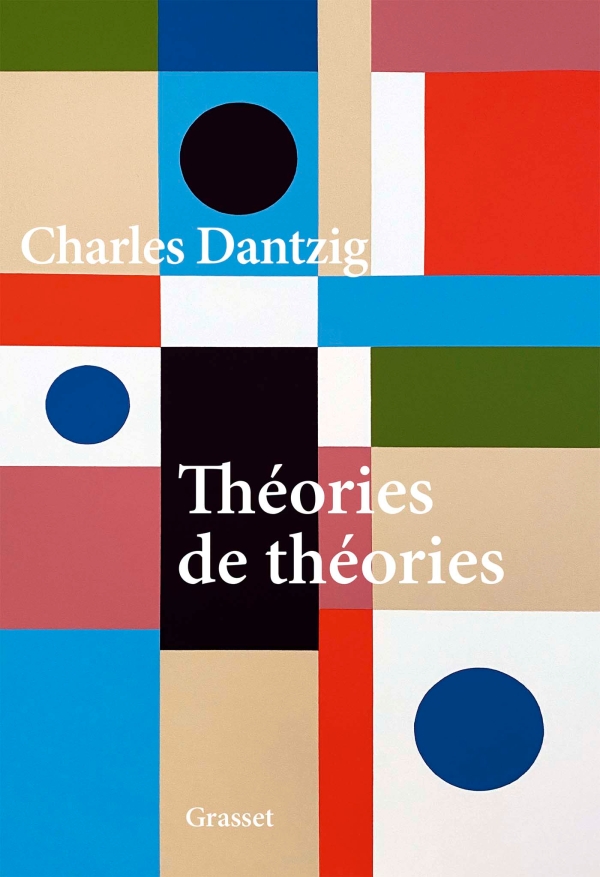
Théories de théories, Charles Dantzig, Editions Grasset, 406 pages.
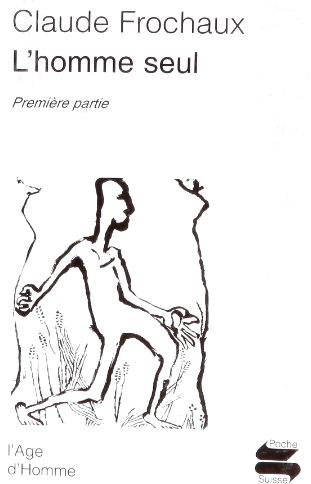
L’Homme seul, Claude Frochaux, L’Age d’Homme (Poche Suisse), 336 pages.
À lire aussi