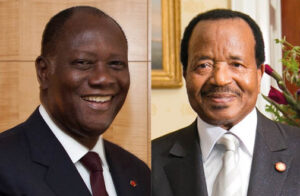Kenya: la révolte des jeunes

Contre la corruption, le népotisme et le FMI: de jeunes Kenyans manifestent à Nairobi. © cc-by Katie G. Nelson / Getty Images
Philippe Stalder, article publié sur Infosperber le 7 août 2024, traduit par Bon Pour La Tête
Protus Onyango est reporter politique pour The Standard, le plus ancien et deuxième journal du Kenya. Il suit le mouvement de protestation depuis ses débuts.
Philippe Stalder: Depuis des semaines, nous recevons du Kenya des images de jeunes gens qui descendent dans la rue pour protester contre le gouvernement. Que se passe-t-il exactement ?
Protus Onyango: Les manifestations actuelles sont historiques pour le Kenya. Ce que cette jeune génération a réalisé, personne ne l’avait fait avant elle. Jusqu’à présent, les manifestations de l’opposition se déroulaient généralement dans un seul endroit. Mais ces jeunes manifestants ont été en mesure de mobiliser simultanément plusieurs millions de personnes dans toutes les villes moyennes et grandes du pays.
Ils avaient même réussi à accéder au Parlement, où certains d’entre eux s’étaient livrés à des émeutes. Les forces de sécurité ont été complètement prises au dépourvu, c’est pourquoi elles ont commencé à tirer sur la foule. 50 personnes ont alors été tuées. Mais les manifestants maintiennent leurs revendications, ils veulent que Ruto (William Ruto, 57 ans, président du Kenya depuis septembre 2022, ndlr) démissionne et dissolve son gouvernement.
Quel a été l’élément déclencheur de ces manifestations?
Le déclencheur de ces protestations nationales a été la nouvelle loi de finances que le président Ruto a présentée au Parlement à la mi-juin. Ce projet de loi propose des modifications au système fiscal qui entraînent de nombreuses hausses d’impôts. La monnaie nationale du Kenya, le shilling, se déprécie rapidement depuis 2023 et le coût de la vie augmente jusqu’à devenir insupportable.
Le président Ruto a remporté de justesse les élections de 2022 en promettant de faciliter la vie des pauvres. Il voulait s’attaquer à la menace de la crise de la dette en augmentant les impôts, une mesure dont les plus pauvres auraient le plus souffert. Par exemple, la taxe sur les carburants devait passer de 8 à 16%, ce qui a des répercussions directes sur les coûts des transports publics. Un impôt devait également être prélevé sur le trafic de données sur Internet. La jeune «génération Z» a été particulièrement indignée par cette mesure. Ce sont surtout les représentants de cette génération qui organisent les protestations.
Outre la loi de finances, quelles sont les autres causes?
Il y a un large mécontentement face au taux de chômage élevé et à la corruption dans l’attribution des emplois. Le népotisme et le tribalisme, en particulier, font qu’il est difficile pour les demandeurs d’emploi sans relations de trouver un bon travail. De nombreux jeunes diplômés ne trouvent pas d’emploi dans leur domaine pendant des années. Les jeunes sont désillusionnés sur le plan professionnel et ne veulent plus être une charge financière pour leurs parents. En outre, l’opposition accuse Ruto de fraude électorale, car celui-ci a été élu en 2022 avec une faible avance de 200’000 voix seulement. Nombreux sont ceux qui se demandent si Ruto a légitimement accédé au siège présidentiel. Et sa réaction aux protestations est également vivement critiquée: plus de 70 personnes ont été tuées par les forces de sécurité au cours des dernières semaines ou ont disparu sans laisser de traces.
Quel est le rôle des médias sociaux dans le mouvement de protestation?
Les médias sociaux jouent un rôle central. Non seulement dans la mobilisation et l’organisation des manifestations, qui n’ont d’ailleurs pas seulement eu lieu à Nairobi mais dans toutes les grandes villes. Mais aussi dans la diffusion d’informations critiques à l’égard du gouvernement. Autrefois, la plupart des gens n’auraient même pas remarqué que le ministre de l’Agriculture, par exemple, recrutait tous ses principaux collaborateurs au sein de son ministère, bien que cela soit contraire à la Constitution. Aujourd’hui, de telles informations se répandent comme une traînée de poudre sur Tiktok et Instagram.
Les générations plus âgées soutiennent-elles aussi les manifestations?
De nombreuses personnes âgées sont également mécontentes de la corruption depuis un certain temps déjà et disent aux jeunes générations de ne pas se laisser faire. Car les plus anciens ont fait l’expérience, lors de précédentes manifestations, de l’absence de réponse politique à leurs revendications. C’est pourquoi beaucoup sont fiers de leurs enfants: l’élite politique a pour la première fois été mise face à ses responsabilités.
Les partis d’opposition sont-ils derrière ce mouvement?
De nombreux politiciens de l’opposition qui avaient voté contre la loi de finances se sont solidarisés avec les manifestants, même si la plupart d’entre eux ne se rattachent à aucun parti. Beaucoup sont également sceptiques vis-à-vis des politiciens de l’opposition, car ceux-ci profitent tout autant du système politique. Ils ne veulent pas qu’un politicien de l’opposition vienne s’emparer de ce mouvement pour se mettre en avant.
Qui a donc organisé les manifestations?
Il s’agit effectivement d’un mouvement de base, sans leader central. Un activiste bien connu est devenu un visage du mouvement: Boniface Mwangi. De nombreux appels à manifester ont été partagés via son compte X. Il a été arrêté plusieurs fois pour cela, mais il est actuellement en liberté.
Qu’ont obtenu les manifestants?
Ruto a subi une telle pression qu’il a retiré la loi de finances fin juin. Mais on ne sait pas encore ce que cela signifie exactement. Car la loi de finances est liée à un projet de loi budgétaire (appropriation bill) qui fixe des budgets annuels pour les différents ministères. Et ce projet-ci n’a pas été retiré. Cela signifie que Ruto doit tout de même augmenter les impôts s’il veut décaisser les budgets déjà fixés. Dans le cas contraire, le gouvernement pourrait être menacé de shutdown. C’est pourquoi certains commentateurs disent que Ruto ne fait que gagner du temps.
C’est également la première fois dans l’histoire du Kenya que des députés sont réellement tenus responsables de leurs actes. Les protestataires se sont rassemblés devant les maisons des élus qui avaient voté pour la loi de finances et les ont interpellés: «Dites-nous ce que vous avez fait de notre argent, montrez-nous les projets que vous avez financés. Si ce n’est pas le cas, nous ne vous réélirons pas».
Pour beaucoup, la loi de finances est la conséquence directe d’un prêt du FMI de plusieurs milliards de dollars que le prédécesseur de Ruto, Kenyatta, avait contracté en 2021. Les conditions de cet emprunt étaient des augmentations d’impôts, des réductions de subventions et des privatisations, des mesures contre lesquelles le peuple s’insurge désormais. Ruto a-t-il hérité ses problèmes de son prédécesseur?
Ruto essaie en partie de le présenter ainsi, mais n’oublions pas qu’il a été vice-président pendant dix ans, y compris au moment où cette dette a été contractée. Il a donc participé à toutes ces négociations avec le FMI. Et même depuis son élection à la présidence, il a continué à se rendre souvent en Occident, il a récemment rencontré le président Biden, auquel il a fourni des soldats kenyans pour une mission en Haïti. Beaucoup reprochent à Ruto de faire des courbettes à l’Occident afin d’obtenir encore plus de crédits à l’avenir. Le problème, c’est que cet argent paie d’anciennes dettes, ou bien disparaît dans les poches de personnes à qui Ruto doit encore une faveur. Et aucun moyen n’est investi dans l’infrastructure du pays. C’est pourquoi de nombreuses personnes reprochent au FMI d’avoir accordé ce prêt au Kenya.
Rien n’a donc changé positivement dans le pays depuis que le Kenya a reçu les fonds du FMI?
Malheureusement, non. L’un des principaux problèmes du gouvernement Ruto est en effet la corruption. Malgré les milliards de shillings injectés au Kenya par le FMI, rien de concret ne s’est passé sur le terrain. On a seulement entendu dire qu’un de ses copains avait été arrêté à Dubaï avec 280 millions de shillings kenyans. Certains de ses plus proches alliés ont acheté des hélicoptères avec lesquels ils survolent le pays. Il ne s’est toutefois rien passé qui ait profité au public. Au contraire: des programmes alimentaires pour les écoliers vivant dans les régions arides du Kenya, où les sécheresses sont récurrentes, ont été supprimés. Les frais de scolarité ont également été augmentés de 50’000 à 200’000 shillings kenyans. Les gens ne comprennent pas pourquoi tout devient plus cher alors que le Kenya reçoit de l’argent du FMI.
Le FMI aurait-il dû refuser la demande de crédit?
Non, mais ses instances auraient dû d’abord s’assurer que les fonds parviennent à ceux qui en ont besoin. Comment peut-on accorder un crédit à un pays déjà endetté et dont la majeure partie de la population peine à joindre les deux bouts, à condition de rendre la vie encore plus chère pour les gens? Sans vérifier en même temps si l’argent est réellement utilisé pour les projets indiqués lors de la demande?
Le FMI devrait donc être en mesure de répondre aux besoins des citoyens. J’ai récemment parlé avec un professeur d’économie de l’université de Nairobi qui m’a dit que l’économie kenyane ne pouvait pas absorber plus de deux milliards de shillings par an. Pourtant, Ruto avait demandé quatre milliards – dont une grande partie sous forme de crédit du FMI. Chacun peut se demander où iront les milliards excédentaires.
Comment pensez-vous que ces manifestations vont marquer le Kenya?
Je pense qu’il y a déjà eu un changement dans l’esprit des hommes politiques. Les protestations vont changer fondamentalement la manière dont notre gouvernement fonctionne. Et ce n’est pas seulement mon avis. Beaucoup de professeurs, de politiciens et de médecins avec lesquels j’échange pensent de même. Il y a peu, beaucoup d’entre nous auraient jugé impossible que des citoyens ordinaires se présentent devant la porte d’un député pour lui demander directement des comptes. Hier encore, des jeunes se sont rassemblés devant la maison du gouverneur de Nandi, un district situé à environ 400 kilomètres de Nairobi. Ils l’ont interpellé et lui ont demandé à quoi il avait consacré son budget et quelles personnes il avait employées. Un autre exemple: la lettre publique que des activistes ont écrite au ministre des Sports. Ils lui demandaient de révéler qui se rendrait aux Jeux olympiques à Paris et combien cela coûterait. Autrefois, le ministre aurait permis à toute sa famille et à son entourage de faire un voyage en Europe financé par l’Etat. Aujourd’hui, il ne peut plus le faire, le ministre en question a déjà perdu son portefeuille.
En conséquence, les députés commencent aujourd’hui à rendre publics leurs revenus de manière proactive. Beaucoup d’hommes politiques ont peur que leurs propres affaires de corruption soient révélées. Mais je pense qu’il faudra encore quelques années pour que cette jeune génération prenne sa place dans le système politique. Espérons seulement qu’elle ne se corrompra pas elle-même en cours de route.
À lire aussi