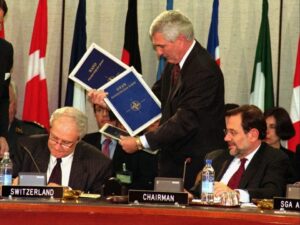Quarantaine: malaise au bout du fil

Elise a été en contact avec une personne contaminée par le coronavirus. Elle a tenté d’obtenir informations et recommandations de la part des autorités cantonales. C’est là que commence l’aventure. – © DR
Il est 16h30. Elise (prénom d’emprunt) reçoit l’information de la part d’une personne avec qui elle a été en contact rapproché, sans masque ou vitre, pendant plus de quinze minutes sur une journée. Habitant le canton de Vaud, cette personne l’informe que selon son médecin, Elise ne sera pas en quarantaine. Vingt minutes plus tard, comme Elise réside en Valais, elle prend l’initiative de contacter la hotline du Canton:
«Je demande quelles précautions je dois prendre pour éviter de contaminer les personnes qui vivent avec moi (salle de bains, distances, etc.) [ndlr : les parents d’Elise, avec qui elle vit, font partie des personnes à risque]. On m’interrompt immédiatement pour me demander des informations sur la personne qui m’a contaminée. On me demande son nom, le centre où elle a été testée, quels sont les types de contacts qu’on a eus, etc. Je reste interdite et donne dans un premier temps le nom. La personne se met immédiatement à la chercher dans une base de données. Elle me dit qu’elle ne la trouve pas, me redemande l’endroit où elle a été testée. Je réponds que je l’ignore, mais que je ne comprends pas l’utilité de la question étant donné que j’ai appelé pour une question simple, à savoir obtenir des informations sur les précautions à prendre. On ne me répond pas, mais on continue l’interrogatoire. Mal à l’aise, je l’interromps et lui dis que je ne suis pas dans de bonnes dispositions pour cet appel, devant prendre un train pour rentrer m’isoler chez moi. La personne insiste, me demande mon nom et où j’habite. Je ne réponds pas et dis que je rappellerai. La personne me dit que la hotline se termine à 17h. Je réponds que je rappellerai le lendemain. La personne insiste. De plus en plus mal à l’aise, je l’interromps et je raccroche.»
Elise a un ton inquiet quand elle revient sur ce premier événement qui l’a laissée coite. Ayant appelé de son propre chef, elle ne comprend pas pourquoi on lui a posé toutes ces questions qui n’étaient pas utiles pour répondre à la sienne, de question. Laquelle était très simple: comment s’organiser dans la maison pour ne pas risquer de contaminer ses parents.
«J’ai l’impression qu’on a tenté de force d’obtenir des informations que je ne consentais pas à donner au lieu de me répondre, alors que, de toute évidence, je comptais respecter les précautions qu’on allait m’indiquer. Ce climat de défiance me semble complètement excessif et inapproprié, d’autant plus qu’on ne fait que de vanter le respect des mesures de la part de la population suisse. Je ne comprends pas pourquoi on part de l’idée que je ne vais pas respecter les précautions qu’on va me donner.»
Outre cette situation étrange, rappelons que le médecin vaudois chez qui sa collègue a été testée lui avait assuré qu’Elise ne serait pas en quarantaine. «Si je n’avais pas été responsable (ce que je suis!), j’aurais eu le temps de sortir et de contaminer beaucoup de monde entre 16h et 10h30 le lendemain matin lorsque j’ai reçu le coup de fil du médecin cantonal valaisan.»
Appel en numéro caché
Mais ce n’est pas tout. Le lendemain à 10h30, Elise reçoit un appel de l’office du médecin cantonal de Vaud, à Lausanne. On lui annonce qu’elle sera en quarantaine jusqu’à jeudi et que le médecin cantonal du canton du Valais va la rappeler. On lui demande son nom, sa date de naissance, son numéro, son e-mail et son adresse postale. «La personne est très sèche», note la très civile Elise, qui, à raison, est sensible à ce genre de choses. Comment imaginer que les citoyens puissent mettre à exécution leur privation de liberté avec le sourire, sans questionnements ni même un certain agacement, si on les traite comme du bétail?
«C’est déjà très stressant d’être en quarantaine parce que tu es quand même potentiellement malade et tu ne peux avoir de contacts avec personne pour te soutenir, et vu tous les articles visant à générer la peur qu’on voit en ce moment sur la perte de goût, audition, odorat, intubation etc., c’est justement là qu’on aurait besoin d’humanité!», s’exclame Elise. «Vu que beaucoup de gens ont été en quarantaine maintenant, c’est peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais sincèrement je m’en étais pas rendu compte avant de l’être moi-même, surtout avec des parents à risque.»
La suite des aventures est plus que cocasse. Le lendemain de l’appel précédent, à 11h, une infirmière appelle Elise depuis Sion… en numéro caché! L’infirmière lui réclame à nouveau les mêmes informations, puis elle lui demande comment elle va faire pour s’organiser dans sa quarantaine, si elle habite seule, si elle a pu prendre des dispositions, si oui lesquelles. Elise explique qu’elle a une salle de bains pour elle et que cela ne pose pas de problèmes avec les personnes avec qui elle vit. On lui demande comment elle peut se désinfecter; Elise explique les dispositions prises. A sa demande, l’infirmière lui confirme que la quarantaine dure jusqu’à jeudi compris. Malgré le gros malaise généré par l’appel en numéro caché et après avoir affirmé à plusieurs reprises en préambule qu’elle comptait respecter scrupuleusement les mesures qui allaient lui être données pour éviter de se heurter à nouveau à un ton accusateur dans ce climat déjà extrêmement anxiogène, Élise se retrouve enfin face à une personne humaine.
Le lendemain de l’appel, on lui envoie une lettre à la tonalité contenant la mention de l’exécution par voire de contrainte («Si la personne concernée s’oppose à la mesure, elle pourra être placée dans une institution appropriée si nécessaire avec l’aide de la police cantonale») ainsi que le montant de l’amende au cas où elle ne respecterait pas les dispositions demandées: jusqu’à 10’000 francs.
Voilà donc à quoi peut ressembler une mise en quarantaine dans notre pays sur le plan du ressenti. Intimidation, incohérence et psittacisme.
L’envie nous vient ici de citer l’écrivain et académicien français François Sureau: «L’exercice de la liberté suppose aussi, s’il ne suppose pas seulement, cette apparence de civilité (nous soulignons) qui manifeste la certitude du bon droit, la légitimité démocratique des forces chargées de la répression. (…) C’est à ces choses que l’on voit à quel Etat on a affaire, s’il est civilisé, s’il est sûr de lui aussi1.»
Dans le cas d’Elise, désormais, ce n’est plus aux officiels d’être exemplaires, c’est seulement aux citoyens. «Alors que j’étais en quête de précisions et que je demandais des conseils, ma bonne volonté s’est heurtée à une suite de redondances et à un clair déficit de civilité. Bref, un manque total de professionnalisme», conclut Elise.
1François Sureau, Sans la liberté, Tract Gallimard, 2019
À lire aussi