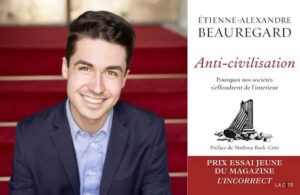L’inquiétante dérive du discours militaire en Europe

© Depositphotos
Il existe parfois, dans la bouche des dirigeants, des phrases qui, lorsqu’elles sont prononcées, marquent d’elles-mêmes une rupture. Non pas tant par leur maladresse ou leur outrance que par ce qu’elles révèlent de l’état d’esprit, de la psychologie et de la disposition intérieure des élites qui les profèrent.
Ainsi, le 18 novembre dernier, devant le Congrès des maires de France, le chef d’état-major des armées, le général Fabien Mandon, déclarait: «Si notre pays flanche parce qu’il n’est pas prêt à accepter de perdre ses enfants… alors on est en risque. Il faut la force d’âme pour accepter de nous faire mal.» Des mots que certains va-t-en-guerre et commentateurs en mal de posture héroïque trouveront «forts», mais qui, en réalité, dévoilent surtout une vision du monde et un rapport au tragique qui devraient, au contraire, inquiéter.
Quelques jours plus tôt, à Berlin, son homologue allemand, le général Carsten Breuer, affirmait: «La Russie ne doit jamais partir du principe qu’elle peut gagner une guerre contre l’OTAN. La situation est extrêmement grave.»
Deux phrases. Deux pays. Deux armées. Et pourtant un seul glissement: la guerre n’est plus évoquée comme un scénario à éviter, mais comme une perspective que l’on commencerait déjà à intégrer, voire à assumer.
Ce glissement n’est pas isolé. Il prépare en sourdine l’ambiance intellectuelle et politique qui imprègne désormais une partie de l’Europe, et il explique aussi pourquoi les discours qui suivent, plus institutionnels ou plus idéologiques, semblent trouver un terrain si réceptif. Car, derrière ces déclarations militaires, se dessine un climat, un état d’esprit, où la parole guerrière remplace progressivement la culture de paix et ouvre la voie aux dérives politiques, institutionnelles et psychologiques qui marquent la suite du débat.
Gravité et solennité: ce qui disparaît dangereusement…
Ce changement de ton est lourd de sens. Depuis toujours, le discours sur la guerre s’accompagne d’une certaine solennité, d’un ton grave qui traduit l’exceptionnalité du moment. Comme si la guerre constituait une sorte de parenthèse dramatique venue interrompre le cours normal de la vie, lequel devrait, naturellement, être placé sous le signe de la paix.
Chez les militaires eux-mêmes, on observe généralement cette retenue singulière. Parce que la guerre n’est pas une abstraction pour ceux qui l’ont connue en première ligne: elle signifie des vies fauchées, des familles brisées, des sociétés durablement bouleversées. Elle impose une sobriété qui n’est pas seulement rhétorique, mais profondément morale.
Or, entendre aujourd’hui le chef d’état-major d’un pays important comme la France expliquer à la population qu’elle doit «accepter de perdre ses enfants» révèle un phénomène troublant: un abaissement du seuil de sagesse et de raison dans la parole publique. On en vient à évoquer la mort comme un simple «coût» collectif, comparable à un effort fiscal ou à une contrainte budgétaire… Ou, plus inquiétant encore, à accepter une véritable inversion des valeurs qui fondent la civilisation, lorsque l’on en vient à promouvoir le scénario de la mort au détriment du principe premier qui devrait guider toute société, tout père de famille digne de ce nom: la prééminence de la vie, la sauvegarde des siens et des semblables.
Derrière ces mots, ce n’est pas seulement une formule malheureuse qui s’est exprimée. C’est une banalisation du tragique qu’il faut savoir considérer comme tel. Un signal d’autant plus frappant que, dans les civilisations passées, on mesurait pleinement le caractère exceptionnel de la guerre: à Rome, par exemple, la décision de partir en campagne exigeait un vote du Sénat, suivi d’un rituel solennel —le lancer symbolique d’un javelot vers le territoire ennemi — qui rappelait à tous que l’on basculait dans un état d’exception, lourd de sens et de conséquences.
La guerre dans les imaginaires
L’historien Jean-Jacques Becker l’avait parfaitement illustré dans son ouvrage 1914 – Comment les Français sont entrés dans la guerre: la Première Guerre mondiale n’a pas commencé dans les tranchées, mais bien avant, dans les mots, les récits, les peurs, la diabolisation de l’autre, les représentations collectives. La guerre fut d’abord un état d’esprit, une atmosphère, une montée en tension inscrite dans les mentalités, avant d’être un fait militaire.
Ce parallèle n’a rien de forcé. Ce que l’on voit aujourd’hui en Europe rappelle précisément ce processus. Les militaires ne se contentent plus de désigner une menace: ils installent un horizon temporel (2030) de l’affrontement plutôt que de le prévenir, ils imposent une tonalité et façonnent un climat psychologique lourd. La confrontation n’est plus présentée comme une éventualité, mais comme une absolue fatalité.
Et c’est bien cela qui inquiète: la promotion d’une rhétorique ouvertement belliciste qui s’inscrit dans une mécanique mortifère où la guerre cesse d’être un accident pour devenir une hypothèse familière. Une rhétorique de fermeté martiale, de confrontation assumée, parfois d’une certaine virilité sacrificielle. Une manière de parler où les mots cessent de nommer la guerre pour commencer, petit à petit, à l’installer. Ce mécanisme singulier, Becker le décrivait parfaitement: les conflits naissent d’abord dans les imaginaires, bien avant de se traduire dans les faits.
Une dérive institutionnelle qui fragilise les principes démocratiques: la stratégie de la tension…
Ce glissement n’est certainement pas anodin. Il renvoie à ce que Naomi Klein décrit dans La théorie du choc comme une véritable stratégie de la tension chez certains dirigeants, où la peur est utilisée comme relais politique quand les politiques publiques ont échoué. Et il faut bien reconnaître que l’Union européenne accumule les impasses: désindustrialisation, crise énergétique, stagnation économique, effet boomerang des sanctions antirusses, incapacité à assumer ses propres choix. Faute de résultats, on change de registre.
Dans ce contexte, la phrase «accepter de perdre nos enfants» n’a rien d’un constat. C’est un outil qui choque, paralyse, court-circuite la discussion. La peur devient tout simplement un mode alternatif de gouvernement. On substitue la sidération à la délibération. Ce type de sortie ne nourrit pas le débat public, il le confisque. Il enferme l’opinion dans un réflexe défensif et sert à faire passer des orientations que personne n’aurait validées dans un cadre démocratique normal.
Le problème ne se limite d’ailleurs pas à la seule formulation. Il touche au cœur même des institutions. Dans un Etat de droit, le militaire conseille et exécute; il ne fixe pas ce que la société doit accepter. Lorsqu’un chef d’état-major se permet de le faire et tiens de tels propos devant les élus de la République, il empiète sur le domaine du politique et porte atteinte, de fait, au principe de séparation des pouvoirs.
Cette dérive rejoint celle de l’Union européenne, où la Commission s’exprime désormais comme si elle disposait d’une souveraineté militaire: déclarations sur la fermeté, la «résilience stratégique», la durée de l’effort de guerre… alors même qu’aucun traité ne lui confère ce rôle. On assiste ainsi à une double déviation: des armées qui sortent de leur registre, une Commission qui sort du sien. Entre les deux, le débat public se trouve marginalisé, et les principes démocratiques sont fragilisés. C’est sur ce terrain instable que prospère aujourd’hui cette rhétorique guerrière.
Une nouvelle génération de dirigeants aux profils particuliers
Au cœur de cette dérive, se pose une question que l’on esquive trop volontiers: celle du profil et de la psychologie des dirigeants qui occupent aujourd’hui les postes de pouvoir en Occident. Nous avons affaire, le plus souvent, à une génération jeune, sans ancrage réel, sans enfants pour beaucoup, et issue des mêmes couveuses institutionnelles — parcours standardisés, cercles transatlantiques, programmes de «jeunes leaders».
Ces dirigeants n’ont jamais connu la guerre, n’en portent ni la mémoire ni le sens tragique. Ils s’expriment pourtant avec une aisance déconcertante sur des réalités qu’ils appréhendent seulement par un prisme exclusivement théorique. Cette distance se double souvent de traits psychologiques marqués: un fort besoin de mise en scène, une tendance au narcissisme, une difficulté à accepter la contradiction, et cette rigidité idéologique qui appréhende le doute comme un aveu de faiblesse.
D’où cette façon de parler du sacrifice sans jamais en mesurer le poids réel. D’où cette facilité à substituer la communication au discernement, l’affirmation au jugement, la posture à la vision. Ce glissement psychologique, lent mais constant, produit un effet redoutable: il rend presque suspect tout appel à la prudence, transforme la recherche de paix en faiblesse, et installe progressivement l’idée que la confrontation serait la seule voie cohérente. Pourtant, c’est précisément cette inversion silencieuse des repères et ce renversement des valeurs qui devraient nous alerter. Car c’est ainsi que se prépare, sans la nommer, une disposition collective à accepter l’irréparable.
Un message désastreux envoyé à Moscou
Tout cela n’est pas neutre. Pour Moscou, les propos de Mandon ou de Breuer ne laissent aucune ambiguïté: l’Europe n’est plus dans une logique de paix et n’envisage plus d’autre issue que dans la guerre. Elle se prépare mentalement à l’affrontement. Ce sentiment est renforcé par les déclarations russes elles-mêmes: Sergueï Lavrov affirmait ainsi que «l’Union européenne et l’OTAN se comportent comme si elles avaient déjà choisi la voie de la confrontation avec la Russie», allant jusqu’à accuser l’Europe de «chercher l’escalade plutôt que la paix». Cette perception n’est évidemment pas déconnectée du langage européen: la communication de Bruxelles et des capitales occidentales alimente, aux yeux du Kremlin, l’idée que l’Europe se prépare à la guerre et qu’elle assume désormais cette posture.
Pourquoi, dans ces conditions, la Russie accepterait-elle un gel du conflit ou une négociation? Si elle estime que l’Europe anticipe déjà la suite, elle n’a aucun intérêt à faire la moindre concession.
Ainsi, le langage européen, loin de rapprocher la paix, l’éloigne. En parlant de la guerre, l’Europe se piège elle-même dans une dynamique d’escalade, sans en avoir ni les moyens militaires ni la cohésion politique. C’est une rhétorique de puissance portée par des acteurs qui n’assument pas les réalités de la puissance.
Retrouver le langage de la paix avant qu’il ne soit trop tard
Il faut le dire simplement: la culture de la paix s’efface en Europe au profit d’une rhétorique guerrière qui s’installe sans débat, sans prudence et sans conscience de ses conséquences. La guerre naît toujours dans les mots avant de se traduire dans les faits. Elle peut encore être évitée de la même manière: par la retenue, la sagesse et le retour du politique.
Il faut refuser la normalisation du sacrifice, refuser que la peur devienne un mode de gouvernance, refuser que l’escalade soit présentée comme une évidence. Il n’y a pas de fatalité, seulement des glissements successifs que l’on peut encore enrayer.
Il serait bon de se souvenir ici de Clemenceau: «La guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires.»
À lire aussi