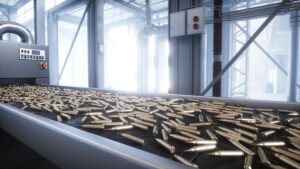La vraie histoire d’un accord de paix sabordé
«Accord entre l’Ukraine et la Russie « dans les prochains jours » possible. Enfin la paix en vue?» – © DR
Lire aussi: Les dégâts que fait la guerre dans nos têtes
Aussitôt après le début de l’invasion russe commencée le 24 février 2022, les deux belligérants mesurèrent l’abîme qui s’ouvrait devant eux. Les Ukrainiens entrevoyaient le désastre et les Russes mesuraient leur erreur: contrairement à leur attente le pays agressé se dressait face à eux avec une vigueur inattendue. Les uns et les autres cherchèrent à arrêter la machine de guerre avant qu’elle ne s’emballe.
Une première rencontre officielle se tint entre leurs représentants en Biélorussie. Puis le président turc Erdoğan les invita à Istanbul. Pour la petite histoire… La délégation ukrainienne chercha à consulter un ami de Poutine pour évaluer les chances de cette rencontre: Gerhard Schröder. Ils entrèrent en contact avec lui par l’intermédiaire de Marc Walder, CEO de Ringier, à Zurich! L’ex-chancelier allemand nous a raconté, l’été passé, les discussions qu’il eut alors avec les négociateurs des deux camps. Il se rendit aussi en Turquie. Les pourparlers se tinrent les 10 et 29 mars à Istanbul et Antalya. Plusieurs points d’accord furent trouvés. Les Russes devaient se retirer, l’Ukraine devenir un Etat neutre, avec une armée – dont les effectifs devaient encore être définis –, les provinces séparatistes de l’est devaient accéder à un statut d’autonomie comparable à celui de la Catalogne ou de l’Ecosse. La Crimée? Les Ukrainiens proposèrent d’y tenir un référendum sur son appartenance… dans un délai de quinze ans! Cet accord sur «la neutralité et la sécurité de l’Ukraine» devait être supervisé et garanti par plusieurs puissances européennes. Et la Russie. Ce qui passait mal, il est vrai. Un premier papier fut signé par les deux parties. Celui que Poutine vient de brandir devant les caméras et ses hôtes africains, en signe de bonne volonté pour tout autre palabre de paix. Face au suspense de Istanbul, le quotidien allemand à grand tirage Bild, connu pour ses informations privilégiées en provenance de Kiev, titrait: «Accord entre l’Ukraine et la Russie « dans les prochains jours » possible. Enfin la paix en vue?»
Les Russes se retirèrent alors de Kiev. Parce que leur colonne de chars, à l’entrée de la ville, se trouvait sous le feu, dit-on à l’ouest. Pour faciliter les négociations, selon Moscou. Mais les troupes laissèrent derrière elles les victimes des tueries de Boutcha. Les corps disposés sur la chaussée étaient offerts au spectacle médiatique. La colère monta de plusieurs degrés en Occident. Le Premier ministre israélien alors en poste, Naftali Bennett, qui avait fermement soutenu les efforts de paix, déclara alors: «C’est fini.» De fait l’espoir était enterré. Début avril, Gerhard Schröder rencontra Poutine et confia qu’il l’avait trouvé très pessimiste sur les chances d’aboutir à un accord, voyant l’Occident déterminé, selon lui, à faire plier la Russie et à la marginaliser durablement. Et pourtant… Même après le 17 mai, la chute de Marioupol, la rupture officielle des pourparlers, les contacts n’ont pas été complètement rompus. Les belligérants ont continué à parler de questions humanitaires, notamment de l’échange de prisonniers et des corps de soldats tués. Ce canal de discussion existe encore aujourd’hui. Sous la médiation du président turc Erdoğan et du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, un fil dynamique de négociations s’est en outre développé sur l’ouverture des ports ukrainiens de la mer Noire bloqués pour l’embarquement de céréales ukrainiennes.
Il a été dit que Boris Johnson, Premier ministre de Grande-Bretagne, aurait fait savoir à Zelensky, début avril, qu’il ne fallait en aucun cas conclure cet accord, qu’il fallait poursuivre la guerre, avec l’appui déterminé des Occidentaux. Il n’a jamais démenti. Il faut se souvenir que BoJo, plus belliqueux que jamais, hostile à tout arrangement, s’était précipité à Kiev le 10 avril déjà, dix jours après que les belligérants, en Turquie, avaient signé un premier engagement «pour la neutralité et la sécurité de l’Ukraine», selon la désignation officielle, se promettant de se revoir. Les connaisseurs de la politique américaine estiment que le gouvernement Biden préférait lui aussi la poursuite du conflit qu’il prévoyait et préparait depuis des années. Autant pour affaiblir la Russie que pour protéger l’Ukraine. Les Occidentaux ont donc sifflé la fin de l’exercice négociatoire.
Il faut par ailleurs considérer les fortes tensions, avant, pendant et après cet épisode, au sein même du pouvoir de Kiev. Il n’est pas étonnant que Zelensky ait, dans un premier temps, cherché à arrêter la guerre. Russophone, juif, élu à une forte majorité en 2019 notamment grâce aux voix de l’est ukrainien, beaucoup l’oppose à la mouvance ultra-nationaliste de l’ouest du pays, très influente dans l’administration et l’armée. Celle-ci a tout fait pour saborder la négociation. Depuis lors, elle a contribué à conduire le Président vers son rôle de va-t’en-guerre acharné. Aujourd’hui encore celui-ci est sous la pression, sous les menaces diffuses de l’aile des plus durs. La presse ukrainienne, bien que très limitée dans sa liberté d’expression, n’en fait pas mystère. Certains chuchotent que si la situation sur le champ de bataille ne s’améliore pas, cela pourrait mal, très mal tourner pour la coqueluche des médias occidentaux. Une hypothèse – vraisemblable – veut que les attaques sur le sol russe soient initiées par les ultra-nationalistes. En tout cas, le gouvernement de Zelensky n’assume pas cette responsabilité.
Sans considérer la diversité des sensibilités et des comportements de ce vaste pays, on ne comprend rien à son passé, à son présent et rien non plus aux perspectives de son avenir.
Quelque lueur à l’horizon? Ce n’est pas exclu. La stagnation des fronts, la lassitude croissante de la population ukrainienne, l’inquiétude du Kremlin face à la surenchère de ses propres ultra-nationalistes, la campagne électorale de Biden qui se passerait bien de la valse des milliards due à la guerre… Tout cela pourrait converger et amener enfin à des négociations de paix. Mais tant d’accidents spectaculaires, plus ou moins volontaires, peuvent encore se produire qui relanceraient le théâtre belliqueux. Au-delà même du champ de bataille actuel.
À lire aussi