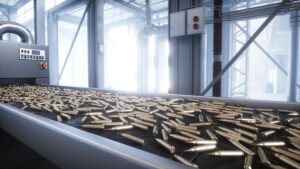Les dégâts que fait la guerre dans nos têtes

Première rencontre entre Russes et Ukrainiens en mars 2022 en Biélorussie, avant la poursuite des discussions d’Istanbul en vue d’un accord de paix. © DR
Ne parlons pas de neutralité. Cette notion mythique à géométrie variable. La Turquie, la Chine, le Brésil ou l’Afrique du sud sont loin d’être neutres, cela ne les empêche pas de s’agiter en faveur de la paix. Avec son passé, son expérience de la diversité, sa diplomatie active, la Suisse aurait tout pour faire entendre sa voix, celle de la raison. Ne serait-ce que pour rester fidèle à elle-même. Et non. Elle s’aligne sur «l’Occident», chipote sur quelques détails, mais ne prend aucun recul. Au contraire. L’autre jour, à la Fondation Jean Monnet, la représentante du gouvernement, Mme Pälvi Pulli, cheffe de la politique de la sécurité, bras droit de la conseillère fédérale Viola Amherd, a tenu un clair propos. Après avoir abondamment condamné la Russie «impérialiste et colonialiste», elle a annoncé plusieurs initiatives à venir pour renforcer plus encore qu’aujourd’hui les liens et les collaborations avec l’OTAN. Avec le raisonnement suivant: la Suisse devrait assurer seule sa sécurité, mais nous ne sommes pas naïfs, en cas de conflit, elle ne pourrait le faire qu’avec les autres. Dès lors, dans cette hypothèse, pour être prêts, il s’agit de s’entraîner d’ores et déjà comme si nous étions en guerre. Négociations? Perspective de paix? Elle balaie vite le sujet et se contente de citer la position de Kiev: on ne négociera qu’après notre victoire.
Que la Suisse doive apporter une aide humanitaire généreuse à l’Ukraine, c’est l’évidence. De là à prendre à la lettre le discours – forcément et légitimement partial – du président Zelensky devant les Chambres fédérales, il y a un pas. Les souffrances des populations du Donbass de 2014 à aujourd’hui doivent aussi être prises en compte.
Mais voyons au-delà de nos dirigeants, les uns embarrassés, les autres ancrés dans leur vision simple. Au-delà aussi de la tempête furieuse des tweets où les deux camps se pourfendent. Regardons-nous. Les esprits les plus fins, les observateurs les mieux informés s’appuient sur des convictions légitimes et fondées mais pour la plupart finissent par s’enfermer dans leur mantra.
Dans le camp largement majoritaire, on insiste avec raison sur la violation de la frontière ukrainienne. Sans se souvenir que celle de la Serbie a été «corrigée» au terme d’une guerre menée contre elle avec la création du Kosovo. Sans mentionner le débordement prolongé et violent d’Israël sur la Cisjordanie. Cela dit en passant et sans justifier le comportement de la Russie. A force de marteler leur appui à l’Ukraine, les Occidentaux, et nous avec donc, ont sous-estimé la capacité offensive et défensive russe. Comme le Kremlin, au début, a sous-estimé celle des Ukrainiens. Et aujourd’hui encore, les tenants des deux camps tendent à prendre leurs souhaits pour des réalités. Face à l’avenir, nous sommes myopes. Quelle que soit l’issue du conflit, l’Ukraine et la Russie, si proches de nous, se trouveront profondément blessées à maints égards après tant de fureurs et de sang versé. Il n’est pas trop tôt pour tenter de préparer leurs lendemains. Par la diplomatie, le dialogue, autant que par l’économie. Il en est bien peu question.
Chacun pique dans les informations contradictoires ce qui lui convient et en reste là. Pas étonnant dès lors que de part et d’autre on ressasse que la guerre sera longue, des mois, des années peut-être. Il se dit tous les jours qu’elle pourra virer au conflit mondial, non plus latent mais armé et même nucléaire. Vous n’êtes pas stupéfaits devant le calme avec lequel sont émises ses prévisions terrifiantes? Le système est en place, sur le terrain, dans les chancelleries, dans les discours, dans les têtes. Quiconque ose dire que rien n’est inéluctable, qu’il faut un cessez-le-feu immédiat au vu de la stagnation des fronts, qu’il faut au plus vite des négociations, qui ose simplement plaider pour la paix, est aussitôt dénoncé comme un un défaitiste, sinon un traître, ou un illuminé. Encore une fois, chez nous, pas dans le reste du monde.
Cet engrenage intellectuel jusque dans les têtes bien faites de notre paisible Helvétie est affligeante. Mais le comportement des Européens l’est plus encore. Premiers concernés, ils n’ont pas su ou vraiment voulu forcer les chemins de la paix entre 2014 et 2022 lors de la guerre du Donbass. Ils n’ont apporté aucun contre-poids à l’influence des Etats-Unis en Ukraine qui la préparaient à la guerre. Au lendemain de l’offensive russe, ce ne sont pas eux mais la Turquie qui a tenté d’éteindre aussitôt l’incendie. Avec succès dans un premier temps. Un accord était à bout touchant à Istanbul entre les belligérants manifestement effrayés par l’ampleur de la tragédie en vue. Jusqu’à ce que les Britanniques, les Américains et les ultra-nationalistes de Kiev autour de Zelensky sifflent la fin de l’exercice.
Ce qui était possible en mars 2022 ne l’est plus aujourd’hui, après tant de morts et après l’annexion d’une partie de l’Ukraine. Pourtant l’épuisement progressif des ressources humaines et matérielles imposera tôt ou tard une négociation. Pourquoi attendre? La convergence des pressions, des efforts internationaux en ce sens pourrait peser lourd tant sur Moscou que sur Kiev. A Washington même l’acharnement des «néo-cons» commence à lasser…
L’Europe sort affaiblie de l’épreuve. Economiquement, politiquement – devenue vassale des USA – et plus encore. Mentalement. Ses élites ne pensent pas par elles-mêmes. Son idéal de paix, le fondement de son union, s’effiloche au point de disparaître au regard du monde. C’est un désastre géopolitique. Mais aussi, chez nous, au plan civique. En Suisse comme chez nos voisins, le débat, le vrai, n’est plus possible. Même avec bonne volonté, il tourne au dialogue de sourds, les uns et les autres accrochés à tel ou tel argumentaire. Edgar Morin, le théoricien et promoteur de la «pensée complexe» n’a pas mérité une telle dérive pour ses 101 ans. Quel que soit le thème abordé – pas seulement la guerre –, si nous refusons la piqûre du doute sur notre opinion initiale, nous nous abrutissons. Il n’y a pas de pensée libre sans le va-et-vient du doute et de la certitude.
Lors de guerres précédentes – celle d’il y a vingt ans entre les USA et l’Irak par exemple – on a vu des foules manifester, exiger l’arrêt des bombardements et la paix. Cette fois, pas une seule! Bien souvent les partis traditionnellement les plus pacifistes sont ceux, comme Allemagne, qui se montrent les plus belliqueux. Alors que les formations nationalistes et dites populistes sont les plus critiques face à l’engrenage guerrier. Quel renversement du paysage! On n’a pas fini d’en mesurer les effets et les surprises. Dans notre réalité politique… et dans nos têtes.
À lire aussi