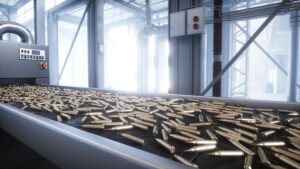Voir la guerre en face

Une maison d’habitation détruite par les combats à Boutcha. – © Kisnaak – CC BY SA 4.0
La question mérite réflexion: faut-il voir la guerre en face sous tous ses aspects ou cadrer le regard en fonction de nos convictions?
Il est possible de prendre parti, condamnant en l’occurence l’invasion russe en Ukraine, et à la fois considérer les atteintes au droit dans le camp «ami». Or dans le cas soulevé par Amnesty international, il est certain que placer des soldats dans les logements civils, les écoles et les hôpitaux, attirant ainsi le feu sur la population désarmée, c’est une atteinte au droit de la guerre. Il y en a certes de l’autre côté et le même organisme les a dénoncées. Les responsables maintiennent leurs informations, d’ailleurs confirmées par un récent reportage sur place de France Info, mais ils ont regretté d’avoir blessé ainsi une part de l’opinion publique ukrainienne.
Bernard-Henri Lévy trouve la publication de ce rapport «ignoble». Il ajoute: «Comme si on avait, en 1944, accusé les résistants de se battre dans Paris». Parallèle absurde. On pourrait en faire un autre. Lorsque les Britanniques ont bombardé Le Havre et plusieurs autres villes françaises en 1944, quasiment sans impact sur les positions allemandes mais causant des milliers de morts dans la population civile, a-t-on le droit d’en parler? Lorsque les Alliés ont rasé la ville de Dresde (35’000 morts) en février 1945, sans aucun effet sur le déroulement de la guerre qui approchait de sa fin, a-t-on le droit de parler d’un crime? Ou faut-il enterrer ces sombres chapitres afin de ne pas porter quelque ombre sur les vainqueurs du Reich? Comme l’ont fait les Soviétiques de leur côté, n’acceptant jamais d’évoquer les horreurs commises sur la population civile lors de leur avancée en direction de Berlin… Comme les Russes aujourd’hui sont loin d’admettre leurs scandaleux comportements face aux civils, à Boutcha et ailleurs.
Et nous? Nous avons la chance de n’être pas sous le feu, nous pouvons donc, nous devons regarder la réalité sous toutes ses facettes. Brandir l’étendard de la liberté tout en la rognant, c’est trahir nos convictions démocratiques.
Ce n’est pas tout. Outre les considérations éthiques se pose aussi la question, froidement posée, des conséquences politiques, mais aussi judiciaires qu’auront tôt ou tard de tels dérapages. La mise en danger des civils heurte nombre d’Ukrainiens et Ukrainiennes, en particulier dans l’est et le sud. Ils pourraient relâcher ou retirer leur soutien au gouvernement de Kiev. Et est-ce que les enquêteurs de la Cour pénale internationale auront accès aux moyens de preuve? Et oseront-ils dresser des actes d’inculpation? Ou bien, comme au Kosovo il y a vingt ans, les Occidentaux empêcheront-ils la justice internationale de poursuivre leurs amis criminels? Rappelons qu’il aura fallu le courage des héros tessinois Dick Marty et Carla Del Ponte pour rouvrir ces dossiers.
Autre fait peu ou pas répercuté: le pouvoir ordonne une chasse aux suspects de trahison. Dans certaines villes russophones, des policiers frappent à la porte des particuliers, vérifient leur identité et fouillent leurs téléphones. A Mykolaïv un couvre-feu de trois jours a été décrété pour «neutraliser les collaborateurs». Cette méfiance systématique, avec les centaines d’arrestations qu’elle entraîne, n’est pas spécifiquement condamnée par le droit de la guerre mais elle pourrit le climat dans les zones sensibles, où l’opinion est en effet discrètement divisée. Cela augure mal de l’avenir quel qu’il soit.
Les vrais amis du gouvernement ukrainien ferait bien de lui rappeler ces évidences à l’heure où il se trouve manifestement sous la pression des plus durs va-t’en-guerre. Il est vrai que les appels au respect de la démocratie seront accueillis avec ricanements dans les mouvances ultra-nationalistes. Leurs leaders historiques et actuels n’en ont que faire. Ils considèrent ces principes comme une influence occidentale à repousser aussi bien que celle de la Russie. Certes sans le dire trop haut et sans violence, mais les Occidentaux devront un jour ouvrir les yeux sur cet écart dans la vision que peuvent avoir les Ukrainiens eux-mêmes sur l’Ukraine du futur.
À lire aussi