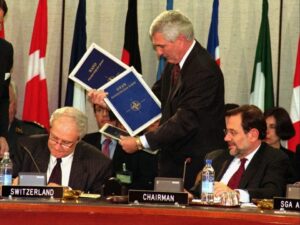Vers un affaissement de notre Etat de droit?
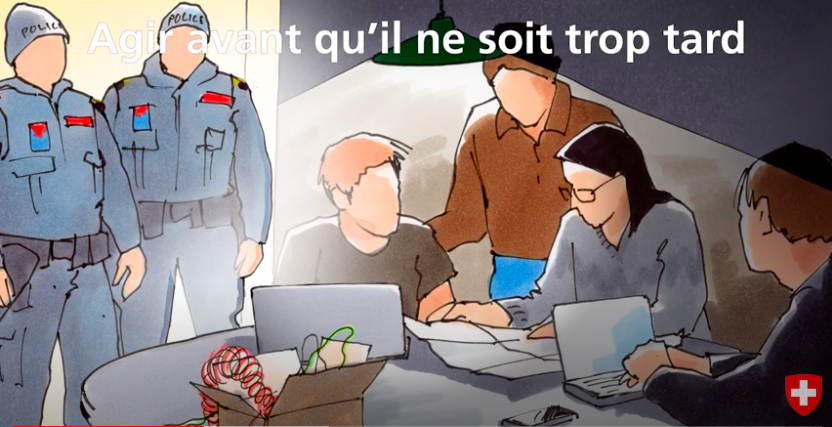
Avant qu’il ne soit trop tard… Un leitmotiv de la campagne en faveur de la loi fédérale MPT. Ici dans une vidéo explicative et promotionnelle produite par le DFJP. – © DR
Un sujet chaud. La nouvelle loi anti-terroriste sur lequel le peuple suisse se prononcera le 13 juin prévoit que la police puisse agir rapidement quand un acte terroriste est concrètement prévisible, mais qu’aucune infraction n’a encore été commise. Des mesures préventives telles que l’obligation de participer à des entretiens, l’interdiction de contact, l’interdiction géographique ou encore l’assignation à résidence pourront être prises à l’encontre des individus sur lesquels planent des soupçons. Et cela donc sans l’intervention d’un juge.
L’idée est louable: donner plus de moyens d’action rapide à la police fédérale pour lutter contre le terrorisme. La menace touche aussi la Suisse, c’est un fait. Et si l’Office fédéral de la police (fedpol) réclame une nouvelle base légale, défendue par le Conseil fédéral aussi bien que par le Parlement, ce n’est certainement pas pour le simple plaisir d’obtenir davantage de pouvoir sur la population. La mesquinerie, l’orgueil et la soif d’autorité existent bien sûr, et à tous les échelons; mais attribuer cette seule motivation à nos autorités équivaut au procès d’intention. Surtout, c’est passer à côté du problème et c’est ignorer l’objectif important de la loi.
La possibilité d’une faille
Il n’empêche. Dans tout nouveau texte législatif, il y a la possibilité d’une faille qui peut à elle seule, même sans la moindre volonté ou conscience de ses défenseurs, ouvrir une ère de basculement vers un effritement de l’Etat de droit, de la démocratie et de nos libertés personnelles au nom du bien (d’ailleurs, rien n’est jamais fait au nom du mal). Dans tous le cas qui nous occupe, c’est évidemment d’abord la question du respect de la présomption d’innocence qui se pose, des individus pouvant être suspectés de terrorisme sans crime encore commis et sur la seule décisions de la police. François Sureau a analysé ce genre d’enjeux dans son petit essai paru en 2019, Sans la liberté. Le cas de la nouvelle loi anti-terroriste sur laquelle nous allons voter le 13 juin se prête à merveille à sa réflexion:
«Que les gouvernements, celui d’aujourd’hui comme les autres, n’aiment pas la liberté, n’est pas nouveau. Les gouvernements tendent à l’efficacité. Que des populations inquiètes du terrorisme ou d’une insécurité diffuse, après un demi-siècle passé sans grandes épreuves et d’abord sans guerre, ne soient pas portées à faire le détail n’est pas davantage surprenant. Mais il ne s’agit pas de détails. L’Etat de droit, dans ses principes et dans ses organes, a été conçu pour que ni les désirs du gouvernement ni les craintes des peuples n’emportent sur leur passage les fondements de l’ordre politique, et d’abord la liberté.»
Ce texte publié chez Gallimard est une déclaration d’amour à la liberté politique. L’avocat français estime que celle-ci s’érode depuis une vingtaine d’années dans son pays. En cause, de nouvelles lois élaborées au parlement qui restreignent la liberté de chacun au nom de motifs sécuritaires pour le bien de tous – on est en plein dans notre sujet. Selon les opposants à la loi, celle-ci viole non seulement la présomption d’innocence, mais aussi les droits de l’homme et les droits des enfants, ceux-ci étant concernés par certaines mesures dès l’âge de 12 ans.
Selon Sureau, un bon signal d’atteinte abusive aux libertés individuelles par l’Etat, c’est quand les deux principes «d’optimisme quant aux citoyens – jugés capables de discernement et d’action» et de «pessimisme quant aux gouvernants – jugés portés à abuser des pouvoirs et à méconnaître les droits» (contenus dans l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme) ont tendance à s’inverser. On peut sérieusement se demander si la loi sur les MPT ne participe pas du même renversement de principes, quand elle donne par exemple cette nouvelle définition du terroriste, qui n’a plus besoin de planifier ou d’exécuter un acte criminel: il suffit d’être soupçonné de commettre des «actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves, la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte» pour être considéré comme un terroriste.
Qu’en sera-t-il des politiques, journalistes, observateurs qui émettent des avis jugés controversés? Les rangera-t-on sous l’étiquette de «terroristes»? Si Karin Keller-Suter, la cheffe du Département fédéral de conseillère fédérale PLR en charge du Département fédéral de justice et police (DFJP), se veut rassurante sur ce point, on ne saurait trop rappeler le scandale des fiches rendu public à la fin des années 80. Pire, il a été attesté que la tenue illégale de fiches d’informations sur des personnes par l’Etat suisse a continué depuis. Quant aux «actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique», leur caractère vague fait froid dans le dos, surtout à l’heure de la chasse aux «complotistes» et à l’évacuation des débats sur un tas de sujets. Que dire enfin du signal que lancerait cette définition du terrorisme à l’international, alorsque beaucoup d’Etats dans le monde étouffent leurs opposants politiques?
Déjà des signes en Suisse d’un Etat de droit fragile
Il est intéressant de noter que dans son écrit de 56 pages, Sureau ne base pas seulement son plaidoyer sur des actualités parlementaires. Il s’intéresse aussi par exemple à une certaine attitude des forces policières lors de manifestations, où il s’agit «moins d’encadrer que d’intimider, d’exercer une pression de type militaire, comme on le ferait non sur les citoyens de son pays, d’un pays soumis au droit, mais sur les ennemis occupés d’un corps étranger dont on craindrait la révolte, l’embrasement soudain.» Là aussi, cette description peut sonner comme un avertissement au moment où, en Suisse, des policiers en tenues robocop interviennent en masse auprès de manifestants, pour la plupart pacifiques, opposés aux mesures covid.
Paradoxalement, cette réflexion sur l’Etat de droit s’avère d’autant plus importante que nous nous trouvons à un stade de l’histoire où certaines minorités actives demandent à supprimer des textes jugés déviants, à museler des voix jugées dérangeantes, à imposer tel ou tel langage, au nom de leurs prétendus «droits». Cette contradiction manifeste pourrait bien faire croire à la fameuse «majorité silencieuse» que l’Etat de droit, c’est finalement du tout et du n’importe quoi. Cette majorité pourrait ainsi être tentée de plébisciter la rassurante autorité, oubliant que celle-ci est aussi encline à tomber dans l’autoritarisme que les minorités actives le sont à pratiquer le chantage intellectuel.
Et puis, au-delà de cela, est-on sûr que l’individu est encore soucieux de la liberté des autres? Voilà aussi ce qui se joue actuellement dans de telles votations. Comme l’écrit Sureau, et cela rejoint le thème des minorités actives, «les droits que nous réclamons sont des droits fragmentaires, des droits de créance, des droits communautaires, des droits de jouissance, des droits mémoriels. Ils ont en commun de nous placer en situation de demandeurs face à l’Etat. Dès lors, il nous est très difficile de nous opposer à ses empiètements. Cette société du paternalisme a pour conséquence que la liberté d’autrui ne nous concerne plus. Peu importe qu’on interdise la consultation de sites islamistes, puisque je ne vais pas les voir.»
Sur ce point précis, Karin Keller-Suter, dans sa défense de la loi, assure que la consultation de sites islamistes ne constituera pas un indice en soi pour que la police puisse intervenir. Or, la nature exacte de ces indices, on ne la connaît pas. C’est ici que se joue notre confiance ou non envers la police – et l’Etat, qu’elle représente. Pour Sureau, en matière de terrorisme, c’est clair: «avant le crime, il n’y a rien». Il faut distinguer le penser et l’agir. En même temps, il faut bien le reconnaître, entre le penser et l’agir, il y a justement un espace pour les indices: des agissements, des paroles «pouvant faire penser à…». Soumettre, dans notre âme et conscience, la nouvelle loi sur les MPT à l’examen du respect de nos libertés est donc un exercice complexe. Mais nécessaire. «L’homme est voué à sa liberté», écrit l’auteur de Sans la liberté. Ainsi, «il lui revient continûment, avec « patience et souffle », d’en reformuler le projet politique et de s’y tenir.» Nous avons la chance d’avoir les armes démocratiques pour le faire.
À lire aussi