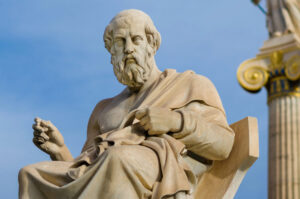Le droit et la science bafoués

© Jeremy Bezanger/Unsplash
Le mensonge, la duplicité, l’opportunisme, la tromperie, peu importe comment on appelle cette mystification, nous accompagne depuis le début de la pandémie et ne nous lâche plus. On se souvient des promesses faites sur les masques, les tests, les respirateurs, proclamés inutiles en mars et obligatoires en mai 2020. Aujourd’hui, les bobards continuent à propos de la vaccination et du passe sanitaire, encouragés jusqu’à l’hystérie alors que l’évidence montre que la troisième dose n’est d’aucune d’utilité face à la contamination d’Omicron et d’un apport scientifiquement non prouvé pour éviter les cas graves.
Mais ce n’est pas le plus important. Beaucoup plus grave nous parait le fait que le droit n’est plus respecté. Depuis le 1er février dernier, plus de 250’000 Suisses qui s’étaient faits vacciner de bonne foi au premier semestre 2021 en échange d’un passe valide 365 jours ont été brutalement mis devant le fait accompli en voyant ce délai ramené à 270 jours s’ils n’avaient pas reçu leur troisième dose. Or un des fondements du droit consiste à ne pas imposer de changement légal avec effet rétroactif. On aurait pu accepter ce changement s’il avait été valable pour les personnes vaccinées après le 1er février 2022. Mais ce n’est pas le cas. Il s’agit donc d’un déni de droit caractérisé et d’une atteinte à l’état de droit tout à fait inacceptable dans une démocratie.
A cela s’ajoutent les atteintes aux droits de l’Homme, liberté d’expression, de réunion, du commerce et de culte, sévèrement limités. Un rapport de Freedom House a établi que la démocratie avait reculé dans 80 pays depuis le début de la pandémie, et en particulier dans les pays jugés les plus démocratiques tels que les Etats-Unis, la France ou les Pays-Bas, et qu’en 2020 le nombre de pays libres avait atteint son niveau le plus bas depuis quinze ans.
Tout aussi inquiétant est le déni de science auquel nous assistons depuis le début de cette crise. Comme s’en sont fait l’écho l’un des épidémiologistes les plus capés des Etats-Unis, le professeur émérite à l’Université de Stanford John Ioannidis, et la professeure à l’Université Erasmus de Rotterdam Michaela Schippers, dans le magazine en ligne juif new-yorkais Tablet, la pandémie a changé les normes de la science. Pour le pire. Des principes basiques de la méthodologie scientifique tels que «le scepticisme, le questionnement, la réfutabilité, le désintéressement ont été jetés à la poubelle pour nourrir des combats politiques qui n’ont rien à voir avec la science. Tous les efforts faits ces dernières années pour confronter les théories scientifiques aux observations et pour améliorer la méta-recherche (la recherche sur la recherche) ont été anéantis1.»
En août 2021, 330’000 articles sur le Covid avaient été publiés par un million de scientifiques provenant des 174 domaines de la science – y compris la branche de l’automobile! – souvent sans rigueur, tandis que des experts autoproclamés trustaient les médias et les plateaux télévisés.
Le constat est sévère. Ses auteurs comme la revue qui les publie ne sauraient être soupçonnés de complotisme. On a quitté le domaine de la science pour entrer dans celui de la religion et du tabou. Il est temps d’imiter le Danemark, d’arrêter de prendre les vaccinés pour des imbéciles et de renouer avec les fondamentaux et du droit et de la science.
1John P.A. Ioannidis and Michaela C. Schippers, «Saving Democracy From Pandemic», Tablet, Jan. 22, 2022, et «How Pandemic Is Changing the Norms of Science», Tablet, Sept. 9, 2021.
À lire aussi