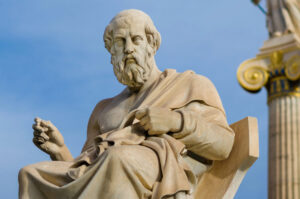De quoi la victoire de Pierre Maudet est-elle le nom?
© Liberté et justice sociale / Facebook
Les médias d’outre-Sarine n’ont pas manqué de souligner que ce ne serait certes pas à Saint-Gall que l’on aurait élu l’équivalent local d’un Maudet. Il n’y a qu’en France qu’un politicien poursuivi par la justice peut triompher dans les urnes (les exemples ne manquent pas en effet). En France et donc aujourd’hui à Genève, cet éternel cancre de l’helvétitude propre sur elle.
Il est vrai que le Foron2 tient plus du ruisseau que du fleuve et que les Genevois franchissent tout le temps la frontière, ne serait-ce que pour faire leur tiercé. Ça laisse des traces, forcément…
Aux yeux de certains, Genève n’est déjà plus en France mais pas encore en Suisse. Toutefois, cette tentative d’explication se révèle un brin paresseuse. Comme toujours en politique (et dans d’autres domaines où règne l’humain), les explications fourmillent.
Vote massif pour le seul Maudet
A noter, pour mesurer l’ampleur du succès de Pierre Maudet, qu’au second tour, 6’383 personnes ont voté exclusivement en sa faveur, sans ajouter d’autres candidats, soit 36 fois plus que la moyenne de ses concurrents. On ne saurait donc parler d’une victoire au rabais. Cela démontre aussi que ce n’est pas parce qu’un politicien est vilipendé par les médias qu’il en devient impopulaire.
Parmi les nombreuses causes de cette réélection, nous hasarderons celle-ci: la vieille nostalgie du radicalisme à la Genevoise que Pierre Maudet a su habilement ranimer. La fusion à Genève entre les radicaux et les libéraux ne s’est pas conclue de gaieté de cœur le 24 mai 2011. Les deux partis cantonaux ne pouvaient guère faire autrement, la fusion ayant été actée sur le plan fédéral dès 2008. L’opinion largement partagée à l’époque affirmait que les profondes divergences qui les avaient opposés appartenaient au passé et que désormais plus grand-chose ne les séparait au XXIème siècle.
Culture historique divergente entre radicaux et libéraux
Mais l’appartenance politique n’est pas faite que de calcul rationnel, elle est aussi l’expression de la culture d’un groupe. Cette culture est d’autant plus prégnante qu’elle est ancrée profondément dans l’histoire.
Issus tous deux deux du libéralisme né au début du XIXème siècle, ils ont rapidement divergé. Les libéraux du Parti démocratique (futur Parti libéral) étaient principalement issus des milieux patriciens et de la haute finance, regardant surtout vers les investissements à l’étranger. (A lire cette interview de l’historien Olivier Meuwly dans Le Temps).
Les radicaux, eux, venaient du faubourg populaire de Saint-Gervais composé d’artisans, d’horlogers, de cabinotiers. L’opposition entre «la fabrique» radicale et les patriciens a structuré une grande partie du XIXème siècle genevois et a fait sentir ses effets jusqu’au XXème.
L’héritage révolutionnaire de James Fazy
Le Parti radical et son fondateur James Fazy ont conduit la Révolution de 1846 qui a établi les fondations de la Genève moderne. Les radicaux étaient donc de fervents progressistes ennemis des conservatismes. L’autre grande figure du radicalisme à la genevoise, Georges Favon, se situait d’ailleurs à gauche sur l’échiquier politique en concluant des alliances avec les socialistes, force alors émergente. Le Parti radical genevois était à la fois partisan de la libre entreprise et d’une régulation raisonnée (et si possible raisonnable!) par l’Etat de certains secteurs de l’économie libérale.
Cette divergence de politique économique entre les radicaux et les démocrates (libéraux) de l’époque est notamment illustrée par cet extrait de l’histoire de la Banque cantonale genevoise tirée du site de la BCGe:
«Le régime radical instauré par James Fazy souhaitait développer l’économie. Les banquiers privés genevois n’entendaient pas investir dans un canton dont le gouvernement leur était hostile. Pour améliorer le commerce, moderniser l’agriculture, mécaniser l’industrie, il fallait des crédits. Pour James Fazy, le crédit était l’art de multiplier les capitaux. Il décida de créer la Caisse hypothécaire, en faveur des agriculteurs. La Caisse hypothécaire fut fondée le 21 avril 1847, date de l’adoption de la nouvelle constitution.»
De gauche à droite
De parti de gauche qu’il était, le radicalisme genevois s’est progressivement déplacé vers le centre-droit au fur et à mesure de la progression du Parti socialiste et des autres formations de gauche. Mais l’opposition entre les libéraux et les radicaux – tenants d’une toujours hypothétique troisième voie –, est restée sensible au XXème siècle, même si elle avait perdu de son intensité3. Ainsi les radicaux restaient favorables à des interventions bien ciblées de l’Etat, ce que les libéraux redoutaient.
Maudet ressort la vieille devise radicale
Les conditions qui prévalaient jadis n’ont certes plus grand chose à voir avec celles d’aujourd’hui. Il n’en demeure pas moins que les imprégnations socio-culturelles persistent et que le retour de Pierre Maudet au pouvoir signifie aussi que la greffe du Parti libéral-radical n’a pas aussi bien réussi qu’espéré à sa création.
Pierre Maudet a donc surfé avec succès sur cette nostalgie. Et ce n’est certes pas un hasard s’il a intitulé son mouvement «Liberté et justice sociale». C’était la devise du «vieux» Parti radical («Liberté humaine et justice sociale»). Sur le site du mouvement, Maudet affiche clairement ce retour aux sources en se disant inspiré par «l’essence républicaine du radicalisme genevois».
La droite doit-elle se réjouir?
La réélection de Pierre Maudet a privé la gauche de sa majorité au gouvernement genevois. La droite doit-elle s’en réjouir? A première vue, la réponse semble affirmative. Toutefois, si l’on consulte le programme du mouvement Liberté et justice sociale, il apparaît que Pierre Maudet va piocher ses projets dans de nombreux azimuts.
Ainsi, il propose la création d’une caisse-maladie cantonale publique, idée déjà défendue par l’ancien conseiller d’Etat MCG Mauro Poggia et par… le Parti du Travail!
En outre, la gauche genevoise ayant abandonné la défense de la laïcité, Pierre Maudet (concepteur de la Loi sur la laïcité de l’Etat4) ne manquera sans doute pas de porter ce sujet sur le devant de la scène politique.
Bref, entre les trois conseillers d’Etat de droite et les trois «ministres» de gauche, Pierre Maudet ne manquera pas de faire monter les enchères.
1Pour les non-Piogriens: surnom de la République et canton de Genève; histoire de varier un peu les qualificatifs « bateaux » du genre « Cité de Calvin », « la Ville du bout du lac , «la Cité du Jet d’eau».
2Toujours pour les non-Piogriens: le Foron est le modeste cours d’eau qui sépare Genève de la Haute-Savoie, à Ambilly, aux portes d’Annemasse.
3Trace anecdotique mais parlante de cette culture, la section eaux-vivienne du Parti radical genevois s’appelait «Association radicale-socialiste des Eaux-Vives».
4Par souci de transparence déontologique, l’auteur de cet article signale qu’il a présidé le collège d’experts auteur du rapport sur la laïcité à Genève, à la demande de Pierre Maudet en 2013-2014.
À lire aussi