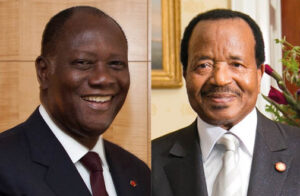Corne de l’Afrique: l’amour ne dure qu’un an?

Le président de l’Erythrée, Issayas Afeworki (à gauche), et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Gondar (Ethipoie), le 9 novembre 2018. – © Eduardo Soteras/ AFP
Sonia Le Gouriellec, Sciences Po – USPC
À l’été 2018, les observateurs ne cachaient pas leur surprise de voir enfin se résoudre un conflit vieux de vingt ans qui a constitué un véritable nœud de crispation dans les tensions régionales. Le président érythréen Issayas Afeworki foulait le tapis rouge déployé pour l’accueillir à l’aéroport d’Addis Abeba. Il était reçu chaleureusement par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et l’ambassade érythréenne rouvrait dans la foulée ses portes.
Le chef du gouvernement éthiopien annonçait alors son intention d’appliquer l’accord de paix signé en 2000 et de restituer à l’Érythrée la ville de Badmé, objet du conflit frontalier entre 1998 et 2000 et à l’origine d’une situation de «ni guerre ni paix» pendant vingt ans entre les deux pays. Quelques semaines plus tard, le 16 septembre 2018, à Jeddah (Arabie saoudite), l’accord de paix entre les deux États était symboliquement signé.
Il y a un an, nous analysions ce processus de paix à travers une dynamique globale dans laquelle s’inscrit la région et à laquelle venaient s’adjoindre des nécessités nationales. Aujourd’hui, qu’en est-il?
Une zone stratégique et attractive
La Corne de l’Afrique étant une zone stratégique du système international, elle attire régulièrement de nouveaux acteurs :
-
les États du Golfe, avides d’asseoir leur hégémonie régionale;
-
des puissances globales comme la Chine dont les investissements se sont multipliés ces dernières années sur «l’autoroute commerciale» que représente la mer Rouge;
-
et enfin des partenaires occidentaux, peu à l’aise avec l’initiative chinoise de «nouvelles routes de la Soie», perçue comme un «cheval de Troie» chinois et dont le principal objectif, selon eux, serait de déployer son expansionnisme en Afrique.
Il convient d’ajouter à ce tableau le fait que les régimes de la Corne ont besoin de soutiens financiers extérieurs pour se maintenir – ce qui rend le parrainage du processus par des acteurs externes indispensable. Et l’on constate que le processus n’échappe pas, loin de là, à des considérations strictement économiques d’autant que la coopération économique était un des piliers de l’accord de paix entre l’Éthiopie et l’Érythrée.
Les facteurs internes du rapprochement
Des contraintes nationales, par ailleurs, sont venues se greffer à cette dynamique régionale et globale, comme la nécessité pour le régime érythréen de sortir de son isolement international, et pour l’Éthiopie de faire face aux contestations sociales et à une crise monétaire sévère. L’ensemble de ces facteurs réunis explique et rend évident un tel mode de rapprochement entre les deux pays.
Et pourtant, un an plus tard, la situation paraît s’être figée. Certes, le processus de paix a permis la réouverture des ambassades, la création d’une liaison aérienne entre les deux pays et l’amnistie aux rebelles réfugiés en Érythrée, mise en œuvre. Des opportunités commerciales et financières ont également émergé. Ainsi, l’Érythrée est aujourd’hui mieux approvisionnée.
Mais à la faveur de l’ouverture de la frontière, pendant plusieurs mois des centaines d’Érythréens ont quitté chaque jour leur pays pour s’installer en Éthiopie. Et aujourd’hui, la frontière est de nouveau fermée, sans raison officielle.
L’Érythrée, la variable inconnue de l’équation sécuritaire
Plus que jamais, la variable inconnue dans l’équation sécuritaire régionale reste «l’Érythrée d’Afeworki», difficile à cerner.
Cet État est effectivement sorti de son isolement international, mais le service national, qui a causé la fuite de milliers d’Érythréens depuis son instauration, n’est pas pour autant aboli, alors même que les raisons de sa mise en place sont censées ne plus exister avec l’accord de paix.
Il n’y a toujours pas de Constitution ni d’élection, et le même Président est au pouvoir depuis l’indépendance en 1993. Les groupes religieux qui appellent à la réforme sont ciblés par des campagnes d’arrestations et de harcèlement.
Les Érythréens restent très inquiets pour la souveraineté du pays, acquise de longue lutte au début des années 1990 et les frustrations se multiplient. Ainsi, l’accord passé entre l’Éthiopie et la France pour la formation d’une marine éthiopienne a causé de nombreux débats quant à l’accès à la mer qu’envisagerait le régime éthiopien pour cette marine: le port érythréen d’Assab ou Djibouti?
Crise fédérale en Éthiopie
L’Éthiopie connaît, quant à elle, une crise politique majeure. Le 22 juin 2019, un coup d’État a révélé les limites de la politique réformatrice du premier ministre Abiy Ahmed. Alors qu’à Bahar Dar, dans le nord du pays, le gouverneur de la région Amhara a été assassiné, au même moment, dans la capitale, le chef d’état-major était tué par son garde du corps.
D’après René Lefort, cette tentative de coup d’État serait le symptôme de l’échec de la décolonisation interne de l’Éthiopie depuis la fin du XIXe siècle. À cette période, le pouvoir était centralisé sur les hauts plateaux abyssins. Les Amhara et les Tigréens se partageaient le pouvoir et ont, petit à petit, conquis les périphéries en y installant un système de type colonial. La Constitution de 1995 n’est pas parvenue à résoudre ce différend historique entre communautés. Les élites éthiopiennes se doivent de prendre conscience du problème si elles veulent éviter un éclatement du pays.
Le pays de 105 millions d’habitants traverse une crise fédérale qu’Abiy Ahmed est bien en peine de régler. Depuis 1995, la Constitution reconnaît sur des bases ethniques neuf régions, mais à l’intérieur de celles-ci les mouvements ethno-nationalistes s’opposent aux unionistes, comme dans la région Amhara.
Malgré ces fortes dissensions internes, le premier ministre éthiopien n’hésite pas à jouer les médiateurs dans plusieurs conflits, tant au Soudan qu’entre la Somalie et le Kenya.
Inquiétude à Djibouti
Du côté de Djibouti, les interrogations demeurent. L’euphorie, liée à la place accordée au pays dans l’initiative chinoise des nouvelles routes de la Soie, a laissé place à l’inquiétude face à l’ampleur de la dette contractée.
Malgré un rapprochement de façade, les relations restent tendues avec l’Érythrée, et la question du retour des prisonniers du conflit frontalier de 2008 entre les deux pays n’est pas réglée. Le régime d’Ismaïl Omar Guelleh (dit «IOG»), au pouvoir depuis 1999, s’est trouvé marginalisé lors des discussions de paix régionales, alors même que le pays s’est construit une identité de «havre de paix» dans une région plus qu’instable.
Son différend commercial et personnel avec les Émirats arabes unis ne semble pas étranger à cette mise à l’écart. Beaucoup d’accrochages ont en effet émaillé les relations entre le prince héritier Mohammed ben Zayed et IOG, dont le plus important reste la nationalisation du port, en 2018.
Une occasion historique
On doit, malgré tout, se féliciter de l’accord de paix signé à l’été 2018 entre l’Érythrée et l’Éthiopie. Il représente en effet une occasion historique pour les États et les peuples de la région. Mais cette paix reste précaire et de nombreux dossiers sont en suspens: accès aux ports érythréens, délimitation de la frontière, etc.
Une période de transition s’est ouverte, en parallèle de ce processus régional, pour chacun des régimes de la région. La consolidation de la paix dépendra en grande partie de l’achèvement de cette période de transition. Or, les contestations populaires demeurent dans chacun des États et les précédents soudanais et algériens ont crispé les régimes locaux. Il faut espérer que le «vent de paix» ne laisse pas place à un orage.
![]()
Sonia Le Gouriellec, Maître de conférence à l’Université catholique de Lille, Sciences Po – USPC
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
À lire aussi