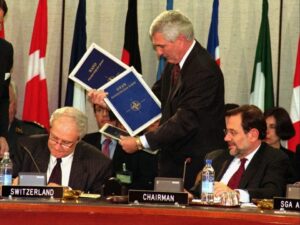Que me vaut la SSR?

Le logo (vintage) de la télévision romande, entre 1954 et 1958. © TSR
Un certain nombre de parlementaires parlent d’une fuite en avant du gouvernement. Pouvons-nous les croire sincères? Le contre-projet répond-il à nos attentes?
Les fonds et … le fond
En choisissant le titre «200 francs ça suffit!», le comité d’initiative – essentiellement composé par des membres de l’UDC – a voulu indiquer que son objectif principal est de faire faire des économies aux ménages. De fait, avec l’initiative non seulement les ménages paieraient 200 francs au lieu de 335, mais les entreprises seraient totalement exonérées de la redevance, et le financement des émetteurs privés bénéficiant d’une concession serait préservé. Ceci entrainerait que, en gardant les clés de répartition actuelles, la SSR verrait sa part de la redevance passer de 1’265 millions de francs à environ la moitié, soit 630 millions. De même, pour l’unité romande RTS on passerait de 410 millions à 208. Les ménages paieraient 40% en moins, mais pour la SSR il s’agirait de diviser les entrées par deux. (C’est pourquoi en allemand l’initiative a été appelée «Halbierungsinitiative».) Ainsi, si l’initiative était acceptée, la SSR devrait (très rapidement) se redimensionner, ce qui est évidemment le vrai objectif du comité d’initiative. Pour étayer cette affirmation, il suffit de se souvenir que les membres de ce comité avaient soutenu l’initiative No-Billag, qui voulait carrément supprimer la redevance. (Le peuple l’a refusée avec une majorité de 71,6% de voix contraires). Le comité n’a pas explicité comment la SSR devrait être redimensionnée, laissant entendre que la discussion en vue de la votation sur l’initiative allait permettre de débattre du fond de l’affaire, à savoir quel est le futur souhaité pour le service public média.
Avant de voir comment le comité entend affronter cette question, arrêtons-nous sur d’autres aspects de l’initiative, et quelques chiffres. L’initiative prévoit que le montant de 200 francs pour la redevance soit inscrit dans la Constitution, et que ce soit au législateur de définir ce qu’est un «service [de la SSR] indispensable à la collectivité». Ces points pourraient sembler anodins, mais il subvertissent l’actuelle répartition des compétences entre le Conseil fédéral (CF) et l’Assemblée nationale. Actuellement, le pilotage matériel de la SSR est assuré par le CF à l’aide de deux instruments reliés entre eux, qui sont justement la fixation du montant de la redevance et la définition de la concession. C’est la concession qui précise le service que la SSR doit fournir. Cette organisation a fait ses preuves, et comme le note le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt de novembre 2023: «le législateur s’est délibérément abstenu de préciser le montant de la redevance au niveau législatif, aux fins d’empêcher le Parlement d’influencer indirectement la programmation, le cas échéant en réduisant les fonds, ce qui mettrait en péril l’indépendance de la radio et de la télévision garantie par l’art. 93 al. 3 de la Constitution».
On pourrait donc penser que le comité d’initiative essaie de contourner un principe constitutionnel. Si cela ne suffisait pas, l’initiative prévoit aussi que la redevance ne serve qu’à financer des offres linéaires, donc radio et télévision. Or, comme le note le CF «l’utilisation des médias se déplace de plus en plus des programmes de radio et de télévision linéaires vers les médias en ligne et les médias sociaux», et on peut même dire avec la Commission fédérale des médias (COFEM) que «pour le service public média, la transformation en fournisseur multimédia de services journalistiques est inéluctable». Ainsi, limiter le financement par la redevance aux seules offres linéaires revient à empêcher la SSR de suivre un développement nécessaire, et donc la condamner à ne pas pouvoir faire face aux défis de notre temps.
Rappelons maintenant quelques chiffres. On pourrait penser que la SSR est un géant bénéficiant d’un financement démesuré. Elle est effectivement la plus grande entreprise média suisse avec 7’200 collaborateurs, pour 5’700 postes à temps plein, ce qui correspond à peu près à la somme des employés de Ringier (2’300), TX-Group (anc. Tamedia, 3’700), et NZZ-Mediengruppe (850) réunis. Pourtant en comparaison européenne elle n’est pas la mieux financée: les diffuseurs publics allemands disposent de presque 10 fois plus de moyens financiers que la SSR, ceux du Royaume-Uni 6,5 fois plus, les Français 4 fois plus, et les Italiens 3 fois plus. En outre, en 2014, la redevance a déjà été baissée de 412 francs aux actuels 335.
Dans ces conditions on voit mal comment l’initiative pourrait amener à un débat serein sur le fond. A ces considérations on peut ajouter qu’un des membres du comité d’initiative vient de déposer une motion au Conseil national par laquelle il demande la suppression de la COFEM. Ses motivations sont spécieuses: il lui reproche d’être influencée idéologiquement, loin des réalités économiques, et de la pratique. Or, la composition de la Commission contredit la dernière affirmation, et le fait que le CF prenne régulièrement en compte les avis de la COFEM montre que ses analyses ne portent pas de biais idéologique majeur. Il se trouve que la COFEM a récemment publié des pistes de réflexion sur «Le service public média à l’ère numérique» parmi lesquelles elle prône que «le service public média doit renoncer totalement aux recettes publicitaires au profit d’un financement public stable, fiable et suffisant». Ceci est clairement à l’opposé de ce que défend le comité d’initiative, et me paraît être une raison plus crédible du mécontentement du parlementaire qui aimerait voir disparaître la Commission. Malheureusement cette motion de censure semble indiquer comment le comité entend mener le débat sur le fond.
Le contre-projet du Conseil fédéral
Il est donc bienvenu que le CF ait formulé un contre-projet à l’initiative, au niveau de l’ordonnance. Ceci signifie que le CF fait une proposition dans le cadre de ses compétences. Il propose en effet de diminuer la redevance pour les ménages à 300 francs de manière progressive d’ici à 2029, et de préciser le mandat de prestations de la SSR dans la nouvelle concession (l’actuelle étant prorogée jusqu’en 2028). Les entreprises ne seront pas exonérées, et 80% d’entre elles devront payer une redevance. La SSR verrait ainsi sa part de la redevance réduite de 120 millions, ce qui est une diminution considérable, mais non létale.
Arrêtons-nous un instant sur la redevance pour les entreprises, vu que leurs représentants politiques clament haut et fort qu’il est injuste qu’elles paient cet impôt progressif calculé en fonction du chiffre d’affaires, et qui peut se monter à plusieurs milliers de francs. Il y a d’ailleurs régulièrement des entreprises qui contestent ce paiement, dû depuis 2019. Ces contestations ont amené à des modifications de détail de la loi, mais le Tribunal administratif fédéral vient de rappeler qu’il s’agit d’un impôt justifié par un «critère d’assujettissement territorial», car «les personnes morales profitent également d’un système de radiodiffusion fonctionnel et indépendant», même si elles «ne possèdent pas d’appareil de réception et ne consomment pas de programmes de radio ou de télévision».
Vu comment le CF a opéré par le passé, on peut espérer que – si le contre-projet est accepté – le nouveau mandat de prestations tienne compte des pistes esquissées par la COFEM. Celles-ci consistent à «ancrer le service public média en tant qu’infrastructure moderne, neutre en termes de technologie et de formats, accessible à l’ensemble de la population, dans toutes les régions du pays, de manière équivalente et sans obstacles». Ici, la neutralité technologique signifie qu’on ne favorise aucun moyen de communication plutôt qu’un autre. De plus, il faudrait «définir clairement les prestations du service public média au niveau du contenu et les différencier des offres commerciales», et, comme nous l’avons vu, la COFEM plaide pour un changement de système de financement, en renonçant totalement aux recettes publicitaires. De fait, «la publicité serait encore autorisée dans l’offre de télévision linéaire, mais les recettes seraient collectivisées au profit d’une aide générale aux médias».
Conclusion
La SSR est sous pression, et vu le climat créé par les initiatives successives on tend à ne pas lui pardonner les quelques erreurs qu’elle commet. Les erreurs graves peuvent être corrigées par les contrôles internes ou externes. Récemment le Tribunal fédéral a par exemple confirmé que l’émission Mise au point diffusée fin 2021 par la RTS, avant la votation sur la loi Covid, n’a pas respecté la pluralité des opinions. Pouvoir disposer d’un service public média de qualité est un enjeu capital pour la démocratie, notamment pour faire face à la désinformation croissante.
Le fait que des parlementaires souhaitent augmenter leur contrôle sur le service public n’est pas de bonne augure, surtout que le Conseil des Etats vient de formuler un postulat qui pourrait entraver le travail des journalistes d’investigation en Suisse. En chargeant le CF d’examiner «s’il convient de rendre punissable la publication de données récoltées illégalement» il met en péril les lanceurs d’alerte, et rend juridiquement instable le travail des journalistes qui nécessitent des données non libérées par leurs propriétaires, même si ceux-ci enfreignent la loi.
Pour terminer notons que si l’initiative «200 francs ça suffit!» vise à favoriser l’offre privée aux dépens de l’offre publique, il faut souligner (avec le CF) que seul un petit nombre de prestations actuelles de la SSR pourraient être reprises par des fournisseurs suisses privés. De plus les médias privés (presse) ne vont pas bien, et sont (aussi) obligés de procéder à des mesures d’économies et à des licenciements. Il n’est donc peut-être pas raisonnable de trop affaiblir un prestataire comme la SSR, qui somme toute réalise de manière satisfaisante son mandat.
À lire aussi