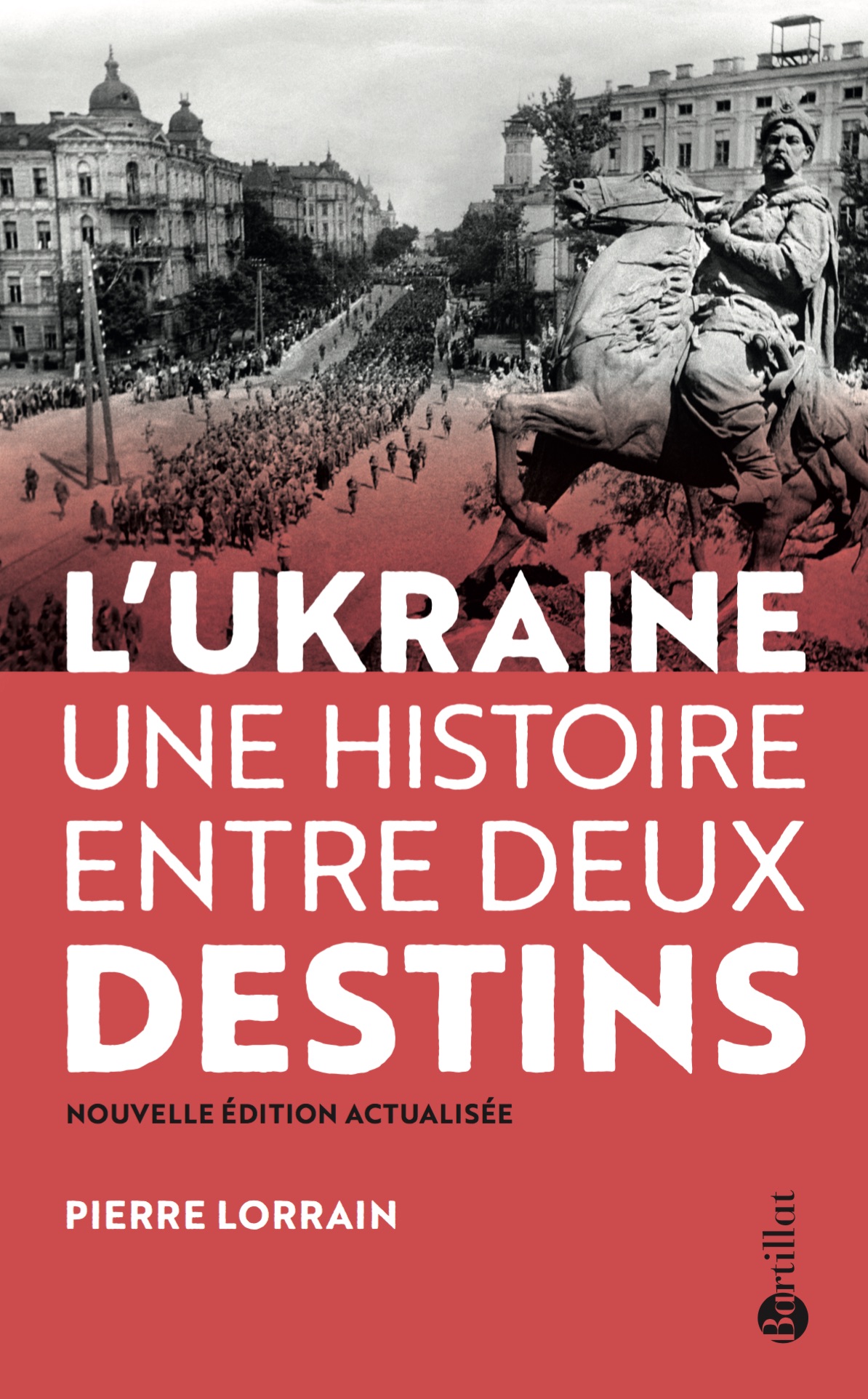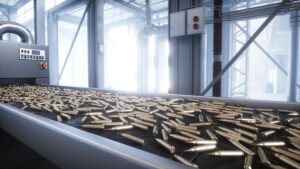Ukraine: sous les blessures d’aujourd’hui celles d’hier

Procession aux flambeaux en l’honneur de la figure du nationalisme ukrainien Stepan Bandera, le 1er janvier 2015 à Kyiv. – CC BY 3.0
Une somme qui va de la présence des Grecs, des Romains au Ier siècle… jusqu’à l’automne 2021. Ces terres ukrainiennes ont été, au fil de l’histoire, revendiquées par de grands empires, austro-hongrois et russe, par plusieurs nations, l’Autriche, la Prusse, la Pologne, la Turquie, en partie par la Hongrie et même par la Grèce. Dès le début du XXème siècle, l’Ukraine connut plusieurs guerres civiles, attisées par l’étranger, entre nationalistes et révolutionnaires, entre l’ouest et l’est. Avec à chaque fois des abominations commises dans tous les camps.
Aujourd’hui, devant l’agression russe, les Ukrainiens, pour la plupart, même russophones, s’unissent autour de leur gouvernement. On assiste peut-être à la véritable naissance d’une nation, plus évidente que lors de l’indépendance proclamée en 1991. Mais les traces, les blessures de l’histoire ne s’effacent pas d’un coup, même après un épisode aussi violent. Elles auront, ajoutées à celles d’aujourd’hui, leur part dans l’avenir du pays, une fois les armes tues.
Américains, nationalistes et oligarques
Qui n’a pas l’humeur de se plonger dans les temps anciens devrait au moins embarquer dans le récit au moment de la Seconde guerre mondiale. Les nationalistes ukrainiens s’allièrent aux Allemands et commirent avec eux des massacres de sinistre mémoire, comme celui des Juifs et des opposants à Babi Yar en 1941. A noter que leurs héritiers idéologiques d’aujourd’hui, admirateurs de leur leader Bandera, ont pignon sur rue à Kiev. Leur poids électoral est minime, à l’exception de la Galicie (ouest), mais ils sont très présents dans les rouages de l’Etat, en particulier dans l’armée qui a intégré leurs milices. Ces mouvances ultra-nationalistes inquiétèrent même George Bush senior, venu à Kiev en 1991 pour saluer l’indépendance: «Les Américains n’aideront pas ceux qui font la promotion d’un nationalisme suicidaire fondé sur la haine ethnique.» Piquant rappel au regard de l’actualité.
Lorsque les Soviétiques l’emportèrent en 1944, ils firent subir un sort cruel aux populations, en particulier à l’ouest, soumises à l’oppression stalinienne. La langue ukrainienne était mal vue. Plus tard, dans le cadre de l’URSS, la République d’Ukraine – formellement représentée comme telle à l’ONU! – connut des jours meilleurs mais en profondeur, les divisions ethniques et culturelles subsistaient sous le boisseau. Lors de l’effondrement de l’URSS, au moment de l’indépendance, le volcan enfoui libéra une série d’irruptions. A travers d’extrêmes tensions entre l’Ouest et l’Est du pays, avec une succession de présidences penchant plus ou moins d’un côté ou de l’autre. Sur le fond d’une vie politique marquée par la corruption des élites, les pouvoirs se trouvant sous la coupe des oligarques follement enrichis par la mainmise sur les biens publics. Tireurs de toutes les ficelles, divisés entre eux et se combattant sans cesse pour accumuler influence et richesses.
Tout s’accéléra en 2004. Avec la «révolution orange», soutenue déjà par les ONG américaines. L’arrivée d’un président pro-occidental qui ne tarda pas à s’épuiser. Puis une femme à poigne et à tresses. Et encore des tumultes…
Puis l’embrasement encore en 2014. Le président Ianoukovytch, revenu au pouvoir, avait espéré conclure des accords économiques à la fois avec l’Union européenne et avec la Russie, ce que les deux refusèrent. Il fut balayé par les manifestations de l’«Euromaïdan», devenues violentes de part et d’autre, fortement encouragées par les Américains qui envoyèrent sur place des personnalités de haut rang. Les Russes annexèrent sans coup férir la Crimée, où leur marine disposait déjà d’une base «en location». Les populations de l’est russophone se regimbèrent et les provinces de Louhansk et Donetsk réclamèrent l’autonomie, plus tard la sécession. L’armée ukrainienne intervint, la riposte s’organisa, avec le soutien distant mais armé de la Russie. La guerre du Donbass commençait. Huit ans plus tard, elle dure encore. Le conflit actuel en est le prolongement.
Les accords de Minsk, conclus grâce à la France, l’Allemagne, le gouvernement de Kiev et la Russie, avec l’aide de la Suisse, suscitèrent un espoir vite déçu. Peu partagé par les séparatistes. D’autre part, l’idée d’une Ukraine vaguement fédérale irrita vivement les nationalistes, les partisans d’un Etat unitaire… et les oligarques nullement intéressés à la mise en ordre du pays, qui profitaient du trouble pour conduire leurs transactions internationales, obscures et rémunératrices, sur le gaz et le pétrole.
Après maintes péripéties politiques donc, l’Ukraine entra, en 2019, dans l’ère Zelensky. Brillamment élu, un exploit, sur tout le territoire. Pierre Lorrain en fait un portrait favorable. Ce jeune homme, bien plus compétent que ne laissait supposer sa réputation initiale de «clown», fut élu sur un programme de paix. Il tenta de réactiver les accords de Minsk mais fut vite freiné par leurs adversaires. De même, nous déclare l’auteur aujourd’hui, il a réellement tenté, au lendemain de l’invasion du 24 février, de trouver une issue pacifique lors des pourparlers d’Istanbul qui, à un certain moment, parurent bien partis. Cette fois, selon Pierre Lorrain, ce sont clairement les Américains, omniprésents dans l’entourage du président et dans l’appareil de l’Etat, qui l’ont poussé à interrompre les négociations – le mot n’apparaît plus dans ses discours – et à poursuivre la guerre coûte que coûte, fort de l’aide militaire et financière massive des Etats-Unis et de leurs alliés. Dans le but non seulement d’aider l’Ukraine mais d’«affaiblir la Russie». Sombres perspectives.
Pour Pierre Lorrain, l’avenir ne peut plus passer par une solution telle qu’elle avait été envisagée, l’autonomie du Donbass. La Russie exigera son annexion, ainsi qu’une partie du sud, sur la côte de la mer d’Azov et de la Mer noire.
Le barrage infranchissable des ploutocrates
Tant de questions se posent. Jusqu’à quand la Russie peut-elle mener la guerre? Longtemps, selon ce connaisseur, car l’histoire témoigne assez de la résilience de ce peuple, parce que les sanctions renforcent plutôt le soutien de la plupart des Russes à Poutine. Les Ukrainiens paraissent en état de résister dans la durée mais à quel prix humain? Les Occidentaux resteront-ils unis sur la ligne offensive et intransigeante des Américains? Pas sûr, car les Allemands, les Français et d’autres pourraient enfin faire valoir une vision moins belliqueuse, plus orientée vers le dialogue. Et quand la guerre se terminera enfin, dans quel état sera l’Ukraine? Cassée, économiquement dévastée. Les conditions sociales, déjà lamentables avant la guerre, seront pires encore. Les milliards d’aide promis pour la reconstruction n’iront sûrement pas aux démunis. Et au plan politique? La vision angélique que l’on cultive en Occident de la star Zelensky ne doit pas nous leurrer. La démocratie au sens où nous l’entendons n’est pas pour demain.
La description très factuelle que fait Pierre Lorrain des institutions actuelles est accablante. Les efforts entrepris ces dernières années pour lutter contre la corruption généralisée ont quasiment tous échoué. L’Etat de droit? Fort précaire, la justice restant sous l’influence du pouvoir, l’espace laissé à la critique et à l’investigation journalistiques fort réduit. Le Tagesanzeiger vient de publier des témoignages qui disent l’inquiétude des journalistes de Kiev réduits à s’en tenir aux discours officiels. Quand la guerre sera finie, avec l’unité qu’elle requiert, «nous réglerons les comptes, les doigts nous démangent»!
Malgré des élections libres, le barrage des ploutocrates devant tout assainissement réel de la démocratie paraît infranchissable. Les trois quarts des députés au Parlement, la Rada, sont millionnaires en dollars, arrosés ou promus par leurs divers protecteurs. Quant aux tout gros, les milliardaires qui ont la main sur la plupart des entreprises de commerce, de construction, de médias, ils se frottent sans doute les mains à l’idée de voir affluer les aides internationales… en attendant les fonds européens. Qui peut croire qu’ils soient devenus soudain partageux? Ils ont en tout cas moins de soucis à se faire pour leur bas de laine à l’étranger que les oligarques russes.
«L’Ukraine, une histoire entre deux destins», Pierre Lorrain. Edition revue et actualisée, Editions Bartillat, 686 pages.
À lire aussi