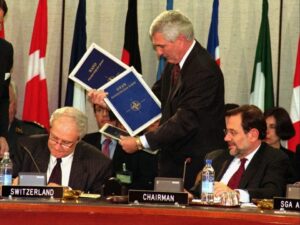PFAS: la Confédération coupe dans la recherche au moment le plus critique

Les substances chimiques éternelles toxiques (PFAS) ne peuvent être détectées qu’en laboratoire. © Shutterstock
Article publié sur Infosperber le 19 novembre 2025, traduit et adapté par Bon pour la tête
Les PFAS, ces «substances chimiques éternelles», s’imposent un peu plus chaque semaine dans l’actualité suisse. Dernier exemple en date: plus aucun poisson du lac de Zoug ne peut être vendu, après la découverte de concentrations trop élevées. Pour Monika Schoenenberger, du Tagesschau de la SFR (télévision suisse alémanque), le constat est clair: «Les PFAS sont présents dans presque toutes les catégories d’aliments. Il n’y a donc pas lieu de baisser la garde.»
Depuis des mois, les annonces se succèdent: il y a des PFAS dans l’eau potable, dans les sols de chantier, dans les terrains de sport, dans les produits laitiers, les saucisses, la neige… La liste ne cesse de s’allonger. Une équipe de recherche de l’ETH, conduite par Juliane Glüge, avait déjà mis en évidence en 2020 l’ampleur de la contamination. Aujourd’hui, une réalité s’impose: ces substances toxiques sont omniprésentes dans l’industrie et dans notre quotidien, des gobelets à emporter aux shampoings, en passant par les imperméabilisants ou même le papier toilette. Et rien n’oblige les fabricants à en signaler la présence.
Des valeurs limites longtemps trop permissives
Les normes en vigueur sont restées souples, notamment pour éviter que la moitié des denrées alimentaires ne deviennent soudain non conformes. Bruno Le Bizec, directeur du laboratoire européen Laberca, explique à la SFR: «Les valeurs limites reflètent aussi les possibilités d’action des fabricants. D’où une mise en œuvre lente et progressive.»
La Suisse, alignée sur l’UE, renforce désormais ses contrôles — ce qui contribue aussi à la multiplication des cas.
La Confédération pointée du doigt
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a sévèrement critiqué la gestion fédérale du dossier. Selon son rapport, la Suisse ne respecte pas suffisamment le principe de précaution: il manque un système de surveillance national permettant de mesurer l’ampleur réelle de la contamination.
Pour combler cette lacune, un vaste projet de recherche a été lancé: près de 800 personnes des cantons de Vaud et de Berne ont fourni des échantillons biologiques, analysés pour 30 PFAS différents. Les premiers résultats sont alarmants: la quasi-totalité des participants étaient contaminés, plus de la moitié dépassaient les limites de sécurité, et 4 % atteignaient des valeurs fortement préoccupantes.
Ce malgré l’interdiction, depuis plusieurs années, des substances les plus courantes, comme le PFOS et le PFOA — ce dernier étant associé à certains cancers. «Si l’on ne fait rien, les cas vont augmenter», avertissait en 2024 Natalie von Götz, experte à l’OFSP. L’ETH abondait: certains participants pourraient développer des maladies liées à leur exposition.
Une étude nationale suspendue en secret
Pour comprendre l’impact réel des PFAS sur la santé, l’OFSP avait prévu une grande étude nationale de biosurveillance portant sur 100 000 personnes. Le Conseil fédéral avait donné son feu vert en 2023. Mais coup de théâtre: au printemps 2025, l’OFSP a interrompu les travaux préparatoires — une décision restée secrète pendant des mois. Selon des documents obtenus via la loi sur la transparence, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a gelé le projet dès février 2025, à la demande de l’OFSP, en raison du contexte budgétaire.
L’argument: le projet pourrait coûter jusqu’à 12 millions de francs par an, voire 5 millions dans une version réduite. Un montant pourtant modeste comparé, par exemple, aux 14 millions de subventions versées annuellement aux producteurs de tabac.
Des économies qui inquiètent le milieu scientifique
Le gel de ce projet s’inscrit dans le vaste «paquet de mesures d’allègement» voulu par le Conseil fédéral. Le groupe d’experts dirigé par Serge Gaillard propose de réduire les dépenses dans la recherche, malgré des justifications parfois jugées faibles ou lacunaires. Paradoxalement, ces coupes visent à financer l’augmentation des dépenses militaires sans hausse d’impôts.
Plusieurs secteurs scientifiques, dont les hautes écoles et le Fonds national, seraient affectés. Les milieux académiques dénoncent des mesures contre-productives pour un pays qui dépend fortement de la recherche et de l’innovation.
Le Parlement aura le dernier mot
Le Parlement doit encore se prononcer. La majorité actuelle, plutôt favorable aux économies, a récemment rejeté un renforcement de la protection contre les substances chimiques environnementales — autorisant ainsi la commercialisation de viande contaminée par des PFAS et affaiblissant davantage la protection des eaux.
Si le projet d’étude nationale échoue, seule une cohorte régionale pourrait subsister: Bâle-Ville se dit prête à poursuivre un modèle local. Mais pour la directrice de l’étude, la professeure Nicole Probst-Hensch, le renoncement suisse serait dramatique: «Ne pas disposer d’une telle infrastructure est une catastrophe pour le paysage scientifique.» L’Allemagne, elle, suit déjà plus de 200 000 citoyens depuis 2014.
À lire aussi