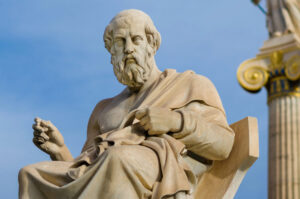Le soutien transparent de la Suède aux médias
Un numéro de 2007 du journal local « Norrköpings Tidningar » qui reçoit chaque année de l’argent de l’Etat suédois pour son travail de rédaction © cc-by-sa-3 Jollemann
Pascal Sigg, article publié sur Infosperber le 23 septembre 2024, traduit par Bon Par La Tête
L’annonce du groupe de médias TX Group de bientôt investir nettement moins dans le journalisme a provoqué un tollé. Le groupe se détourne clairement du journal imprimé. Les journaux Tamedia continuent notamment à se retirer de l’échelon local et régional. Son concurrent CH Media a ainsi pris les devants en Suisse centrale. Parallèlement, on a appris à Zurich que la famille Blocher s’était portée acquéreur de quatre feuilles locales.
Il est indéniable que ces décisions ont un impact sur la démocratie. C’est pourquoi les politiques doivent maintenant soutenir les médias de façon adaptée aux circonstances du temps, entend-on dans tout le pays. Il y a deux ans et demi, un paquet de mesures de 150 millions en faveur des médias a été rejeté par les urnes.
Dès cet après-midi, le Parlement se penchera lui aussi sur le soutien aux médias. Mais avec réticence et hésitation. Il est en train de bricoler un patchwork de différentes mesures qui seront décidées séparément. Le soutien temporaire à la distribution de journaux doit être renforcé.
Ce n’est que lorsque cette aide indirecte aura pris fin, dans sept ans, que les médias recevront directement de quoi financer le journalisme en ligne. Il s’agit d’une proposition du rapport «Stratégie pour un soutien aux médias tourné vers l’avenir». Elle n’est manifestement pas si «orientée vers l’avenir». Car en forçant un peu le trait, Berne s’attache à sauver un système médiatique obsolète pour l’avenir.
L’aide directe aux médias, un acquis incontesté en Suède
Un regard sur la Suède montre à quoi pourrait ressembler une aide aux médias moderne. Depuis cette année, ce grand pays de 10 millions d’habitants soutient les médias d’une nouvelle manière, indépendamment de la technologie. Cela ne fonctionne pas sans heurts. Mais cela fonctionne.
Et cela ne va pas non plus de soi, car la Suède a elle aussi connu une transition politique difficile. Depuis les années 1960, le pays pratique le soutien direct à la presse. Il s’agissait notamment de maintenir les titres de presse dans les régions rurales et de faire en sorte que plusieurs titres puissent coexister et se faire concurrence.
Ceux qui voulaient recevoir de l’argent de l’Etat devaient répondre à un catalogue de critères élaboré. Les leaders du marché n’étaient par exemple pas éligibles au soutien. Mais ceux qui remplissaient les conditions étaient assurés de recevoir des financements. Ainsi, plus il y avait de médias éligibles, plus l’Etat devait dépenser pour le soutien aux médias.
Ce «soutien à l’exploitation» était relativement équilibré et protégeait bien les éditeurs de l’influence de l’Etat. Après quelques changements, les médias édités uniquement en ligne pouvaient aussi recevoir de l’argent s’ils remplissaient les critères.
Mais les médias imprimés ne devaient pas nécessairement se confronter au marché des lecteurs en ligne pour recevoir de l’argent. Comme en Suisse, on a donc pointé le fait que l’Etat, par ses subventions, maintenait artificiellement en vie un ancien système médiatique, le papier, au lieu de faire face au présent numérique.
Un tournant dans le soutien aux rédactions
L’automne dernier, la Suède a opéré un tournant sous le gouvernement de centre-droit. Contrairement à la Suisse, tous les partis étaient d’accord pour dire que le pays avait besoin d’un soutien direct aux médias. Mais le gouvernement voulait en limiter l’ampleur. C’est pourquoi la gauche a également dénoncé la réforme comme étant une mesure de réduction cachée et une atteinte à la diversité du paysage médiatique. La majorité de centre-droit s’est toutefois imposée au Parlement.
La Suède pratique désormais trois types de soutien aux médias:
- un soutien au travail de rédaction proprement dit;
- un soutien rédactionnel élargi (pour les régions peu pourvues en offre médiatiques et les groupes minoritaires);
- un soutien à la distribution des médias imprimés.
A cela s’ajoutera prochainement un soutien transitoire pour les médias qui ne recevront plus d’aide à la rédaction dans le nouveau système. Il est en effet désormais plus compliqué d’obtenir une partie du milliard de couronnes (un peu plus de 80 millions de francs) et le processus est plus imprévisible.
Un média éligible doit paraître régulièrement, proposer un contenu pertinent pour sa zone de publication et être composé d’au moins 45% de contenu rédactionnel.
Le catalogue de critères est vaste. Ce sont surtout les exigences formulées de manière floue qui ont donné lieu à discussions. Ainsi, un média doit désormais présenter un «bon ancrage auprès des utilisateurs». Cela est défini par un nombre minimum d’utilisateurs réguliers ou d’abonnements. En outre, il doit avoir pour «mission première de diffuser en permanence des informations pertinentes».
Les critères
- Média d’information généraliste. Ils comprennent des exigences détaillées en matière de mode de parution, de volume et de contenu. Ainsi, le journalisme ne doit pas porter directement atteinte aux valeurs démocratiques fondamentales et doit respecter la liberté et l’intégrité personnelle de tous les individus.
- Un titre propre avec un produit principal indépendant. Cela implique des critères garantissant l’indépendance par rapport à d’autres publications.
- L’éditeur responsable est identifié.
- Groupe cible suédois et bonne accessibilité pour les personnes handicapées.
- Fréquence de parution régulière.
- Bon ancrage dans le public. Cela inclut des critères détaillés en fonction du groupe cible. Par exemple, les médias dont les reportages couvrent un espace de moins de 20’000 habitants doivent pour cela atteindre 15% du groupe cible, mais pas moins de 1’500 personnes.
Le pouvoir du public
Ce printemps, un comité a évalué pour la première fois dans quelle mesure un journal ou une radio remplissait ces critères. Le comité «Mediestödsnämnden» est composé d’experts indépendants – dont deux journalistes. Ces derniers sont toutefois choisis par le gouvernement. Le comité publie les procès-verbaux de ses réunions.
C’est par le biais de ce comité que le pouvoir pourrait exercer l’influence la plus directe sur les médias et sanctionner les reportages critiques. Mais en Suède, ces préoccupations n’existent guère. Cela s’explique sans doute par les premières attributions communiquées par le comité au printemps dernier. Ce sont surtout les journaux locaux et régionaux qui ont été soutenus.
Par exemple, Falu-Kuriren, le principal média de la région de Dalécarlie, au centre de la Suède, avec un tirage légèrement inférieur à 20’000 exemplaires, a reçu près de 600’000 francs (un peu plus de sept millions de couronnes). Les grands titres comme Svenska Dagbladet, Aftonbladet ou Expressen n’ont pas reçu d’argent parce qu’ils ne pouvaient pas justifier de besoins financiers.
L’attribution ne s’est toutefois pas faite sans bruit. De nombreux petits médias à orientation nationale, dont certains ont un profil explicitement politique, comme le journal du parti social-démocrate, n’ont pas été retenus.
Mais pour les médias concernés, la disparition prévisible de la subvention est aussi un encouragement. Leonidas Aretakis, rédacteur en chef du magazine de gauche Flamman, a annoncé qu’il avait pu enregistrer, à la place, des recettes nettement plus élevées. Le magazine s’en est donc trouvé renforcé.
Publicité honnête
Ainsi, l’approche suédoise semble comparativement honnête, précisément parce qu’elle ne se déroule pas sans heurts. Parce que la réforme est venue du camp bourgeois, la gauche a été très critique. C’est ainsi qu’est né un véritable débat objectif sur le type de journalisme qui mérite d’être soutenu par l’Etat. De quoi un média doit-il parler? A quelle fréquence? De quelle manière? La Suisse fuit ces questions comme un adolescent complexé.
Avec des lunettes suisses, on s’aperçoit en outre que l’argent n’est pas un problème dans ce débat. La Suède dépense pour le soutien aux rédactions à peu près autant que la Suisse pour les seules chaînes de radio et de télévision privées. Avec cette subvention issue du prélèvement obligatoire de la redevance radio et TV, la Suisse soutient déjà deux branches médiatiques. Cela permettrait de financer 800 postes rédactionnels à temps plein par an, indépendamment du genre.
Alors que la Suède encourage expressément la démocratie et la diversité des médias avec cet argent, les exigences envers le cercle beaucoup plus restreint des bénéficiaires de ces fonds sont moins élevées dans notre pays. Il n’existe toutefois pratiquement pas de stations de radio ou de télévision à vocation locale en Suède.
Mais l’exemple suédois montre surtout, malgré toutes les discussions sur la non-prise en compte de certains médias, que la crainte d’une influence de l’Etat et d’autres politiques dans le cadre d’un soutien direct aux médias semble très exagérée dans ce pays. Du moins tant qu’aucun parti ne gouverne le pays avec une majorité absolue. La Suède est elle aussi encore loin de cette situation.
À lire aussi