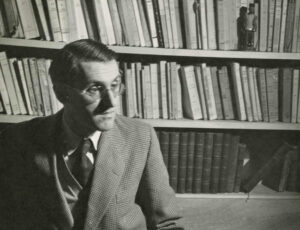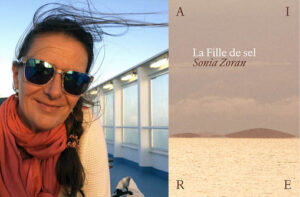Le roman noir en France, incarnations diverses

© Zoya Loonohod via Unsplash
Réalisme et naturalisme
Emile Gaboriau et Gaston Leroux sont les chroniqueurs judiciaires tout autant des petites transgressions des normes sociales que des moments de brusque déséquilibre dans l’ordre des choses. La majeure partie des faits divers relatés par la presse du XIXème siècle ne sont pas des crimes spectaculaires, de grandes affaires retentissantes, mais de minuscules incidents de la vie quotidienne, des crimes sans éclats.
Le roman réaliste et naturaliste, Dostoïevski, Flaubert et Balzac, ce sont eux, l’héritage revendiqué du roman noir. Il s’agit de représenter la réalité sociale et, comme le disait Zola dans la préface de L’Assommoir, de rédiger une œuvre de vérité qui ait la vitalité et l’odeur du peuple.
Prolétaires et classes moyennes
Le roman dit prolétarien ne sera pas grand-chose et, contrairement à Céline, n’usant pas de la vraie langue du peuple, il ne rencontrera jamais son public. C’est ce que lui a raté que le roman noir va réussir, avec des auteurs paradoxalement issus de la grande bourgeoisie: Boris Vian et José Giovanni; ou avec des auteurs qui n’ont fréquenté que l’école primaire, comme Léo Malet, Auguste Le Breton, George Simenon et Albert Simonin.
Dur à cuire
1943 est l’année de l’adaptation en France du hardboiled made in USA avec la naissance de Nestor Burma dans le 120, rue de la Gare de Léo Mallet, récit tissé d’effets de réel, d’écriture à la première personne, de notations de détails sans fonction, d’enracinement dans tel ou tel quartier. Mallet décrit la cité Jeanne-d’Arc, ilot insalubre, ruisseau central, trottoirs inexistants, poubelles débordantes d’immondices jamais enlevées et assiégées par des chats, des chiens et des rats. Maisons étayées par de gros madriers goudronnés. Ça pue les latrines bouchées. Pas mal de vitres cassées remplacées par des morceaux de carton, des tuyaux de poêle pointant par diverses ouvertures, du linge étendu sur des barres d’appuis. On dirait une enquête de Zola, mais lui, Malet, a tout inventé et en ne s’inspirant non pas de Dashiell Hammett ou de Scarface, mais d’Arsène Lupin, Fantômas et Fu Manchu d’où est tiré le patronyme Burma; et en usant de nombreux emprunts à l’anglais: trench-coats, cop, docks, drugstore, building, policemen, barmaid ou knock-out.
La Série noire
En 1964, Sartre, dans son autobiographie, Les Mots, déclare qu’il lit plus volontiers un Série noire que Wittgenstein. Cette nouvelle collection a été lancée par Gallimard en 1945, pour publier des romans hardboiled. Peu de titres au début mais dès 1948 la collection entre dans l’ère fordiste des littératures de genre, standardisation et mode de fabrication contraints aussi bien dans la matérialité des volumes que dans l’identité des textes, avec imprimé sur les rabats de la jaquette. Donnés comme les traits principaux des ces ouvrages: l’immoralité, l’anticonformisme, l’action, la violence, la tension, l’humour et l’angoisse.
En 1953, six titres français paraissent. Albert Simonin avec Touchez pas au grisbi! remporte un énorme succès, 100’000 exemplaires vendus. Auguste le Breton renouvelle ensuite l’exploit avec Du rififi chez les hommes.
Le roman noir à la française
La classe moyenne, tout en se consolidant dans les années 50 et 60, aura son Homère en la personne de Georges Simenon et ses 75 romans mettant en scène le commissaire Maigret. Cette épopée d’une société rurale et ouvrière mutant vers le tertiaire rencontrera un succès planétaire et, en nombre d’exemplaires vendus, sera en concurrence avec la Bible. Auscultant inlassablement le capitalisme moderne, le Liégeois captera ses heurts, ses changements, ses frictions et pour lui, comme pour le roman noir en général, le cinéma sera fondamental. Une adaptation d’un de ses livres avec Jean Gabin dans le rôle-titre, c’est la certitude d’atteindre des tirages phénoménaux.
Pour le reste, Manchette le notera dans l’une de ses chronique, les truands du roman noir sont réac et ne cessent de se plaindre du temps qui passe. Leur contre-société est pour eux la seule communauté qui existe. Ils nomment leur milieu le Milieu et ils se nomment eux-mêmes les Hommes. Le reste de la société n’étant qu’un ramassis de pue-la-sueur soumis aux politiciens et craignant les flics.
Ultragauche, le néo-polar
Après Mai 68, le roman noir français reconvertit le genre en acte critique, en radiographie politique de la société et de ses institutions, en instrument d’intervention sociale. Le néo-polar intègre dans ses récits les banlieues, les grands ensembles, les HLM, et décrit de nouveaux espaces tels les caves, les terrains vagues, les cages d’escaliers. La violence sociale n’y est plus un écart mais la norme et toute révolte individuelle y est, par nature, vouée à échouer. Paranoïa et haine de soi y dominent.
Jean-Patrick Manchette, invité à l’émission Apostrophes par Bernard Pivot, en utilisant le terme de néo-polar devant des millions de spectateurs, rend son usage universel. L’époque est aux positions tranchées mais c’est A.D.G., sympathisant du Front national, qui brosse avec tendresse des portraits de hippies contestataires, et Manchette qui endosse dans ses livres le point de vue des fascistes.
Sur les seize auteurs pratiquant ce nouveau genre, dix ont un passé de militants de gauche, dans des organisations telles que les Jeunesses communistes, le PCF, la Gauche prolétarienne ou Lutte ouvrière, tous, nés après 1945, sont des baby-boomers, ayant fait des études supérieures, et ayant des bac +4, ou +5. Ils sont journalistes, scénaristes, traducteurs, éditeurs ou cinéastes. Manchette se définira d’ailleurs lui-même comme étant un indécrottable intello pas honteux de l’être.
La reconnaissance du genre
Pendant que la contre-culture se dote de ses propres outils de communication, journaux satiriques, BD, fanzines, l’éditeur Plon réagit et crée des collections qui rencontrent un succès phénoménal comme SAS de Gérard de Villiers, avec ses romans d’espionnage racistes et sexistes, homophobes et anticommunistes. De même, la série Brigade spéciale associe toujours l’acte sexuel à des coups et de la torture, d’un racisme appuyé, elle use de termes comme «bougnoule», «négresse» et est riche en descriptions de traitements dégradants.
Les années 1980 voient l’entrée en scène de l’amateur érudit et naissent des almanachs, des chroniques, des fanzines, des revues spécialisées vendues en kiosque, comme Gang, Polar ou 813, un Festival du roman et du film policier, une exposition au Centre Pompidou, l’ouverture en 1983 de la Bilipo, Bibliothèque des littératures policières à Paris, des thèses sur le sujet sont soutenues et en 1994 paraissent 471 nouveaux titres, en 1995, 700, en 2001, 1’709.
Lors du cinquantième anniversaire de la Série noire, Patrick Raynal en devient directeur. Œdipe roi de Sophocle y est publié, Jean-Claude Izzo et Maurice G. Dantec sont recrutés, les ventes repartent à la hausse.
Féminisation du roman noir
Dans les années 1990, on assiste à une entrée progressive d’auteurs femmes et ensuite, au siècle suivant, massive, à la fois comme productrices d’ouvrages et comme lectrices de ceux-ci, la lecture de roman devenant une activité de plus en plus essentiellement féminine.
En 2024, 60% des acheteurs et du lectorat de romans policiers sont des acheteuses et des lectrices. Il paraît beaucoup d’articles sur les femmes auteures de polars dont certaines avaient néanmoins choisi un pseudonyme androgyne, telles Fred Vargras, Dominique Manotti ou Claude Amoz. La plus célèbre de toutes, Virginie Despentes, décrit des personnages qui n’ont rien de victimes soumises, ni de douceur féminine et retourne, avec brio, la violence contre les hommes dans des récits urbains, violents, crus et nihilistes.
Auteurs enquêteurs, profs, journalistes et policiers
Le polar du XXIème siècle marque l’avènement d’une prise de parole qui n’est ni le fruit d’un engagement ni le résultat d’une déception militante.
Chercheurs, enseignants-chercheurs, journalistes, documentaristes, médecins, psychanalystes, avocats pénalistes, policiers, ils sont très nombreux à exercer ou avoir exercé des professions qui relèvent du paradigme indiciaire. Beaucoup d’auteurs travaillent dans l’audiovisuel, sont profs ou policiers – généralement des officiers. D’autres sont journalistes, donc précarisés ou en voie de l’être, et trouvent dans le polar une liberté dont ne disposent plus les médias d’information. Par le polar, ils peuvent raconter tout ce qu’ils ne peuvent plus dire par le journalisme. Ils utilisent dans l’écriture leur méthodologie d’investigation: collecte de données, recueil de témoignages, enquête de terrain, étude d’archives.
Carlos Ginsburg dans Signes, traces et pistes, son article paru en 1980, article faisant lui-même référence à l’article Attribution d’Enrico Castelnuovo paru en 1968 dans l’Encyclopédie Universalis: en 1876, il y a beaucoup de fausses attributions dans les musées, G. Morelli postule que pour distinguer les originaux des copies, il ne faut pas se baser sur les caractères les plus apparents et, par conséquent, les plus faciles à imiter mais examiner les détails les plus négligeables: les lobes des oreilles, les ongles, la forme des doigts des mains et des pieds. Castelnuovo rapproche cette méthode à celle de Sherlock Holmes découvrant l’auteur d’un délit sur la base d’indices imperceptibles pour la plupart des gens.
Extension du domaine de la lutte
De nos jours, le roman noir affronte le post-moderne, les fake news et la post-vérité. Dans de nombreux romans, le dénouement est ouvert. Le texte se clôt sur un assaut, sur une poursuite, sur une disparition non expliquée, sur la recherche non aboutie d’un meurtrier. Il n’y a plus de point de vue surplombant, unifié, de narration organisatrice, il ne reste que dissensus et brouillard narratif.
Bref, comme le disait le sociologue Luc Boltanski: que s’est-il passé pour qu’au début du XXème siècle surgisse cette littérature entièrement consacrée à l’énigme? L’émergence du roman policier ne coïncide-t-elle pas à la fois avec la construction de l’Etat-nation, la naissance de la sociologie et avec une nouvelle pathologie décrite par la psychiatrie, la paranoïa? Qu’ont-elles à voir entre elles? C’est simple. Elles utilisent toute l’enquête comme outil principal.
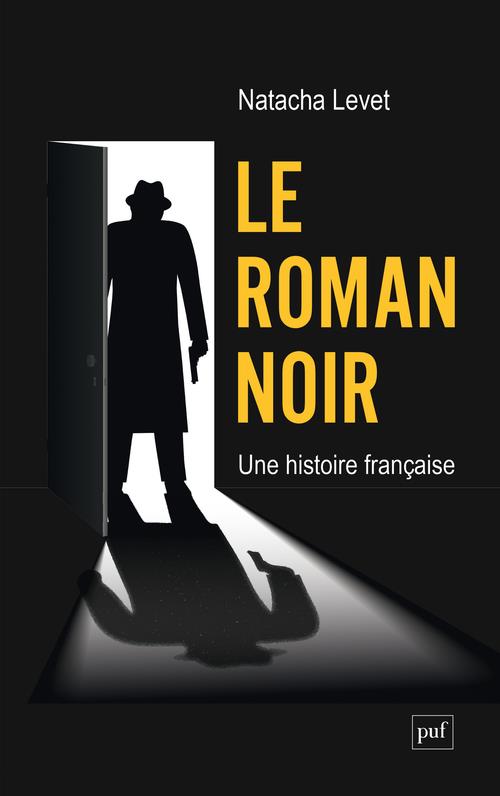
«Le roman noir: une histoire française», Natacha Levet, Presses Universitaires de France, 416 pages.
À lire aussi