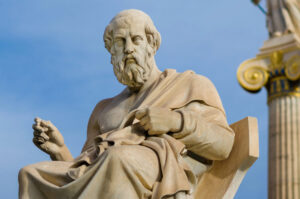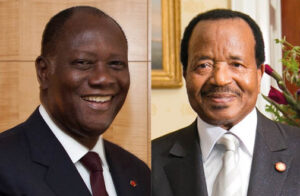Le goût de l’apocalypse

«Le discrédit jeté sur les institutions démocratiques par les sceptiques, les désespérés et les coléreux est le pire poison. Celui-ci pourrait produire ses effets avant la montée excessive du taux de CO2!» © Wikimedia CC 3.0
L’excellent journaliste Sylvain Besson, pour son dernier article dans Le Temps, s’est plongé dans la collapsologie. Un mot inventé par un scientifique belge pour désigner le prochain effondrement de la civilisation industrielle qu’il prévoit dans une dizaine d’années en raison du réchauffement climatique et de la détérioration générale de l’environnement. Ajoutez à cela l’opacité malfaisante de la finance internationale, les secousses de la mondialisation et la perte de confiance dans la démocratie, et vous aurez le tableau. Un collapsologue digne de ce nom n’entrevoit aucune solution à aucun problème. Le titre du papier est clair: «La mort du progrès nous laisse vides et angoissés».
Cette proclamation est évidemment le meilleur moyen de couper court à tous les processus d’innovation qui pourraient permettre d’aborder rationnellement les réels défis posés par nos modes de production et de consommation. Bon moyen aussi de vider de leur sens tous les efforts politiques que les naïfs jugent souhaitables.
Cette perspective apocalyptique chasse la raison et libère des émotions sur lesquelles il faut se pencher. Le désespoir se noue dans les tripes. Il débouche sur des comportements divers. Le je-m’en-foutisme (puisqu’il n’y a plus rien à faire!), l’individualisme épicurien, le refuge dans des fois religieuses rigides, les échappatoires vénéneuses ou alors la fuite en avant vers des gourous aux slogans simples: rendons le pouvoir au peuple! contrôlons les frontières! faisons cracher les riches! On les entend beaucoup en France ces temps-ci, montant d’un marais de rancœur et d’impuissance. La colère compréhensible à bien des égards reste protéiforme. Elle ne produit aucun discours articulé et bellement formulé comme le firent Mai 68, les grandes luttes ouvrières ou même les polémiques d’extrême-droite d’avant-guerre (elles sentaient mauvais mais avaient du style). Quant aux âmes courageuses – il y en a, même sur les ronds-points français – qui prônent la solidarité face à la détresse, leurs voix parviennent mal à se faire entendre dans le tohu-bohu des rues et des têtes.
Des ripostes à ces dérives du progrès restent possibles, pour autant que se manifestent des volontés individuelles et collectives.
Y aurait-il un plaisir à s’enfoncer dans la noirceur? Y en aurait-il un à bloquer la machine, à casser, à insulter? Un désir enfoui de castagne pour rompre la monotonie des jours? L’Europe a connu la plus longue période de paix de son histoire. Si l’on excepte les guerres à la sortie du colonialisme et à l’éclatement de la Yougoslavie. Quoi qu’on en dise parfois, les menaces d’un conflit militaire généralisé n’ont jamais été aussi faibles. Certes, les dangers d’aujourd’hui sont multiples, à commencer par l’emprise des géants américains sur notre façon de communiquer entre nous et de consommer, par les technologies aussi que répand la Chine pour espionner, surveiller les individus avec un raffinement qui laisserait Orwell pantois. Mais des ripostes à ces dérives du progrès restent possibles, pour autant que se manifestent des volontés individuelles et collectives.
Le progrès, parlons-en. Est-il haïssable? Mort, comme le disent les collapsologues? L’affirmer, c’est insulter les génération pas si anciennes où l’on mourait de maladies alors sans traitements, où de gigantesques famines décimaient des pans entiers de la planète, où la précarité des moyens de transport ratatinait les économies. Tenir ces discours catastrophistes, c’est insulter les chercheurs, les entrepreneurs, les travailleurs qui cherchent des solutions aux casse-tête de l’énergie et de la production agricole, à celles et ceux qui prolongent nos vies, qui tentent de guérir et de soigner les malades. Bien sûr, la médecine doit, elle aussi, s’interroger sur ses dérives savantes et commerciales. Mais regretter le temps où l’on était vieux à cinquante ans, où l’on mourait à soixante, est-ce bien sérieux?
Les pronostiqueurs du désastre universel sont des dépressifs en phase destructive, pour eux-mêmes et ceux qu’ils abreuvent de leurs discours. Il est pour le moins paradoxal qu’ils surgissent en Europe, ce lieu si riche de savoirs, nourrie des Lumières. Cette part du monde où se pratique plus que partout ailleurs une solidarité sociale, certes insuffisante, mais réelle. Allez demander en Asie, en Afrique, en Amérique du sud comment les gens se débrouillent pour leurs retraites et leurs soins de santé!
Les outils politiques existent pour minimiser les risques. A l’échelle de chaque pays et de l’Union européenne. Un pas après l’autre, s’il vous plaît, pas de soupe morbide!
Quelles réponses apporter à ce type de sombres prêches? Face aux théories déclinistes, l’injection volontariste d’optimisme serait inopérante. Mieux vaut calmer le tourbillon émotionnel. Et tenter de remettre les pieds sur terre. En prenant les problèmes un à un. En explorant à la fois leurs conséquences et les moyens d’y remédier. Quelques modeste exemples. Au lieu de culpabiliser les gens qui partent en vacances en avion, introduire les techniques de captation et de récupération utile du CO2 dans les industries – c’est possible! –, organiser la vie quotidienne pour restreindre les aller-retours en voiture, le covoiturage, etc. Bref, passer de la litanie à l’action concrète. Réduire le chômage au temps des robots? Par la formation, on le répète, on ne le fait pas assez et pas toujours à bon escient. Par une valorisation aussi des métiers de soins à la personne. Par un soutien aux projets individuels et collectifs sensés. Freiner le pouvoir de la finance internationale dérégulée qui fait hoqueter l’économie? Les outils politiques existent pour minimiser les risques. A l’échelle de chaque pays et de l’Union européenne. Un pas après l’autre, s’il vous plaît, pas de soupe morbide!
Voilà, le mot s’est glissé dans cette réponse aux collapsologues: politique. Le discrédit jeté sur les institutions démocratiques par les sceptiques, les désespérés et les coléreux est le pire poison. Celui-ci pourrait produire ses effets avant la montée excessive du taux de CO2!
Un mot aussi à l’endroit de Nicolas Hulot, l’ex-ministre, l’écolo sexagénaire désabusé. Il vient d’affirmer que s’il avait à faire encore des enfants, il y réfléchirait à deux fois au vu de l’état de la planète. Suggestion latente aux Européens de moins procréer! Respect à celles et ceux qui en décident ainsi. Mais qu’ils acceptent alors de voir le vide se remplir de populations venues d’autres continents. Pas sûr que cela leur plaise…
Un dernier vœu enfin. Que la célèbre phrase de notre conseiller fédéral sortant, «rire, c’est bon pour la santé», soit enfin… prise au sérieux! Quand les soucis du monde nous assaillent, ce n’est pas une raison de ne pas faire la fête. Que celle-ci soit fraternelle et joyeuse.
À lire aussi