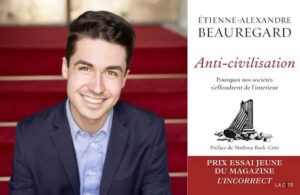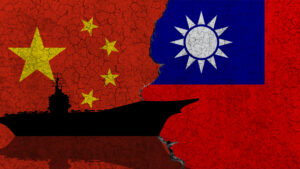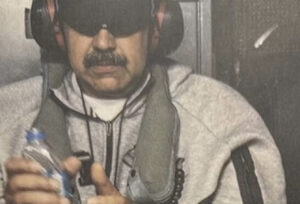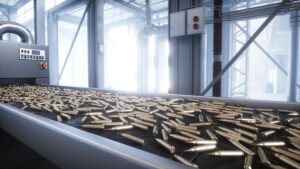La malédiction de Kadhafi: quand la justice rattrape la politique

© DR
En 2009, un collègue qui avait servi en Libye m’avait prévenu: «Ce que Sarkozy et compagnie ont monté avec Kadhafi leur explosera un jour au visage.» Il a fallu plus de quinze ans, mais le moment est venu.
Il est des alliances qui ne survivent pas à la lumière de l’Histoire. Ce qui fut autrefois présenté comme un rapprochement stratégique, un pari diplomatique ou un calcul politique se transforme, des années plus tard, en fardeau judiciaire et en stigmate symbolique. A travers la condamnation d’un ancien président de la République, c’est un pan entier de la relation entre pouvoir et impunité qui vacille. Et derrière le verdict, c’est l’ombre persistante du Guide qui plane: figure spectrale d’un désordre global que l’on croyait contenu, mais qui ressurgit sous les traits d’une justice implacable.
Pactes noués dans l’opacité
Ce que l’on appelle désormais «la malédiction de Kadhafi» n’est pas un mythe. C’est la matérialisation brutale des conséquences de pactes noués dans l’opacité, là où la géopolitique flirte avec le cynisme, et où les Etats démocratiques s’autorisent dans l’ombre ce qu’ils réprouvent sous les lumières. Kadhafi, longtemps marginalisé puis réhabilité au nom du pragmatisme, incarne ces régimes que l’Occident tente tantôt de domestiquer, tantôt de renverser, selon l’intérêt du moment.
Mais aucun accord avec l’ombre ne reste sans conséquence. La justice, aujourd’hui, tente de recoudre ce que la politique a déchiré. Elle ne se contente plus de juger des individus: elle juge un système, des logiques de pouvoir, des réseaux d’influence transnationaux où se mêlent finance, diplomatie parallèle, ambitions personnelles et crapulerie ordinaire. Elle rappelle qu’en démocratie, même les «puissants» doivent rendre des comptes − parfois bien après avoir quitté le pouvoir, parfois au terme de longues années de silence, d’enquêtes contrariées, de pressions et de morts suspectes.
Rééquilibrage du monde
Ce basculement n’est pas anodin. Il marque une époque où la parole judiciaire devient un instrument de rééquilibrage du monde, dans un contexte international brouillé, où les anciennes grilles de lecture − alliés/ennemis, Nord/Sud, démocraties/autocraties − ne suffisent plus à comprendre les réalités du pouvoir. La justice, lente mais déterminée, s’impose comme le dernier recours pour rétablir une forme d’éthique dans les relations internationales, là où la politique a échoué.
La trajectoire de Nicolas Sarkozy, l’un des artisans de l’intervention militaire en Libye, s’inscrit dans ce paradoxe. L’homme qui participa à la chute de Kadhafi se trouve aujourd’hui rattrapé par l’héritage trouble de cette relation. Il n’est pas le seul. Mais il est le premier. Et cette première fois en dit long: elle interroge la solidité de nos institutions, la sincérité de nos principes, et la résilience des sociétés face aux dérives du pouvoir. Plus qu’un cas individuel, c’est une leçon collective.
À lire aussi