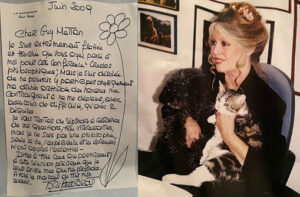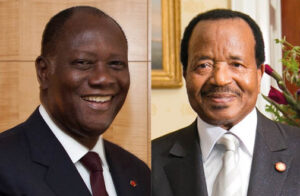La barque n’était pas pleine…

Une scène du film de Markus Imhoof. Des réfugiés juifs sont interceptés par les garde-frontières suisses. Refoulés du territoire helvétique, ils sont promis à une mort quasi certaine. Franz Flückiger, l’aubergiste chez qui ils ont trouvé un asile temporaire, les aide à s’enfuir. Cet acte de courage lui vaudra une condamnation à la fin de la guerre. Il sera réhabilité tardivement. – © DR
Il a notamment reçu en 2020 le Prix de l’Académie du film suisse. Son nom est associé à des titres comme Die Reise, La raison du cœur, More than Honey, Eldorado. La Cinémathèque suisse de Lausanne rend hommage à Markus Imhoof, cinéaste suisse humaniste et engagé, également metteur en scène de théâtre et d’opéra, qui célèbre aujourd’hui ses quatre-vingt ans, en lui consacrant jusqu’au 12 octobre une belle rétrospective. D’autres événements autour de l’œuvre du réalisateur ont lieu parallèlement en Suisse romande et en Suisse alémanique. Point d’orgue de cet hommage, la projection mercredi 15 septembre à la salle Paderewski de Lausanne de son film La Barque est pleine (1980). Cet opus attire jusqu’à aujourd’hui l’attention de la critique car il marque un tournant dans la carrière du zurichois. Il lui permet d’accéder à la pleine reconnaissance de ses pairs et à la renommée internationale. Il constitue aussi une étape importante du point de vue de l’historiographie et de la perception par l’opinion publique de la Seconde Guerre mondiale en Suisse. Focus sur les circonstances ayant entouré l’éclosion et la réception de ce film, entre hier et aujourd’hui.
Une image radieuse à corriger
Avant la Seconde Guerre mondiale et dans l’immédiat après-guerre, le cinéma sert surtout aux élites à diffuser l’image de la Suisse comme celle d’une généreuse terre d’accueil. En témoignent des films comme La Grande illusion (1938) de Jean Renoir et La dernière chance (1945) de Leopold Lindtberg, qui sont promus à cette fin par les autorités. Lazar Wechsler, juif d’origine autrichienne et polonaise, fondateur de la société de production de films Praesens, est le producteur de La dernière chance du cinéaste Leopold Lindberg. Emigré en Suisse en 1914, il est témoin de la volonté implacable des dirigeants suisses. Celle-ci consiste à lutter contre la supposée surpopulation du pays, voire à la menace d’«enjuivement» qui la guetterait. Juif autrichien, Lindtberg a fui son pays en 1938 au moment de l’Anschluss. Vu leur origine et pour préserver leur statut, Wechsler et Lindtberg s’abstiennent d’écorner l’image de la Suisse que ses élites suisses cherchent à promouvoir dans l’immédiat après-guerre.
Or, cette image est celle d’une neutralité suisse teintée d’héroïsme et de générosité. Jusque dans les années 1980 voire 1990, les élites et le système d’enseignement helvétiques se plaisent à populariser cette mythologie, celle de la défense spirituelle nationale. Socle de la neutralité armée, la dissuasion politique et militaire est présentée à l’unisson comme le facteur déterminant pour expliquer la non-invasion de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Les compromissions de la politique d’asile et la collaboration économique et financière avec le Reich, pour autant qu’elles soient admises, sont justifiées par les impératifs de la raison d’Etat en temps de guerre. Des voix critiques et discordantes commencent néanmoins à se faire entendre. La série documentaire du journaliste et écrivain Werner Rings La Suisse et la guerre (1973) met par exemple en évidence un certain nombre de questions difficiles ou gênantes, à l’instar du meurtre atroce du marchand de bétail Arthur Bloch commis par des antisémites fanatiques à Payerne le 16 avril 1942. Dans L’exécution du traître à la patrie Ernst S. (1977), le cinéaste zurichois Richard Dindo met en exergue la collaboration d’éminentes personnalités des milieux politiques et industriels suisses avec les dirigeants nazis. En s’intéressant au parcours oublié de Maurice Bavaud, un étudiant en théologie ayant tenté d’assassiner Hitler en 1938 et qui fut guillotiné en mai 1941 par les Allemands avec l’accord de la Suisse officielle et dans l’indifférence générale, Es ist kalt im Brandenburg. Hitler töten (1980) de Villi Hermann, Niklaus Meienberg et Hans Sturm thématisent aussi les accointances déplorables de la bourgeoisie conservatrice avec son voisin allemand. De fait, plusieurs historiens s’emploient déjà depuis le début des années 1970 à détricoter l’argumentaire des tenants de la défense spirituelle. Des historiens comme Edgar Bonjour, Alfred A. Häsler, Jean-Baptiste Mauroux, Daniel Bourgeois, Willi A. Boelcke examinent d’un œil beaucoup plus critique la coopération des élites dirigeantes suisses avec le Troisième Reich, et le sort réservé aux réfugiés juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Exorciser un souvenir d’enfance
Cherchant à fuir le sentiment d’enfermement qu’il ressent en Suisse dès son jeune âge, Markus Imhoof réside pendant une partie des années 1970 à Milan. Il cherche à y exorciser un souvenir d’enfance, qu’il évoquera d’ailleurs à mots découverts quarante ans plus tard, dans son film Eldorado (2018).
Les parents de Markus Imhoof ont accueilli plusieurs enfants réfugiés durant le second conflit mondial. Le souvenir de Giovanna a laissé des traces indélébiles. Il a ressenti pour elle son premier amour d’enfant. Morte de fièvre rhumatismale et de sous-nutrition en 1950 après son retour en Italie, on aurait pu lui offrir plus longtemps un havre de paix sûr et de meilleurs soins médicaux. Les analyses d’Edgar Bonjour et d’Alfred Hasler au sujet de la grande Histoire éveillent un vif intérêt chez le réalisateur. L’ouvrage de Hasler, Das Boot ist voll, Die Schweiz und die Flüchtlinge 1933-1945,[1] est une allusion à la formule popularisée par le Conseiller fédéral Eduard von Steiger le 30 août 1942 pour justifier la politique d’asile ultra restrictive de la Suisse dans un contexte où tout aurait dû la pousser à l’humanisme. La Barque est pleine fournit à Markus Imhoof l’inspiration nécessaire à son prochain projet.
Le hasard a également voulu que le cinéaste ait été assistant de Leopold Lindtberg à la Schauspielhaus de Zurich. «Lindtberg s’est en quelque sorte rendu compte que mon projet était le prolongement logique de Die Letze Chance. Il n’avait pas pu aborder le sujet du refoulement des réfugiés à l’époque, notamment en raison de la censure», explique Markus Imhoof.
Un accueil contrasté
Nommé aux oscars, ours d’argent au Festival de Berlin, primé dans de nombreux festivals internationaux, en Suisse, La Barque est pleine remporte un succès public tout en suscitant de gros remous au moment de sa sortie en 1981: «Je me souviens que pas moins de sept cent personnes étaient venues assister à une discussion à l’Hôtel de ville. Cependant, les cinémas qui le diffusaient recevaient aussi des alertes à la bombe. La façade de la maison de mon père a été souillée d’une croix gammée. Ensuite, la commission de l’enseignement du canton de Berne a exigé le retrait du film des écoles. Selon elle, le film risquait de corrompre la jeunesse», raconte Markus Imhoof. En réalité, le film n’aurait jamais vu le jour sans le soutien de George Reinhard, ami de jeunesse du réalisateur. Issu d’une famille influente de mécènes de la culture, futur fondateur du Musée de la photographie de Winterthur, ce dernier a profondément cru en ce film. Le producteur et le réalisateur se sont concertés. Ils ont réalisé ensemble un méticuleux travail sur les dialogues. Plus tard, George Reinhard investira une part importante de sa fortune dans une société de production de film d’auteurs, active entre Zurich et Paris jusqu’en 1985, qu’il codirigera avec son ami cinéaste.
La Confédération a refusé de subventionner La Barque est pleine pour plusieurs raisons. Elle reprochait au récit de manquer de distance, de négliger les circonstances historiques spécifiques de la guerre et de promouvoir par son biais un mauvais théâtre populaire. Le scénario manquait selon elle de réalisme. Car parmi les héros fugitifs de La Barque est pleine, on trouve un déserteur de l’armée allemande. Les réfugiés entretiennent la confusion sur leur identité en se faisant passer pour une famille, espérant ainsi attendrir les villageois. Ils mettent en avant le plus jeune d’entre eux, âgé de moins de six ans, espérant ainsi pouvoir échapper à leur refoulement. Le couple d’aubergiste qui les héberge se laisse progressivement émouvoir par leur sort. Cependant, les autres villageois font preuve d’une attitude attentiste et conformiste, voire mesquine ou carrément hostile, à leur égard. Les dialogues du film sont marqués par leur indécision, leur imprévisibilité et leur ambiguïté. Le style et ce ton permettent de souligner le flou entourant le cadre légal de l’époque, l’arbitraire des décisions de l’administration ainsi que la confusion morale générée par une situation extraordinaire.
Steven Spielberg a admiré pour sa part l’ancrage local de La Barque est pleine. Et au cours d’une conversation avec Markus Imhoof aux Etats-Unis, il a souligné la portée universelle du message délivré par son récit. La Barque est pleine semblait vouée à marquer une génération de cinéphiles et d’historiens. Conscients de son importance pour le cinéma et la mémoire helvétiques et suite à la découverte d’un négatif du film dans une chapelle à Rome, Memoriav et Swiss effects entreprennent à la fin des années 1990 un important travail de restauration. Les zones d’images manquantes sont remplacées par numérisation. Un travail est effectué pour éviter les sursauts et le scintillement, réduire le bruit et le grain. Succès d’estime cinématographique, l’accueil réservé à La Barque est pleine a différé selon les milieux. La controverse autour de la politique suisse durant la Seconde Guerre mondiale a rebondi dans les années 1990. Elle aurait pu être moins houleuse, et les problèmes surgissant dans son sillage plus facilement résolus… si tous les enseignements du film avaient en son temps été tirés.
[1] Traduction française par Philippe Schwed parue sous le titre «La Suisse, terre d’asile- La politique de la Confédération envers les réfugies de 1933 à 1945», Lausanne, Editions Rencontres, 1971.
Horaires et dates des projections de La barque est pleine à la Cinémathèque suisse
Horaires et dates des projections du portrait de Markus Imhoof à la Cinémathèque suisse
Hommage « Autour des raisons du coeur », vendredi 17 et samedi 18 septembre à Délémont, www.love-of-fate.ch
Diffusion du portrait de Markus Imhoof par Stefan Jäger, dimanche 12 septembre à 11h55 sur SRF
«Le passé a encore certainement beaucoup à nous enseigner»
Interview de Marc Perrenoud, historien, spécialiste des relations extérieures de la Suisse et de la Seconde Guerre mondiale, conseiller scientifique de la Commission Bergier.
Pourquoi les autorités ont elles utilisé le cinéma pour diffuser une image mythique de la Suisse au sortir de la Seconde Guerre mondiale?
Les élites conservatrices étaient intéressées à promouvoir l’image d’une nation suisse en arme et courageuse, celle aussi d’une généreuse terre d’asile pour les persécutés. C’est à cette fin qu’elles utilisèrent le film La dernière chance de Leopold Lindtberg. Ce film permettait de véhiculer le message suivant: «Nous Suisses, nous étions la dernière chance» pendant la période la plus difficile, celle du fascisme et du nazisme, pour toutes les victimes de persécution. Un film comme La Barque est pleine de Markus Imhoof raconte une toute autre histoire qui a mis du temps à émerger au sein de la sphère publique et de la conscience collective.
Quel était l’état d’esprit chez les élites dirigeantes suisses en 1945 et dans l’immédiat après-guerre? Pourquoi la question des réfugiés a-t-elle mis si longtemps à resurgir?
Au début de l’année 1946, les diplomates suisses sont préoccupés par la libération des avoirs suisses bloqués aux Etats-Unis et la levée du boycott par les Alliés des entreprises qui ont eu des relations économiques avec les puissances de l’Axe durant la Seconde Guerre mondiale. En contrepartie, les USA, la Grande-Bretagne et la France réclament les avoirs allemands entreposés sur des comptes bancaires suisses. L’Accord de Washington du 25 mai 1946 représente un jalon crucial dans la politique étrangère suisse. Dans le climat de la Guerre froide, ils permettent à la Suisse de sortir de son isolement. En 1946, toutes les annexes à cet accord ne furent pas publiées. Ainsi, une lettre sur «le montant des biens en Suisse de victimes d’actions de violences perpétrées récemment par l’ancien Gouvernement allemand, qui sont mortes sans héritiers» est tenue secrète. Le règlement de la question des «avoirs en déshérence» a été bloqué pendant des décennies à cause des manœuvres dilatoires des milieux bancaires. Mais l’affaire dit des fonds en déshérence ainsi que le débat sur l’attitude de la Suisse vis-à-des réfugiés prendront une véritable ampleur seulement après la fin de la Guerre froide, dans les années 1990.
Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, les élites suisses se sont attribuées des faits de résistance qui ne correspondent pas à la réalité historique, en particulier en comparaison du vécu des résistants dans les pays occupés par les nazis. En outre, comme l’illustrent notamment les travaux de Luc Van Dongen ou la récente série vidéo-diffusée Frieden, le savoir technologique des nazis intéressait la Suisse. Tout comme d’ailleurs les Etats-Unis, la Suisse a fait en sorte d’accueillir et de bénéficier de l’expertise d’hommes d’affaires et de techniciens nazis pour développer son industrie.
La Commission Bergier a été chargée de faire la lumière sur l’affaire dite des fonds en déshérence. Son rôle a été étendu à la politique d’asile suisse pendant la Seconde Guerre mondiale et à l’examen des relations économiques et financières entre la Suisse et le Troisième Reich. Quel était le climat au sein des élites en Suisse au moment de la création de cette commission?
En 1995, alors que toute l’Europe commémorait les cinquante ans de la fin de la guerre, le Conseil fédéral a prononcé un discours historique d’excuses concernant l’apposition du tampon «J» discriminatoire dans les passeports des juifs allemands. Cette action de proposer un signe distinctif a été suggérée par la Suisse et acceptée par l’Allemagne et cela aboutira à un accord signé le 29 septembre 1938. La Conseillère fédérale socialiste Ruth Dreifuss a insisté pour que le travail des historiens ne soit pas limité à l’examen de l’année 1938. Selon elle, des cours de rattrapage en histoire suisse devaient être dispensés à certains membres du Conseil fédéral. Dans un discours à Thoune prononcé en mai 1995 et marquant un tournant, elle affirma: «L’amnésie institutionnelle à propos de cette période a très largement fonctionné».
Quels sont d’après vous les principaux enseignements des énormes travaux (11 000 pages) effectués par la Commission Bergier?
Les travaux de la Commission Bergier marquent une césure claire dans l’historiographie de la Suisse face à la Seconde Guerre mondiale. La remise en cause du passé helvétique a permis de tourner la page sur la vision mythifiée de cette histoire. L’accès aux archives privées – auparavant bloqué – change et enrichit les perspectives d’analyse. Il a permis de modifier une image faussée qui avait été entretenue dans l’immédiat après-guerre et, dans une moindre mesure, au dernier quart du XXe siècle. En outre, la Commission Bergier n’a jamais prétendu que ses publications étaient exhaustives et ne pouvaient pas être débattues. Cependant, force est de constater que celles et ceux qui s’opposent à l’évolution de l’analyse historique continuent à publier des livres présentant une vision idyllique de la Suisse. Elles et ils condamnent le rapport Bergier sans mentionner les nuances qu’il contient. Or, de nombreuses recherches sont actuellement et doivent encore être conduites. Le passé a encore certainement beaucoup à nous enseigner.
Aujourd’hui, la formule «La Barque est pleine» est toujours reprise dans les milieux conservateurs et dans certains médias s’agissant des réfugiés et de la politique d’asile suisse. Qu’est-ce que ce phénomène vous inspire?
Les données du débat public sont différentes aujourd’hui. L’histoire ne se répète jamais exactement de la même manière. Cela dit, le précédent de la Seconde Guerre mondiale permet à certains de dire «on va agir comme on a toujours agi». S’agissant de la période historique considérée, on peut observer une fixation sur les statistiques du refoulement. La question de savoir combien de réfugiés juifs et non-juifs ont été refoulés prend beaucoup de place dans les débats. Cela occulte selon moi les vrais problèmes. Depuis 1942, les autorités disent «La barque est pleine». C’était le discours officiel des milieux dirigeants. Et ces attitudes ont resurgi et resurgissent encore aujourd’hui malheureusement de manière récurrente.
À lire aussi