Orthographe: et si on osait les comparaisons?
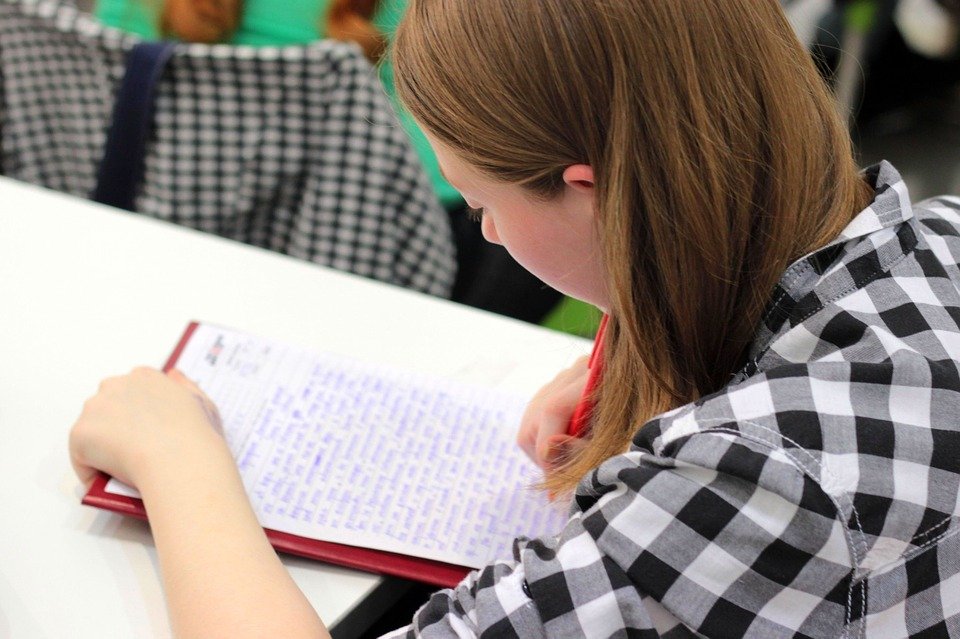
Oui, on peut laisser tomber les lettres grecques sans perdre son âme linguistique et poétique. – © DR
Trente ans déjà que la réforme de l’orthographe, proposée par le Conseil supérieur de la langue française et approuvée par l’Académie, a été annoncée à la francophonie. Proposée mais pas imposée. Concrètement, dans les écoles romandes, les enseignants étaient jusqu’ici libres d’en faire des choux et des pâtés. Ils sont désormais explicitement invités à l’enseigner, tout comme leurs collègues belges et français (même si ces derniers ont reçu des signaux un brin contradictoires).
C’est la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) qui l’a annoncé la semaine dernière. La vague d’émotion, face au «i» perdu d’«ognon», n’a pas été, il me semble, aussi intense qu’en 1990. N’empêche: dans les commentaires, a resurgi la mortelle inquiétude du «nivellement par le bas» et de l’«appauvrissement» de la langue.
Je ne vais pas refaire tout le débat. J’ai seulement envie de partager quelques réflexions et quelques données intéressantes fournies par les linguistes.*
L’allemand et l’italien sont-ils des langues pauvres?
Une chose m’a toujours frappée dans la manière dont les francophones s’enflamment, se torturent ou jubilent sur le sujet éminemment émotionnel de l’orthographe: il leur vient rarement à l’idée de s’intéresser à ce qui se passe dans les autres langues. Regarder ailleurs, faire des comparaisons, prendre un peu de hauteur, ça aide pourtant à l’intelligence des choses.
Ainsi, que faire de cette conviction, viscéralement ancrée chez les locuteurs du français, que la complication de leur orthographe est un gage de profondeur, intellectuelle et culturelle? Les Romands sont particulièrement bien placés pour la mettre à l’épreuve: ils côtoient, chez eux, deux autres grandes langues européennes, l’allemand et l’italien. Deux langues à l’orthographe limpide, alors que celle du français bat des records d’opacité. Est-ce que cette simplicité de graphie rend la culture, la littérature, la pensée allemandes et italiennes plus pauvres, plus superficielles, que la culture, la littérature, la pensée françaises? Est-ce que Robert Musil, Herta Müller, Friedrich Dürenmatt, Italo Calvino, Umberto Eco, Francesca Melandri ont moins de profondeur, de mystère, de sophistication que les grands de la littérature et de la pensée françaises? Il y a sûrement des francophones qui en sont convaincus. Mais je ne crois pas que ce soit le cas de la plupart d’entre eux. Il leur suffit donc de regarder autour d’eux pour s’imprégner de la bonne nouvelle: oui, on peut laisser tomber les lettres grecques sans perdre son âme linguistique et poétique.
L’exercice de la comparaison devient impressionnant lorsqu’on aborde le terrain des performances scolaires. Pour rester en Suisse: dans la vie des élèves tessinois – tout comme dans celle des Finlandais, des Grecs, des Espagnols, des Allemands – la question de l’orthographe est vite liquidée. A la fin de la première année primaire déjà, ils écrivent correctement leur langue maternelle. Pour ceux des cantons francophones – tout comme pour les Français ou les Anglais – le sujet est nettement plus douloureux: à 12-13 ans, ils n’ont toujours pas une orthographe satisfaisante. Beaucoup vivront une vie entière sans avoir atteint ce but.
Ajoutez à cela que déchiffrer et écrire correctement c’est bien, mais ce n’est que la première étape. L’objectif, c’est l’intelligence de la langue, la maîtrise du sens. Et, en comparaison internationale, quels élèves arrivent premiers aux tests de compréhension de la lecture en quatrième primaire? Les Finlandais, alors que ce sont précisément eux qui consacrent le moins de temps scolaire à la langue maternelle: 3,91 heures hebdomadaires à 10 ans, contre 9,23 en France.
Comment se fait-il qu’ils atteignent l’excellence à si bon compte? C’est simple: apprendre que «matrone» prend un «n» mais «patronne» en prend deux, que «clou» fait son pluriel en «s» mais «chou» en «x», qu’«avènement» s’écrit avec un «e» grave et «événement» avec un aigu, ça prend un temps fou et ça ne rend pas plus malin. Consacrer ce même temps au sens de ce qu’on lit et écrit, ça sert l’intelligence de la langue et l’intelligence tout court.
Etymologie, mon amour infidèle
Le sentiment que via l’orthographe française, on plonge aux racines de la langue est bien sûr légitime, et même grisant, pour peu que l’on ait l’amour des mots. Le circonflexe d’«abîme» remplace bel et bien le vieux «s» latin d’«abyssus».
Le problème est que ce marquage étymologique est, dans la graphie française, lacunaire, aléatoire, quand il n’est pas trompeur. Le «d» de «poids» ne vient de nulle part («pensum»), le «ph» de «nénuphar» non plus puisque le mot est d’origine arabe et non grecque. Pour respecter l’étymologie, il faudrait écrire «phantaisie», «phantôme», «rhythme», «throne», «contreindre». L’histoire tarabiscotée des codifications du français en a décidé autrement. Mais le résultat, c’est que l’écolier doit apprendre par cœur qu’on écrit «jeûner» mais «déjeuner», «tempêter» mais «tempétueux», en abandonnant tout espoir de raisonnement logique. Bien sûr, une partie de l’orthographe française – dont le glorieux accord du participe passé – relève de la logique grammaticale. Mais le gros des difficultés sont dues aux incohérences et aux exceptions.
C’est ce que, timidement, la réforme de l’orthographe essaie de rétablir: un peu plus de cohérence, un peu moins d’exceptions. Par exemple: le trait d’union partout entre les numéraux («trente-deux-mille-cinq-cent») et pas seulement entre certains, un tréma qui porte toujours sur la lettre qui se prononce («aigüe»), un circonflexe qui ne persiste que là où il sert à distinguer deux mots («mûr»/ «mur» mais «abime» et «croute»)…
Le sentiment de fidélité au passé est d’ailleurs lui-même aléatoire et tout relatif. La disparition du circonflexe d’«abîme» fait aujourd’hui figure de crime de lèse tradition? Aux yeux de Victor Hugo, cet accent-là n’était qu’une nouveauté sans saveur: «Je regrette l‘Y de l’ancienne orthographe du mot abîme. Car Y était du nombre de ces lettres qui ont un double avantage: indiquer l’étymologie et faire peindre la chose par le mot: ABYME.»
Les protestants à l’avant-garde
Si l’orthographe française est si obscure en comparaison des autres, c’est d’abord à cause de son évolution phonétique: alors que les autres langues romanes sont restées plus proches du latin, le français s’en est beaucoup éloigné, larguant au passage des dizaines de voyelles et de consonnes, notamment finales, dont l’orthographe conserve la trace.
Mais fallait-il la conserver, cette trace, ou valait-il mieux adapter la graphie au changement phonétique, comme l’ont fait la plupart des autres langues européennes? On sait que le débat fut vif. Qu’en 1694, l’Académie française trancha: elle opta pour une orthographe savante, «qui distingue les gens de lettres d’auec les ignorants et les simples femmes.» Au moins l’intention élitiste était claire et assumée.
Moins connu est le lien entre le débat orthographique et la querelle religieuse. Le saviez-vous? Les protestants se sont rangés avec fougue du côté des partisans d’une graphie transparente, qui mette l’écrit (et donc la Bible, bien sûr) à portée du plus grand nombre. Louis Meigret (1542) a ferraillé contre «la superstition» et «la faulse doctrine» de l’orthographe latinisante et lui a opposé «la lumière» d’une graphie lisible. En face de lui, Antoine Pasquier a pesté contre cette «nouuelle hérésie» qui consiste à vouloir «conformer l’orthographe au commun parler».
Cinq siècles plus tard, on peut dire que le débat est toujours sur la table. L’enjeu reste bien sûr la maîtrise de l’écrit par le plus grand nombre. Et en conséquence, celui du temps scolaire. Comment l’école peut-elle aider les futurs citoyens à faire face aux nouveaux défis, informatiques, écologiques, sans abandonner le bagage classique, tout en soignant la créativité des élèves? En dégageant du temps. Celui que l’on passe à se demander où poser le tréma de «aigüe» semble tout indiqué.
Le combat pour une orthographe limpide me paraît être un combat profondément démocratique. Une cause inclusive et audacieuse, idéale pour la gauche. Et voilà encore une chose qui me frappe: ce combat, la gauche ne l’a pas fait sien. Les protestants du 17èmeétaient plus audacieux?
*La plupart des exemples cités sont tirés de la brochure Orthographe : Qui a peur de la réforme ? des linguistes belges Georges Legros et Marie-Louise Moreau, édité par le Service de la langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ainsi que de la présentation de Jean-François De Pietro, membre du groupe de travail Evolang, lors de la conférence de presse de la CIIP le 9 juin dernier.
À lire aussi
















