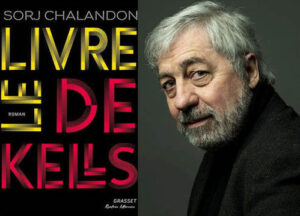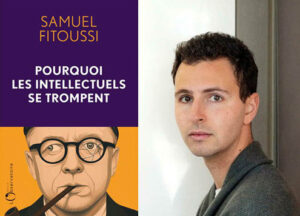Mayotte, les noces d’étain
Un marché à Mayotte, devenue département français voilà dix ans. – © Stephan Engler
Située dans l’Océan Indien le 101e département français fait partie de l’archipel des Comores, situé au nord du Canal du Mozambique. Il possède deux îles principales, Petite Terre et Grande Terre, desservies par un service de barges. Son lagon est l’un des plus grands du monde, peuplé par de nombreuses tortues marines, des dauphins, et des baleines à bosse selon les saisons. Sa population est une société multiculturelle, avec des origines à la fois africaine, malgache, perse, orientale, européenne et arabe. Les insulaires parlent le français mais aussi le kibushi et le shimaoré. Sur le papier Mayotte a tout pour plaire aux voyageurs friands de nouvelles découvertes. Pourtant derrière cette façade se cache de nombreux problèmes.

Le mihrab datant de 1538 à Tsingoni. © Stephan Engler
Une histoire mouvementée
La plus ancienne trace du peuplement de l’île remonte au VIIIème siècle, par les Bantous d’Afrique de l’Est. Ils furent suivis par les marchands arabes et perses qui débarquèrent vers le IXème siècle et apportèrent l’Islam avec eux. Le premier nom de l’archipel leur est dû: «Djazaïr al Qamar» ce qui signifie «les îles de la lune». Au fil du temps le nom changea en Kamar et Comores.

Un des fameux debba à Bouéni. © Stephan Engler
Au XVIème siècle se produit un grand changement, les migrants Chiraziens prennent le pouvoir et s’octroient le titre de sultan. Pendant plusieurs siècles, les îles subissent des guerres sans fin, ce qui vaudra à leurs dirigeants le surnom de «Sultans batailleurs». Les premiers Européens arrivèrent également pendant cette période trouble avec, dans l’ordre d’arrivée, les Portugais, les Hollandais, les Anglais et les Français. Au XVIIIème siècle la guerre régnait toujours à Mayotte avec d’incessantes incursions venant de l’île voisine d’Anjouan. Le dernier sultan, Adriantsouli, cède Mayotte à la France le 25 avril 1841 contre une rente viagère de 1000 piastres.
La prise de possession par la France fut effectuée par le commandant Pierre Passot, 3000 personnes habitent alors l’île. C’est en tant que commandant supérieur de Mayotte qu’il promulgue l’abolition de l’esclavage par l’ordonnance du roi Louis-Philippe le 1er juillet 1847.
Les Grandes Comores deviennent alors protectorat français avant d’être déclarées colonie française en 1912 et TOM (territoire d’outre-mer) en 1946. Lors de l’autonomie de l’archipel 10 ans plus tard la population de Mayotte s’inquiètent de revivre des périodes sombres. Des Mahoraises tel que Zena M’Dere ou Mariama Combo «Mouchoula» se battent au péril de leur vie pendant 30 ans pour un ancrage définitif au sein de la République française. Enfin, en 1976 lors du référendum pour l’indépendance des Comores, Mayotte choisit seule de rester française. Un bon choix, si l’on en croit l’agitation régnant aux Comores, qui subiront 19 coups d’Etat en 24 années d’indépendance.
Pour l’île au lagon, les statuts se succèdent: Collectivité Territoriale de la République Française en 1976, puis en 2000, Collectivité Départementale. La départementalisation était prévue pour fin mars 2011 avec l’élection de la première Assemblée Départementale de Mayotte. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu, les conseillers fraîchement élus n’ont pas pu s’entendre et la ministre de l’Outre-Mer n’est pas arrivée à temps… Finalement, c’est le 3 avril 2011 que s’est déroulée la première séance du premier Conseil Départemental de Mayotte, son nouveau statut a pu être acté officiellement ce jour-là.

Femmes portant le M’sindzano, le maquillage traditionnel, à la pêche. © Stephan Engler
Qu’en pensaient les insulaires en 2011?
Pour Moussa, propriétaire d’un magasin de produits de première nécessité dans le sud-ouest de l’île, «cette départementalisation est une bonne chose, car Mayotte, a été maltraitée par les îles voisines, et a toujours voulu rester française. Notre qualité de vie et notre liberté vont augmenter. Cela nous permettra d’aller de l’avant, même si administrativement les problèmes seront nombreux. Sur le plan politique, cela va être très difficile aussi. Un chantier de fou! Il y aura également des problèmes de cadastre. Et puis, qui payera à la place de ceux qui ne pourront pas le faire? Comment les gens vont-ils être informés de tous ces changements? Cela dit, Mayotte ne veut pas de la misère des Comores. La départementalisation, ce n’est pas pour l’argent, mais pour éviter la misère.»

Panneau d’une auto-école. © Stephan Engler
Yvonne, tenancière d’une épicerie doublée d’un tea-room dans le nord, se réjouit, bien qu’elle ne soit pas directement concernée: «Il n’y aura plus de polygamie! Au niveau scolaire, ce sera beaucoup mieux, tant sur le plan de la qualité d’enseignement que de l’uniformisation. L’apprentissage d’un métier sera plus facile. Globalement, ce sera mieux pour les jeunes.»
Un instituteur croisé sur la côte orientale souligne, dans l’ordre, «outre la suppression de la polygamie et l’amélioration de l’enseignement, cela nous permettra d’être des citoyens d’un grand pays. Mais que de complications en vue! Et puis, le fait d’être Français est le seul moyen de lutter contre les clandestins…»
D’autres parlent d’un assainissement de l’île, de l’accès aux fonds européens ou d’un développement pour un tourisme responsable.

La capitale Mamoudzou, une barge et le port. © Stephan Engler
Tour d’horizon 10 ans après
En septembre 2011 déjà, une partie de la population a manifesté dans la rue «contre la vie chère» à Mamoudzou la capitale, car des problèmes déjà récurrents avant la départementalisation n’ont jamais été réglés. Les Mahorais réclamaient le blocage des prix des produits de première nécessité. Il faut savoir que de 2007 à 2011, le coût de la vie a augmenté de 60% à Mayotte — contre «seulement» 15% à La Réunion. Le conflit s’est considérablement durci et a paralysé l’île pendant trois mois, avec à la clef une grève générale, des barrages et des actes de vandalisme. Le 20 décembre 2011, l’intersyndicale et le patronat signent un accord pour mettre fin au conflit. Le texte porte sur la baisse des prix de 11 produits de consommation courante.

Une vendeuse de chaussures sur le marché. © Stephan Engler
Mais ce n’était que le début et de nombreux conflits suivirent, avec leur lot de manifestation et de grèves principalement dans les secteurs de l’éducation nationale et du milieu hospitalier.
Pourtant tout avait bien commencé, la population était enthousiaste et pleine d’espoir. Mais il y a toujours trop d’inégalité sociales et économiques par rapport aux autres départements. A Mayotte le PIB par habitant est de 9.400 euros alors qu’en France métropolitaine il est de 33.400 euros, pourtant les prix augmentent comme partout ailleurs. De nombreux secteurs sont en difficulté, comme la santé, l’éducation nationale, la gestion de l’eau potable… Le chômage explose: en 2019 il était de 22% (contre 7,9% en métropole)! La population souffre et la crise sanitaire n’arrange rien.
Paris décide pour Mamoudzou

La forêt, une ressource importante. © Stephan Engler
C’est le choc des cultures. A Mayotte, depuis des siècles, les insulaires s’appuyaient sur l’autorité et la justice cadiale (un cadi est un juge musulman avec plusieurs casquettes et des fonctions civiles, judiciaires et religieuses). En devenant un département français, l’île savait qu’elle signait la fin de l’autorité des cadis, en tout cas comme juges de paix. Pourtant, étant donnés les nombreux problèmes de violence et d’incivilité, les autorités françaises comptent faire appel à ces derniers pour apaiser la situation. Les habitants, en particulier les jeunes désœuvrés, sont-ils toujours prêts à accorder du crédit à une autorité religieuse?

La prière le vendredi dans une mosquée. © Stephan Engler
L’identité particulière de Mayotte réside aussi dans son patrimoine comme à Tsingoni avec son mihrab datant de 1538, ce qui en fait la plus vielle mosquée de France. Les coutumes ancestrales telle que la pêche au djarifa (avec une toile), le debba, danse réservée aux femmes, le M’sindzano, maquillage traditionnel et écran naturel contre le soleil, la gastronomie mahoraise riches en saveurs que l’on peut déguster chez les fameuses mama brochettis (restaurant locaux) est bien loin du coq au vin. Et n’oublions pas les fastueux mariages qui sont indissociables de l’identité mahoraise.

Des femmes réunies lors d’un mariage à Passamainty. © Stephan Engler

Les mariés dans leur chambre. © Stephan Engler
A part la langue française les insulaires ont peu de points communs avec les Français de la Métropole. Voici quelques exemples parmi tant d’autres: depuis quelques années seulement les rues ont des noms et les maisons sont numérotées, quant au cadastre il n’existait pas… Aussi se pose cette question: comment administre-t-on, de la métropole, un territoire distant de 8000 kilomètres?
Les Mahorais interrogés en 2011 avaient raison, l’application des lois et de l’administration est un vrai casse-tête. Les 256’518 habitants (la population est estimée à plus de 300’000 avec les clandestins) soulèvent plus de points négatifs que positifs et se demandent si la France désire réellement développer leur île.
Le problème de l’insécurité, malgré les efforts fournis, n’est toujours pas résolu aujourd’hui. Celle-ci est liée en grande partie à l’immigration, et ce problème n’est pas nouveau. Des milliers de migrants clandestins chaque année arrivent de l’île comorienne d’Anjouan. Ils traversent les 70 kilomètres qui séparent les îles à leurs risques et périls dans leurs frêles esquifs nommé kwassa kwassa (canots de pêche rapides), dans l’espoir d’une vie meilleure. En février 2021, la Police aux Frontières a effectué 1’860 reconduites à la frontière. Même si Mayotte n’est pas riche, le revenu aux Comores est neuf fois inférieur! Pour les 9’600 (chiffre de 2018) naissances annuelles au CHM (Centre Hospitalier de Mamoudzou) environ 70% sont attribuables à des femmes en situation irrégulière, cela fait de la maternité de Mamoudzou la plus grande d’Europe.
Pourquoi, connaissant tous ces éléments, Paris a-t-il appuyé la départementalisation? Deux atouts de taille ont sûrement fait pencher la balance: la découverte d’un gisement gazier géant au large du Mozambique, à quelques heures de mer de Mayotte, et le fait que la départementalisation entraîne l’augmentation de la surface des ZEE (zones économiques exclusives ultramarines) françaises. Mayotte bénéficie d’un territoire maritime conséquent avec ses 74’000 kilomètres carrés de zone de pêche. Il faut savoir que la France avec son littoral, et grâce à ses départements et collectivités d’outre-mer, est la deuxième puissance maritime du monde derrière les Etats-Unis.
Perspectives et croissance

L’aquaculture, aujourd’hui en liquidation judiciaire faute de soutien. © Stephan Engler
Le développement de Mayotte passe naturellement par l’océan et son lagon de 1’100 kilomètres carrés. Pour cela, il faut structurer les filières de la pêche, développer l’aquaculture, soutenir un tourisme responsable et les formations liées aux métiers de la mer. C’est un atout susceptible d’améliorer considérablement la qualité de vie et de créer des emplois sur l’île. Bien sûr, une volonté politique ainsi que des investissements privés et publics sont nécessaires.

Des pêcheuses de djarifa dans le lagon. © Stephan Engler
En ce qui concerne les Comores, le tourisme peut également améliorer la situation actuelle. D’ailleurs un projet de développement a été lancé en octobre 2020. Selon Karalyn Monteil, spécialiste du programme culture du bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Est, «il y a une énorme possibilité de développer le tourisme durable aux Comores avec leurs riches patrimoines naturels et culturels. L’UNESCO est confiante qu’au travers de ce projet, les Comores seront mieux placées pour développer et gérer le tourisme dans le respect des orientations de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO».
Le temps du dialogue est venu pour la France et l’Union des Comores, afin de construire une collaboration durable, car la plupart des problèmes de Mayotte sont régionaux et non pas locaux.
Selon les Anciens, les piliers de la culture mahoraises sont l’homme, les croyances et l’accueil de l’autre. A Mayotte les gens sont attachés à la terre, à Anjouan ils sont plutôt navigateurs et à la Grande Comore éleveurs. Ces populations sont complémentaires et doivent coexister, aucune d’entre elles ne peut subvenir seule à ses besoins. Si l’une d’elles domine, l’équilibre est rompu.

Depuis la plage de l’Anse des Cocotiers, la ville de Sada. © Stephan Engler
À lire aussi