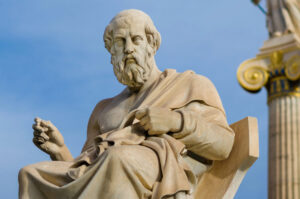Et pan sur la Suisse ! L’auto-goal des maîtres de conscience
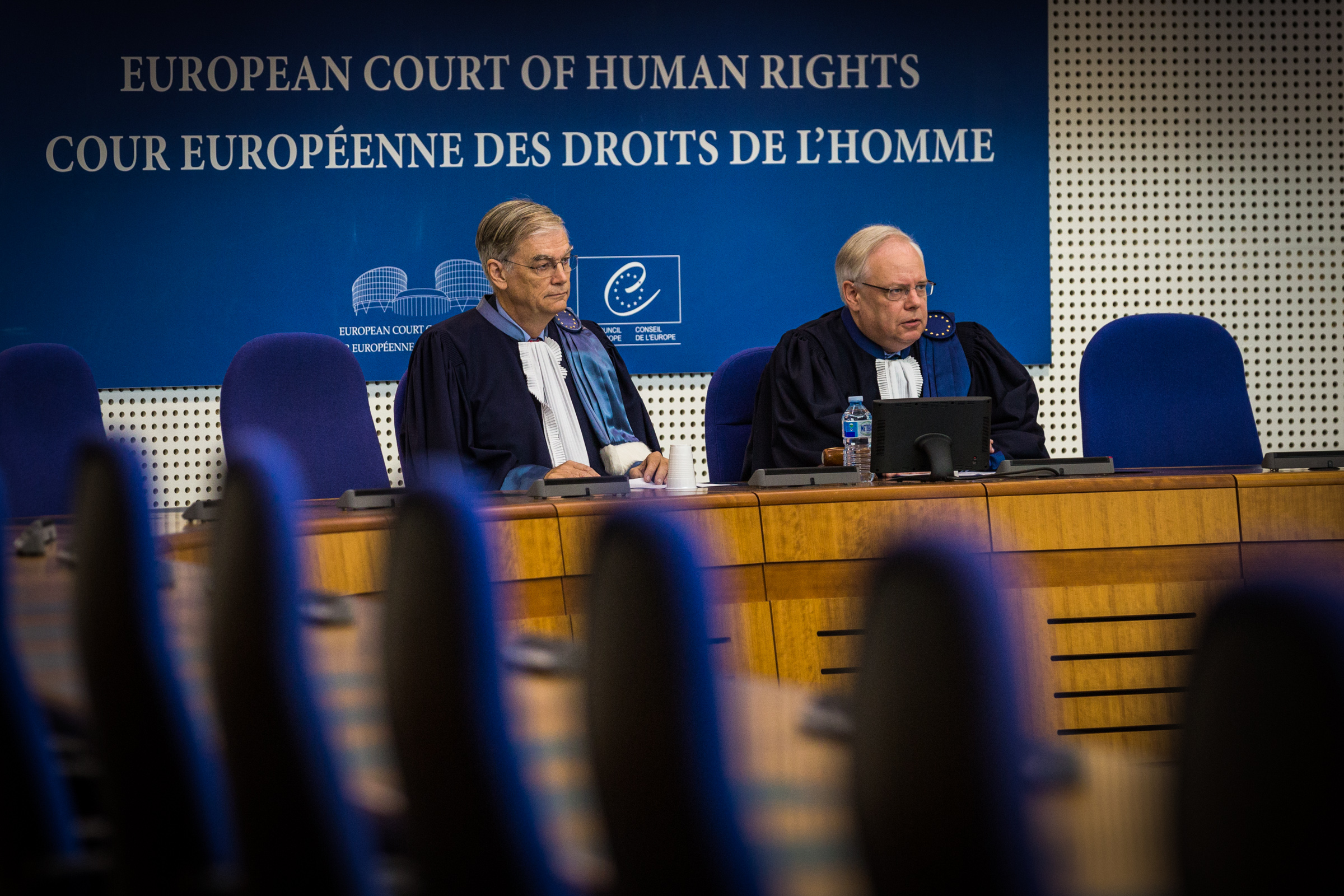
La Cour européenne des droits de l’homme reçoit entre 30’000 et 40’000 plaintes par an. Beaucoup sont déboutées, d’autres rapidement traitées et quelques-unes (12’000 depuis le début) font l’objet d’arrêts contraignants pour le pays concerné et par tous les autres membres. Nombre de justiciables, après un long parcours, d’appels et de recours, ont vu ainsi leur cause finalement reconnue à ce niveau. On peut se féliciter de voir ainsi mis en question certains appareils judiciaires qui s’emballent parfois un peu vite. En l’occurrence cela ne s’est pas passé ainsi. Les « Aînées pour le climat » ne sont pas adressées aux juridictions nationales, mais directement à la Cour européenne, avec l’appui financier et politique de Greenpeace.
Il est permis aussi de s’interroger sur ces juges de Strasbourg. Chacun d’eux est choisi sur une liste de trois présentée par son pays. Tous ne sont pas magistrats, on compte aussi beaucoup de « représentants de la société civile ». Quant à l’ancrage politique et l’expérience démocratique de ces sages, ils laissent pour le moins perplexe à l’heure de la leçon qu’ils dispensent. De l’Azerbaïdjan à la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie à l’Albanie…
Pas étonnant donc que sur le terrain du droit, le jeu est souvent flottant. Ainsi, l’article 8, pivot de la convention permet toutes les interprétations. Il rappelle que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », mais que l’État peut surseoir à ces droits si cela « est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui». Au chapitre de la liberté d’expression, toutes sortes de réserves sont prévues pour la limiter. Quand la sécurité est en cause… et bien sûr la politique sanitaire… là, pas touche !
Les juges ont donc bien tordu le droit pour condamner « le manque d’action climatique ». Porter un jugement sur la politique environnementale d’un pays en se basant sur un tel article, c’est du contorsionnisme. Mais cela ouvre de piquantes perspectives. Des paysans français irrités et appauvris par la concurrence étrangère obtiendront-ils la condamnation des échanges commerciaux ? Les adversaires de tel ou tel chantier autoroutier iront-ils sonner à la porte de Strasbourg ? Une cour de justice qui se laisse porter par les émotions collectives dûment choisies se rabaisse au niveau du cirque. Elle incite ainsi les gouvernements à ignorer ses arrêts même lorsque ceux-ci sont sages. Elle sape les espoirs de voir une arène respectée où l’on veille véritablement sur les droits humains. Bel autogoal.
Enfin ces messieurs-dames posés en maîtres de conscience feraient bien de garder les pieds sur terre. L’entrelacs des lois nécessaires sur la gestion raisonnable des ressources énergétiques, sur la pollution, sur la biodiversité, c’est un défi compliqué. Entre les mains des gouvernements et des parlements, en Suisse, entre celles du peuple aussi. Pas une affaire de vague morale européenne. Les efforts sont indispensables, mais croire qu’un arsenal juridique suffirait à faire souffler le chaud et le froid sur la planète, quelle illusion…
Les climatologues nous rappellent qu’elle a connu des périodes, soient marquées et accélérées, de réchauffements et de refroidissements, dans les derniers siècles, les derniers millénaires, quand usines et bagnoles ne paradaient pas encore… Que les sages autoproclamés fassent donc preuve d’un peu de modestie. Celle qui manqua aux pionniers de l’ère industrielle qui croyaient pouvoir domestiquer la terre de fond en comble.
Les cris de victoire des « Aînées pour le climat » se perdront vite dans le vent. Tout comme les diatribes vengeresses des allergiques à l’Europe. Et chacun des 46 États membres de ce digne Conseil se retrouvera, espérons-le, devant ses responsabilités. Les vraies. Tournant historique, ce dernier arrêt de la CEDH ? Mon oeil.
À lire aussi