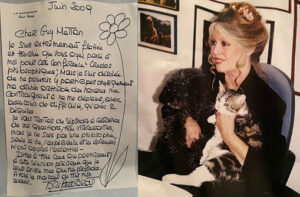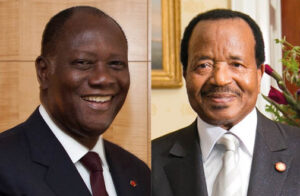Raoul Vaneigem et Guy Debord entrent dans la collection «le bien commun» de Michalon

Portrait de Guy Debord – © Thierry Ehrmann – via Wikimedia Commons
Viennent ainsi de paraître Guy Debord. Abolir le spectacle, d’Emmanuel Roux, déjà auteur d’un ouvrage sur Machiavel, et Raoul Vaneigem. Une politique de la joie, par la directrice de la collection, Adeline Baldacchino.
Raoul Vaneigem, une enfance en pays minier
Retraçant un parcours de vie et donnant une vision d’ensemble de l’œuvre, insistant sur l’intrication très forte qui existe entre les deux, cet ouvrage nous décrit un auteur issu d’un milieu populaire pour qui la politique s’ancre dans le concret, dans le quotidien. Au Borinage, où Vaneigem est né, dans les mines, ils ont des accidents du travail, il y a des grèves importantes, on lui en parle, son père est un anticlérical farouche et c’est par là que cela commence. La conjonction avec la littérature va se faire pendant ses années de lycée et ensuite par la rencontre avec Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Une lecture qui sort de nulle part et qui a été fondatrice aussi pour les surréalistes parce qu’elle casse tous les codes et qu’elle est un manifeste pour la subversion des genres, des formes et de la pensée elle-même.
Le situationnisme
La rencontre avec Guy Debord va se faire par deux intercesseurs inattendus. Vaneigem a écrit à Henri Lefebvre pour lui soumettre l’un de ses textes poético-révolutionnaires. Lefebvre lui répond que son texte lui fait penser à quelqu’un qu’il devrait rencontrer. En même temps, à Bruxelles, un exilé hongrois, Attila Kotányi lui parle aussi de Debord. Vaneigem écrit donc à Debord qui lui répond très vite, et l’invite à venir le rencontrer. Ils seront des égaux intellectuels mais le Tournaisien n’a pas la connaissance qu’a Debord du milieu parisien, des enjeux dans cette histoire longue des rapports entre politique et littérature que Debord, par sa pratique des lettristes et des surréalistes, maitrise parfaitement. Par ailleurs, sa compagne, Michèle Bernstein, l’une des rares femmes ayant laissé une trace dans l’aventure situationniste, va accueillir Vaneigem à bras ouverts.
Debord et lui vont s’allier à l’intérieur de leur mouvement pour en expulser les artistes.
L’idée étant de transformer la vie quotidienne en art, de quitter la représentation pour se situer dans la vie elle-même et d’affirmer que la vie quotidienne est l’unique lieu d’une possible abolition du spectacle.
Ensuite, va se produire dans le mouvement une ossification, apparaître un dogmatisme où on déclare: lui, il a le droit d’en être, et lui pas. Ce n’est pas nouveau. Il y avait déjà cela chez les surréalistes, André Breton ayant été le pape des excommunicateurs. Vaneigem, à cette époque-là, n’est pas un gentil. Son surnom était le Vampire du Borinage. On pouvait l’envoyer à un membre de l’Is pour lui signifier qu’il était exclu.
Le Traité de savoir vivre à l’usage des jeunes générations
Ce qui va porter, en 1967, le Traité vers une grande popularité, c’est que c’est un livre qui est à la fois extrêmement facile à lire, très jubilatoire, plein d’un élan vital et qui donne envie au lecteur de rentrer à son tour dans cette danse de la pensée. Dans ce Traité, on a déjà cette architecture en deux parties qu’on retrouvera ensuite dans la plupart des textes de Vaneigem. D’abord la déconstruction, puis la reconstruction. Vaneigem va y développer un éloge de la générosité, de la gratuité, de la pédagogie et l’idée qu’il faut être attentif à la jouissance et se méfier du sadomasochisme hérité d’une approche religieuse du monde.
Pour lui, l’objectif d’une vie, c’est d’arriver à affiner sa jouissance de l’existence, non seulement pour soi mais avec les autres. Il ne s’y cantonne pas à un anarchisme individualiste mais va vers un anarchisme social. L’accomplissement, pour lui, ne passe pas du tout par le travail. Cela va être un thème récurrent. Il ne refuse pas l’effort. Ce qu’il récuse, c’est le travail au sens où on perdrait sa vie à la gagner. Ce qu’il oppose au travail comme torture, c’est la notion de création de sa vie, de son existence, et d’une œuvre éventuellement. Alors qu’on note chez Debord une aridité théorique, une volonté d’être à la hauteur de Marx et d’Hegel, le style de Vaneigem, ainsi qu’il l’a dit plus tard «s’attachait davantage à l’analyse subjective, aux notions de sacrifice, de vécu et d’authenticité.» Il y a chez lui un côté à la Wilhelm Reich, sur le bunker, la cuirasse caractérielle. Ses références sont Nietzsche, Bakounine, Stirner, Fourier.
L’auteur de 51 ouvrages connus
Le chevalier, le diable, la dame et la mort, son autobiographie intellectuelle, n’exclut pas, par exemple, des mentions relatives à l’alchimie, à l’idée du Grand œuvre, de la transmutation des valeurs à la Nietzsche, du fait que l’on peut passer de la destruction à la reconstruction. Il y accorde une part à l’intuition, aux signes, à la magie, aux pouvoir de la littérature et du mot, à la musique, aux associations d’idées. Ce qui compte, c’est l’instant présent. Il est radicalement opposé à l’idée qu’il faudrait sacrifier des gens en réalisant une révolution sanglante pour créer un monde plus beau.
Ce qu’il explicitera dans L’Adresse aux vivants sur la mort qui les gouverne et les moyens de s’en débarrasser qui paraît en 1990 chez Seghers. C’est un tournant dans l’œuvre et tous les textes qui viendront après commenceront par dire oui, il y a la radicalité, je n’y renonce pas, je n’ai renoncé à rien, simplement, attention aux moyens, cela ne sera pas en excluant, en coupant des têtes. Il va s’intéresser à des projets comme ceux du Chiappas au Mexique, comme ceux du Rojava, cette région du Moyen-Orient entre l’Irak et la Syrie où se construit un projet fédéral d’inspiration libertaire, et qui va l’amener, plus récemment, à se sentir très proche des Gilets Jaunes.
Pour l’auteure de cet essai, Vaneigem est à l’intersection de deux logiques qu’on oppose souvent très radicalement, qui sont, d’un côté, la poésie, et de l’autre, la politique. Il a essayé toute sa vie de réconcilier ces deux pans-là: l’intuition et la raison, et d’accorder à l’imagination une place centrale dans tout projet révolutionnaire.
Conclusion critique
Si Adeline Baldacchino écrit sur Raoul Vaneigem avec une évidente admiration, ce n’est pas sans jugement critique ni lucidité. Pour en juger, il n’y a qu’à lire la conclusion qu’elle donne à son ouvrage:
«On rêverait de lire Vaneigem approfondissant le concept de fédéralisme qu’il évoque parfois. On aimerait le suivre dans un exposé plus attentif des moyens d’accélérer cette transition qu’il imagine presque naturelle entre le « néocapitalisme » récupérant les combats écologistes ou féministes et société de la gratuité et du don qu’il faut bien qualifier de « post capitaliste », puisque l’argent n’y existe même plus. On se demande parfois si la mort et la maladie, la guerre et la méchanceté se volatiliseraient miraculeusement en même temps que les billets de banque. On n’y croit pas toujours mais on sait qu’il sourit avec nous, et que par ce sourire, il s’éloigne de tout fanatisme, tout sectarisme, tout dogmatisme. En fait, on voudrait qu’il nous montre comment passer de l’utopie pure à l’horizon raisonnable, comment courir derrière les arcs-en-ciel sans les voir s’effacer à mesure qu’on en approche, comment transformer une cible inatteignable en un nid douillet pour l’espoir.»
Guy Debord et la dictature absolue du spectacle
Nous épargnant tout détail anecdotique, luttant systématiquement contre la banalisation spectaculaire dont est victime la pensée du situationniste, Abolir le spectacle d’Emmanuel Roux, essai très maitrisé, s’en tient à l’essentiel: l’exposé du cheminement théorique de Guy Debord depuis les détournements de la jeunesse jusqu’au catastrophisme de la fin en passant par la conceptualisation de la société du spectacle. Une description donc de ce régime de séparation généralisée que Debord a appelé le spectacle, ce monde unifié dont on ne peut s’exiler, c’est-à-dire, pour lui, de la destruction de la ville, du vivant, de la falsification de l’alimentation, du recul de la raison collective concomitante au règne de l’expert, de l’impossibilité de toute démocratie. Le spectacle, qui veut être tout y compris sa propre contestation, est passivité, séparation, dépossession. Il est à la fois projet et résultat, occupation totale de la vie sociale, division: le capital a un tel degré d’accumulation qu’il en devient image.
Dans ce petit livre très riche et dense, l’exposé de l’œuvre du grand maître du négatif est parfait. Tout comme l’est son dernier chapitre, Que faire de Guy Debord? C’est un héritage difficile à assumer parce que Debord a mis la barre très haut. Classes et spécialisations, travail et divertissement, marchandises et urbanisme, idéologie et Etat, pour lui, tout était à jeter. «Or, l’ambition peut paraître un peu forcée quand elle fonde sa possibilité pratique sur quelques jours de révolte d’une inspiration conseilliste fugace, voire évanescente», note Emmanuel Roux.
Pour Debord, personne ne peut être à la hauteur de la tâche car chacun est piégé par la part de spectaculaire qu’il a en lui. La fin du spectacle est un absolu inatteignable. Donnant le sentiment d’un catastrophisme croissant, Debord décrit un monde mauvais qui court à sa perte parce qu’il est travaillé de l’intérieur par la non-vie. Le spectacle, portant en lui le déni du vivant à force de falsification, de fausse conscience et d’irrationalité, renforce l’ignorance en revenant à tout instant sur une liste des mêmes vétilles annoncées passionnément comme d’importantes nouvelles. Le spectacle produit un sentiment de lassitude et de résignation. L’échec du spectacle est sa victoire. Il est subi sans adhésion. Personne n’aime ni ne veut le spectacle. Dans un monde où il n’existe plus d’agora, de communautés, d’institutions autonomes, de cafés, de lieux de débat, le flux perpétuel du spectacle emportant raison et vérité, les conditions sont réunies pour que l’individu se place d’emblée au service de l’ordre établi. C’est aussi la première fois qu’en Europe aucun parti n’essaie plus de prétendre qu’il pourrait changer quelque chose d’important. Bref, la révolution a échoué partout et les temps sont à la résignation.

«Raoul Vaneigem. Une politique de la joie», Adeline Baldacchino, Editions Michalon, 128 pages.
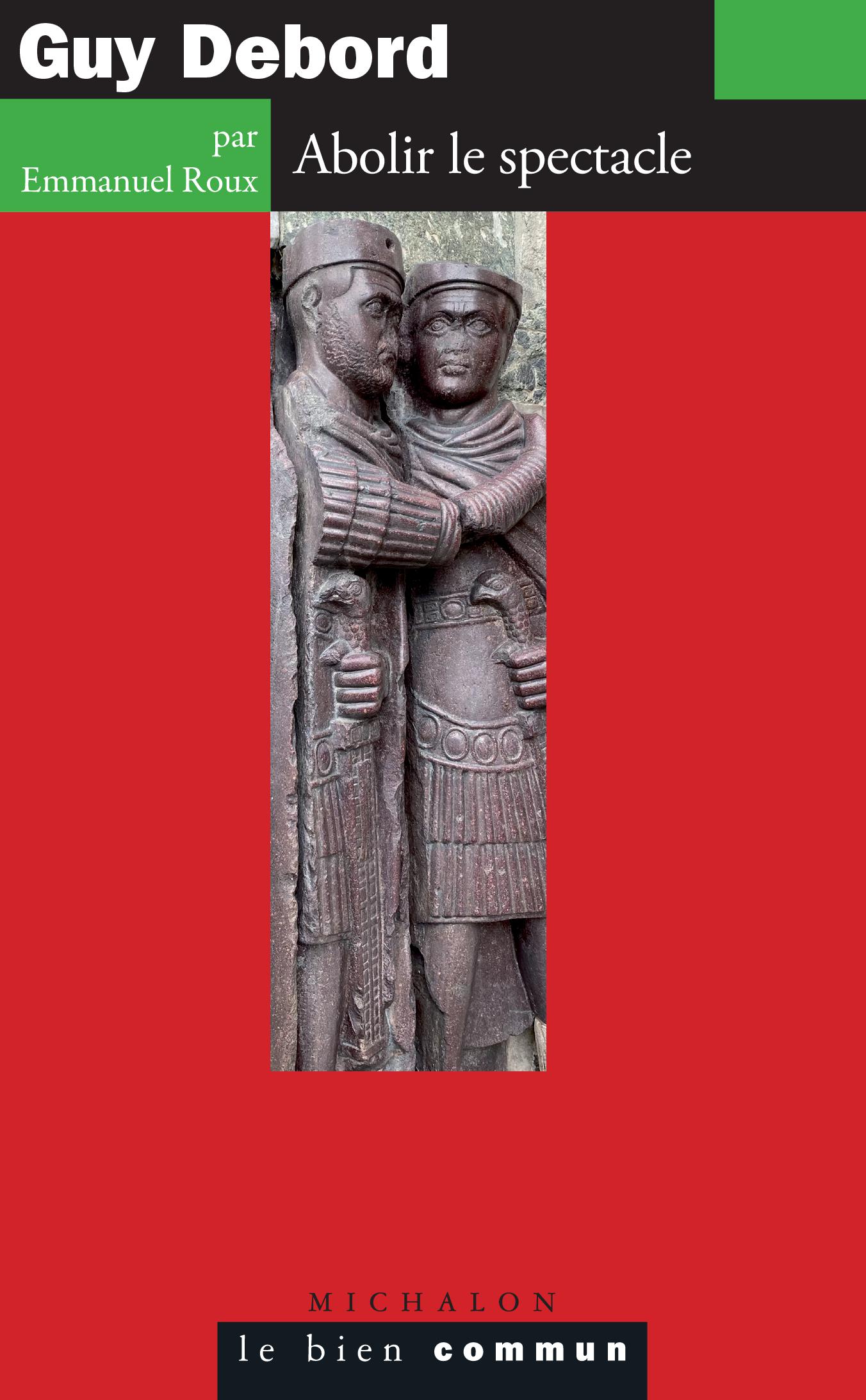
«Guy Debord. Abolir le spectacle», Emmanuel Roux, Editions Michalon, 128 pages.
À lire aussi