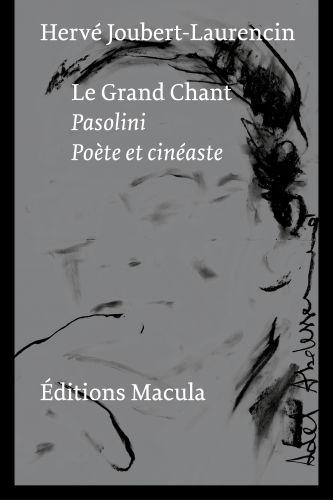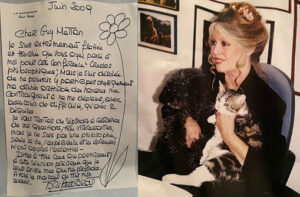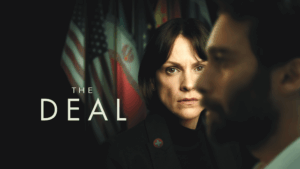Pasolini, poète et cinéaste

Pier Paolo Pasolini devant la tombe de Gramsci. – © DR
De même, et très certainement pour la première fois aussi, sont recensés tous les travaux de statuts très différents que Pasolini a réalisés en tant que scénariste. Ainsi que, bien sûr, tous ses films, d’Accattone à Salò ou les 120 Journées de Sodome.
Oui, dans les années 1960 et 1970, avant le règne sans partage de la grotesque machine télévisuelle et sociétale de l’Italie berlusconienne, nous adorions ce cinéaste et son pays; ce livre est une magnifique occasion de s’y replonger.
Surtout que c’est d’une sensibilité et d’une intelligence folles et que chacun des noms des praticiens et des théoriciens cités ici nous ouvre des paysages infinis. Car quoi de plus jouissif que la prose de Carlo Emilio Gadda, de passionnant que l’histoire de l’art telle qu’elle est pratiquée par Roberto Longhi, ou que la pensée d’Antonio Gramsci, de Franco Fortini et que l’univers de Dante et Boccace? On flotte, on rêve, on pense, on redevient les humbles aspirants érudits que nous étions tout au long des seventies.
Pasolini poète, 1922-1962
«Je suis une force du Passé
A la tradition seule va mon amour.
Je viens des ruines, des églises,
Des retables…»
Fils d’une douce et pure institutrice et d’un brutal militaire alcoolique et anticlérical, éternel premier de la classe, cherchant à se faire aimer de ses maîtres et y arrivant la plupart du temps, Pasolini écrit sa première pièce à quinze ans puis, entre 1939 et 1945, poursuit des études de lettres à l’Université de Bologne où Roberto Longhi est son maitre adulé.
Poesie a Casarsa, écrit en dialecte frioulan, paraît en 1942. En 1945, deux recueils de poésie en italien, chantant les garçons, l’aube, la figure de Narcisse, la poésie comme journal intime.
Son frère Guido qui a rejoint, sur ses conseils, un parti nationaliste, est assassiné le 12 février 1945 par des partisans communistes et cette mort va lui imposer de devoir toujours tout remettre en cause, de tout trahir. Pour commencer en adhérant au PCI. Dorénavant des fantômes prolifèreront dans sa poésie engagée. En 1947-48, Pasolini est donc communiste. Ça ne dure pas. En 1949, inculpé pour corruption de mineurs, il est exclu du parti. Sa carrière est brisée, son désespoir est immense, mais les gens du peuple le soutiennent, les parents des enfants demandent à ce qu’il soit réintégré dans son école. Un jour de 1950, il bat son père à coups de poings et part habiter avec sa mère à Rome, où, après avoir séjourné dans le ghetto du centre, il va vivre en banlieue, dans les borgata. Il publie toujours beaucoup, dans tous les genres, du journalisme à la fiction et le biographe décrit minutieusement et avec passion tous ses ouvrages. En insistant ainsi sur l’étonnant paradoxe de cet artiste le plus moderne, le plus frais, le plus pétillant qui est également le plus pédant, le plus cultivé et celui qui se nourrit aux racines les plus anciennes de la culture médiévale.
Bref, à part le cinéma, tout est tenté par Pasolini dès avant 1949: la poésie en dialecte, l’essayisme, le journalisme, la correspondance littéraire, le théâtre, le journal intime, le roman et le récit bref, le militantisme politique et la littérature engagée, la peinture et le dessin, la direction de revues et les interventions publiques.
Au niveau du style, c’est la fontaine de Narcisse. Pasolini s’observe sans cesse et il éprouve la sensation étrange de se regarder jouir, dans le but de se souvenir de sa jouissance. Ses lettres abondent de définitions de lui-même. Il se dédouble, se détache de son image et il trouve qu’il ressemble de plus en plus à ses lunettes. Du côté politique, l’influence de Gramsci l’amène à un marxisme aérien, gai et paradoxal, antidote au marxisme comme opium du peuple. Il ne sera jamais un penseur hégélien, sa dialectique sera binaire, faite d’oppositions inconciliables, de tensions non résolues, de dimensions tragiques.
En 1960-1962, la nécessité d’un renoncement total à la poésie, comme à quelque chose dont la nécessité s’est perdue, le hante. La société agraire dans laquelle elle était possible n’est plus. Dorénavant, il n’y a plus d’autre poésie possible que celle de l’action directe. En 1962, il lit Walter Benjamin qui lui apprend qu’il n’est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie. Et en visite à Budapest, chez celui qui fut un temps le plus inspiré de tous les penseurs de l’ultragauche, György Lukács, il lui demande, avant de la quitter, le privilège de l’embrasser.
Pasolini cinéaste, 1961-1975
Voilà. Il a 40 ans, a été scénariste pendant dix ans, voyage beaucoup, dort peu, écrit énormément, consacre un tiers de son temps au cinéma, un tiers à l’écriture et un tiers à la vie, au sexe et à la drague nocturne.
Tous ses films, quels que soient leur style, leur format et leur contenu sont mentionnés, décrits et commentés. A commencer par Accattone, Mamma Roma et La ricotta, qui sont des films écrasés par le soleil, brûlés de lumière, menacés par la faim, qui présentent une Rome indienne et africaine et qui se terminent tous les trois par une mort violente et sacrificielle.
La religiosité d’Accattone, par exemple, n’est pas dans son personnage central mais dans la façon de voir le monde. Les hommes y sont des statues de bois vermoulu, de pierres usées. Le cadre y est pictural, toujours frontal et jamais souligné. Nous sommes dans des peintures du Trecento, chez Duccio et Giotto, chez Ghiberti et Pisano, dans une danse médiévale, un carnaval, avec un Accattone qui dort debout comme un vivant déjà mort. Nulle héroïsation néoréaliste ici mais névrose d’échec, infantilisme, inadaptation, masochisme, désancrage violent, compassion tolstoïenne et primitivité barbare avec des voyous inconsistants, veules, des invectives homériques et des supplications dolentes. Tout est tourné en décors naturels. L’image est volontairement granuleuse comme dans des photographies d’actualité, pas de gris, aucune nuance mais un noir/blanc violent obtenu grâce à un filtre orange, filtre qui renforce les contrastes. Les objectifs sont limités à deux longues focales, qui alourdissent la matière, exaltent le relief, le clair-obscur. La musique ne contient que trois thèmes de Bach et les acteurs sont des amateurs à qui il est demandé de ne pas jouer et qui seront postsynchronisés et parfois doublés par la voix d’un autre. Oui, la subtilité appartenant de plein droit à la littérature, le cinéma se doit à la grossièreté qui est son essence même.
En 1962, il y a Mamma Roma, et en 1963, La ricotta, et Il Vangelo secondo Matteo en 1964, film qui suscite une grosse polémique en France. Sartre le défend, et, autre époque, Cournot écrit que c’est de l’art pédé…
Pasolini n’est cinéaste romain que peu de temps, les trois films sont tournés en un an et demi. Ensuite, il va remplacer ces bidonvilles tardifs par la misère du Tiers-Monde. En février 1962, il voyage en Egypte, au Soudan, au Kenya et en Grèce. En janvier 1963, au Yémen, Kenya, Ghana, Nigéria, en Guinée et Palestine et chez lui, le caractère anticolonial n’est pas à chercher dans le militant tiers-mondiste mais dans une prise en considération très lucide et très précise de sa propre position d’italien né dans un pays fasciste et colonialiste et produisant un récit orientaliste.
Il a été un chef de revue, de mouvement en littérature, il ne le sera jamais dans le cinéma.
En 1966, il connaît une brève période heureuse et sort Uccellacci e uccellini qui est un film de jouvence, libre, une œuvre de renouvellement. Dans cette fable politique, le corbeau, c’est le marxisme ancien, et les moineaux, les jeunes barbares qui campent aux portes de la cité.
En 1968, Pasolini se veut très polémique envers le marxisme et le mouvement étudiant. Pour lui, ce ne sont ni le PCI, ni les étudiants qui font la Révolution. Ces derniers étant des fils de bourgeois qui n’aspirent à rien d’autre, dit-il, qu’à une société encore plus hédoniste.
Teorema, sorti en 1968, est son film le plus célèbre. Le narrateur, à la Diderot, s’adresse de manière directe au spectateur. Premier film prenant comme décor la vie bourgeoise, il permet enfin au public de s’identifier aux personnages.
Le Décaméron est à sa sortie, en 1971, la plus grosse réussite commerciale de l’année en Italie ainsi qu’aux Etats-Unis pour un film étranger.
Pour Pasolini, partisan des oppositions bien tranchées et des destins irrévocables, on ne peut accéder à l’art qu’en étant celui par qui le scandale arrive et il va donc tourner en 1975 Salò, film tellement sidérant que Barthes n’y verra qu’une adaptation manquée et Serge Daney, du populisme.
Dans les faits, Pasolini adapte Sade et le cite à la lettre. C’est le sexe à la place de la Révolution d’un Sade d’avant son texte Français encore un effort si vous voulez être républicain et c’est aussi une description de l’Italie de 1975. Le film est masochiste et tourné du point de vue des victimes. Pasolini ne supporte plus l’Italie et il n’a comme alternative que l’exil ou le suicide, sauf s’il s’adapte. L’adaptation est une défaite, et la défaite rend agressif, cruel et même salaud. Pour lui, faire un film lisible, c’est être un salaud et en fait, il avait peu de goût pour Sade dont il jugeait qu’il avait un style «carton-pâte». C’est donc par masochisme qu’il l’adapte, nous suggère l’auteur de notre biographie. Pour nous éclairer et nous empêcher de conclure trop vite, il appelle aussi à la rescousse, par exemple, Ezra Pound, Luis Buñuel, Lévi-Strauss, Portier de nuit et La Grande Bouffe.
Le film sort de façon posthume car Pasolini est assassiné à 53 ans au faîte de sa gloire. Il existe sur cet assassinat trois hypothèses, l’une financière, autour du pétrole, l’autre, politique et la troisième mafieuse.
Un ouvrage d’une grande densité fluide
Hervé Joubert-Laurencin nous offre donc une remarquable monographie sur le poète et le cinéaste ainsi que le récit inspiré d’une splendide expérience vitale. Chroniquant de façon très complète l’œuvre littéraire de Pasolini, son livre nous fait aussi découvrir, à partir d’archives inédites, un travail de scénariste prolifique en très grande partie inconnu et qui prélude à son œuvre de cinéaste. Il dessine ensuite une œuvre cinématographique traversée par la littérature tout autant qu’une œuvre littéraire traversée par le cinéma. Dans l’espoir d’en faire entendre harmonie et disharmonie dans Le Grand Chant du poète et cinéaste Pier Paolo Pasolini.
«Le Grand Chant. Pasolini poète et cinéaste», Hervé Joubert-Laurencin, Editions Macula, 864 pages.
À lire aussi