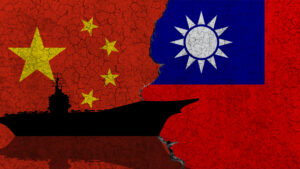Le baril pour moins que rien
Cushing, Oklahoma, où se trouvent les réserves en pétrole des Etats-Unis, aujourd’hui saturées. C’est le symbole de la crise qui a frappé les marchés financiers le 21 avril dernier. – © Wikimedia Commons
Le prix du baril de WTI (West Texas Intermediate), indice utilisé pour fixer les prix du pétrole brut à la bourse de New York, a atteint en quelques heures le 21 avril dernier la valeur de 37,63 dollars… en-dessous de zéro. Un prix négatif, cela signifie que la transaction est renversée, le vendeur paie l’acheteur pour écouler sa marchandise.
Comment en est-on arrivé là?
Par le jeu de l’offre et de la demande, comme toujours. Les mesures sanitaires et le confinement quasi généralisé à toute la planète ont entraîné une chute drastique de la demande en produits pétroliers, aussi bien pour l’industrie que pour la consommation des ménages, et la déstabilisation du marché de l’énergie. Les routes commerciales et les usines sont fermées ou très perturbées, les automobilistes sont confinés: c’est la plus forte chute de la demande en pétrole enregistrée depuis 25 ans.
L’Arabie saoudite et la Russie, respectivement deuxième et troisième producteurs de pétrole mondiaux, ont restreint leur production au moment où l’Italie se confinait, prenant conscience de la casse économique que cela impliquait. Au contraire, les Etats-Unis, premier producteur mondial, se trouvaient depuis quelques temps en situation de surproduction.
Les stocks sont saturés
Le 21 avril, les investisseurs devaient concrétiser leurs commandes en pétrole brut pour le mois de mai, et confirmer les livraisons. Or, impossible, les stocks sont pleins partout. Et en particulier à Cushing, Oklahoma. Le principal site de stockage américain a une capacité de 76 millions de barils. Depuis la fin du mois de février, les quantités entreposées là ont augmenté de 48%.
Pour faire face, le défi a consisté à augmenter la capacité de stockage, en mobilisant des navires pétroliers ou des wagons-citernes. L’administration Trump envisage de financer le bloquage temporaire de certains stocks pour les retirer du marché le temps que les prix remontent et éviter les faillites.
Pourquoi s’engager sur cette pente?
Parce qu’à long terme et à grande échelle, il s’avère moins coûteux d’écouler le pétrole à des prix négatifs que de stopper temporairement la production pour diminuer l’offre, ou de le stocker.
Ensuite, le cours du WTI porte sur de futurs contrats de livraison. Il s’agit de mouvements spéculatifs, pas de véritables échanges physiques. Les traders qui ont massivement revendu sur le marché avaient en fait parié sur le cours du pétrole. Piégés par la dégringolade des prix, ils n’ont eu d’autre choix que de vendre à perte le plus rapidement possible, ce qui entraine par un cercle vicieux une dégringolade plus importante encore.
Et pour les consommateurs?
Il faudra attendre quelques mois pour que les prix du carburant à la pompe répercutent l’effondrement du marché aux Etats Unis, en n’oubliant pas que ce prix est aussi composé des taxes gouvernementales incompressibles et de la marge du revendeur. Si les autres marchés de matières premières pétrolières ont été ébranlés par la situation américaine, celle-ci reste exceptionnelle. On ne nous paiera donc pas pour faire le plein d’essence.
Plus encore, les cours du pétrole vont évidemment remonter, et plus vite ceux-ci remonteront, plus la reprise économique sera rapide et efficace – même si les spécialistes estiment que le marché pétrolier patinera au moins jusqu’en 2021. Se réjouir de cet incident serait méconnaître les mécanismes qui commandent à l’économie mondiale et qui influent jusqu’à notre confort individuel. Le vieux monde n’est pas encore mort.
À lire aussi