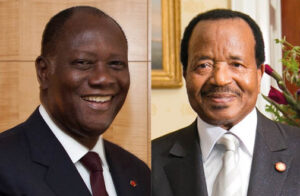L’expansion politique des Eglises évangéliques en Amérique latine

Les églises évangéliques ravissent chaque année des fidèles à l’Eglise catholique, en particulier en Amérique latine, où leur rôle est aussi politique. – © DR
Les mentions de Dieu et de passages de la Bible se sont multipliées dans les discours politiques, de droite ou de gauche. Les évangéliques sont devenus la deuxième religion la plus importante dans la région, et ils traduisent leur force en pouvoir socio-économique et politique.
Pour avoir une idée du degré d’accélération de cette croissance au cours des dernières décennies, on estime qu’en 1910, 94% des Latino-Américains étaient catholiques et seulement 1% environ étaient évangéliques. En 1950, les évangéliques atteignaient 3% et les catholiques restaient à 94%. En 1970, les catholiques ont chuté à 92 % et les évangéliques ont augmenté à 4 % de la population.
On peut donc constater que la grande impulsion de croissance (15%) s’est produite sur une période d’un peu plus de 40 ans, souligne ainsi un rapport du Pew Research Center.
Selon cette institution, en Amérique latine, l’Église catholique perd chaque année des fidèles. Un Latino-Américain sur cinq ayant reçu une éducation catholique se décrit aujourd’hui comme membre d’une église protestante. Cependant, selon cette dernière enquête, les catholiques représentent 69% de la population, tandis que les protestants en représentent 19%.
Les Eglises évangéliques – essentiellement pentecôtistes et néopentecôtistes – ont un programme commun qui inclut le «non» à l’avortement, la lutte contre les droits de la communauté LGBTI+ (à Porto Rico, elles ont promu un projet au Sénat pour appliquer des thérapies de conversion aux mineurs homosexuels et transsexuels que le gouvernement a adopté) et l’accès aux médias.
L’un des pays où ce changement est le plus spectaculaire est le Brésil, où les évangéliques constituent la principale base électorale du président Jair Bolsonaro.
Bolsonaro, qui se vante d’être un «président chrétien dans un pays laïc», a placé la pasteur évangélique Damares Alves au ministère des femmes, de la famille et des droits de l’homme. Alves a lancé des propositions controversées telles que le plan pour éviter les grossesses chez les adolescentes qui fait de l’abstinence sexuelle l’une des principales stratégies.
Mais les évangéliques étaient déjà bien présents avant: avec Luiz Inácio «Lula» Da Silva et dans la réélection de Dilma Rousseff en 2014. Tellement présents qu’ils ont également été décisifs pour la révocation de la présidente en 2016.
Au Mexique…
Les groupes évangéliques, tels que les protestants et les pentecôtistes, ont augmenté de 35 % en un peu moins de 10 ans, passant de 1 331 en 2010 à 5 843 aujourd’hui, selon l’Institut national des statistiques et de la géographie.
La forte tradition laïque du Mexique a été remise en question par le président Andres Manuel Lopez Obrador, qui a déclaré sans équivoque qu’il était un «disciple de Jésus Christ», depuis la campagne présidentielle de 2012. Lopez Obrador s’est allié à Arturo Farela, un ministre évangélique qui dirige une organisation appelée Confraternice, qui regroupe quelque 7 000 Eglises chrétiennes, et qui a annoncé que 10 000 exemplaires de l’Abécédaire moral – un guide des bonnes coutumes avec lequel son gouvernement cherche également à réduire les taux de violence – seraient distribués dans ses temples.
Au Venezuela, les évangéliques sont devenus un élément important du soutien au gouvernement Chavez puis à Maduro. En 2018, le pasteur évangélique Javier Bertucci a gagné en notoriété. Il s’est alors lancé comme candidat à la présidence et son parti, Esperanza por el cambio (Espoir pour le changement), a obtenu plus d’un million de voix, un chiffre historique pour une organisation politique de cette tendance religieuse.
En Uruguay, le Conseil de la représentativité évangélique (Creu) a été fondé en 2004. Il regroupe les Eglises de cette tendance religieuse et représente plus de 700 congrégations locales dans le pays. Selon El País, bien que seulement 7% de la population se définisse comme évangélique, les experts, cités par Latinobarómetro en 2018, s’accordent à dire que ce chiffre sous-estime la réalité.
Au Nicaragua, par l’intermédiaire de la vice-présidente Rosario Murillo, les évangéliques ont réussi à introduire un programme conservateur, mais surtout à devenir le contrepoids de l’Église catholique dans les moments d’usure les plus importants du couple présidentiel.
En Colombie, le catholicisme a perdu 12% de ses paroissiens en moins de 10 ans.
De même, le Chili a connu une baisse du nombre de fidèles catholiques et la montée des évangéliques.
A Porto Rico, on compte 840 000 croyants appartenant au mouvement évangélique sur une population totale de 3 millions.
Une autre des augmentations les plus notables des évangéliques a eu lieu au Salvador, où ils sont passés de 28,70 % des fidèles en 2004 à 39,50 % en 2019.
En Argentine, l’influence évangélique n’est pas encore aussi perceptible, bien que cette mouvance constitue le deuxième groupe religieux le plus important, avec 3 millions 600 000 fidèles sur une population d’environ 40 millions d’habitants.
Ce n’est que le début. «L’Église évangélique commence tout juste à montrer sa tête», prévient Samuel Silva Gotay, professeur d’histoire et de sociologie de la religion à l’Université de Porto Rico.
Lien vers l’article en espagnol.
À lire aussi