Comment les industriels ont fabriqué le mythe du marché libre

Une image du film de propagande «Your Town: A Story of America» (1940). – © DR – Capture d’écran
Article publié sur Infosperber le 10.09.2025, traduit et adapté par Bon pour la tête
En Suisse, les associations patronales invoquent régulièrement la «magie» de l’économie de marché sans entraves. Gastrosuisse, la Swiss Retail Federation et l’Union suisse des arts et métiers ont récemment orchestré une campagne commune contre des interdictions imaginaires de produits populaires. Ces messages reposent sur une idée qui s’est imposée au fil du temps: celle qu’un marché non réglementé incarne la liberté et l’efficacité.
Mais cette représentation n’a rien de naturel. Aux États-Unis surtout, où elle est la plus profondément ancrée, elle est le produit d’une vaste entreprise d’influence. Dans «Le grand mythe: comment le monde des affaires nous a appris à détester l’État et à adorer le libre marché», l’historienne des sciences Naomi Oreskes et son collègue Erik Conway retracent minutieusement l’histoire de ce conditionnement.

L’historienne Naomi Oreskes à l’ETH Zurich en mai 2025. © Collegium Helveticum
Du New Deal à la peur du contrôle étatique
L’origine de cette croisade remonte aux années 1930. Après la crise de 1929, le président Franklin D. Roosevelt déploie le New Deal, un programme de réformes sociales et économiques qui introduit des règles strictes: encadrement du travail des enfants, protection syndicale, régulation financière. Pour une partie du patronat, c’est une menace existentielle.
La puissante National Association of Manufacturers (NAM) décide alors de contre-attaquer. Sous l’influence de figures comme l’ex-président Herbert Hoover, elle affirme qu’une limitation de la liberté économique équivaut à une atteinte à la liberté politique. Ce glissement rhétorique – faire du marché libre un pilier de la démocratie – devient la base de leur stratégie.
Edward Bernays, architecte de la persuasion
Pour diffuser cette idée, la NAM recrute Edward Bernays, pionnier des relations publiques et artisan des campagnes pour l’industrie du tabac. Sa méthode: transformer un intérêt particulier en cause d’intérêt général. Ainsi naît une propagande sophistiquée visant à ancrer dans l’opinion que prospérité, démocratie et liberté économique sont indissociables.
La pièce radiophonique The American Family Robinson illustre ce dispositif. Inspirée du roman suisse Le Robinson suisse de Johann David Wyss, l’histoire met en scène une famille qui triomphe grâce à son initiative privée. Derrière cette fable diffusée par plus de 300 stations de radio, des millions d’Américains entendaient chaque semaine un plaidoyer discret mais efficace pour le marché dérégulé. L’origine patronale du programme n’était jamais mentionnée.
Hollywood et l’école au service du mythe
La campagne ne s’arrête pas aux ondes. Des films de propagande sont produits et diffusés dans les cinémas, souvent avant les longs métrages. Le court-métrage Your Town: A Story of America (1940) exalte un individualisme héroïque et présente l’industrialisation comme le moteur de la grandeur nationale. Distribué aussi dans les écoles et bibliothèques, il se pare d’une aura éducative.
Comme le notent Oreskes et Conway, «toute bonne propagande n’est pas totalement fausse»: le film évoque des réussites bien réelles, mais omet soigneusement les coûts sociaux de l’industrialisation, comme les inégalités et la pollution.
Le film de propagande «Your Town: A Story of America» (1940).
La conquête des universités
Le projet ne vise pas seulement à séduire les masses; il s’attaque aussi au terrain intellectuel. Dans les années 1950, des entrepreneurs financent des chaires pour les économistes austro-britanniques Friedrich von Hayek et Ludwig von Mises, exilés en quête de reconnaissance académique.
Mais là encore, les idées originales sont remodelées. Hayek, dans La Route de la servitude, admettait certaines interventions publiques, notamment contre la pollution ou pour une assurance sociale minimale. Ces nuances disparaissent dans les versions abrégées publiées dans le Reader’s Digest ou en bande dessinée. Résultat: plus de 10 % de la population américaine découvre un Hayek caricatural, chantre absolu du laissez-faire.
Un processus similaire s’opère avec Adam Smith. Dans la réédition populaire de La Richesse des nations (1957), les passages favorables à la régulation bancaire, aux syndicats ou au salaire minimum sont purement supprimés. L’auteur écossais est réduit à un prophète de l’autorégulation des marchés.
Friedman, du manuel à la télévision
Malgré ces efforts, le mouvement manque encore d’une référence moderne et accessible. C’est Milton Friedman qui remplit ce rôle. Son livre Capitalisme et liberté (1962) condense l’argumentaire en une formule séduisante: le capitalisme serait la condition nécessaire de la liberté politique.
Longtemps critiqué par les universitaires, l’ouvrage connaît un succès tardif mais massif dans les années 1980, propulsé par des campagnes de diffusion gratuite auprès des écoles et des étudiants. Parallèlement, Friedman multiplie les chroniques dans la presse et devient le visage médiatique du fondamentalisme de marché.
Le coup de maître reste la série documentaire Free to Choose (Libre de choisir), créée en 1980 et diffusée sur PBS, qui touche des millions de téléspectateurs. Là encore, peu savent que les 2,5 millions de dollars de production proviennent de fondations conservatrices et d’entreprises.
Une idéologie devenue sens commun
Pour Oreskes et Conway, ce succès n’est pas celui d’une théorie économique mais d’une stratégie de communication sans précédent. Des contes radiophoniques aux chaires universitaires, des films hollywoodiens aux manuels scolaires, tout a concouru à transformer une vision partiale en dogme national.
Ce «fondamentalisme de marché», comme ils le nomment, explique la méfiance persistante envers toute régulation publique aux États-Unis. Il éclaire aussi la virulence des campagnes menées contre la science, notamment dans le cas du changement climatique. Comme le résume Oreskes: «Ce n’est pas l’ignorance qui alimente ces attaques, mais une hostilité idéologique délibérément construite.»
Le coût du mythe face à la crise climatique
L’exemple du climat montre aujourd’hui les limites de cette croyance. Le prix des énergies fossiles ne reflète pas leur coût réel: inondations, sécheresses ou maladies liées à la pollution restent invisibles dans les mécanismes du marché.
Oreskes et Conway plaident pour une vision plus lucide: reconnaître ce que les marchés savent faire – stimuler l’innovation, coordonner les échanges – mais aussi ce qu’ils échouent à accomplir sans encadrement public. Selon eux, comprendre l’histoire de cette propagande est une condition préalable à toute réforme: «Nous devons savoir pourquoi nous avons accordé tant de confiance aux marchés si nous voulons les réinscrire dans un cadre démocratique et social.»
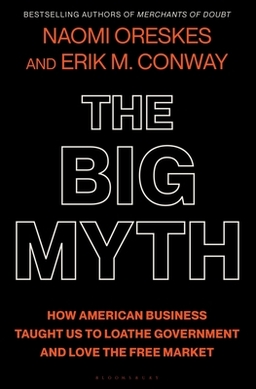
Lire l’article original
À lire aussi















