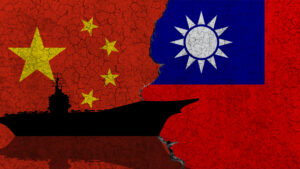L’Europe poignardée

© DR
Pour combler le manque de gaz russe, les Européens doivent trouver d’autres approvisionnements, aléatoires et très chers. Le ministre allemand de l’Economie, fort inquiet, déclare que «quelques pays, dont des amis, pratiquent des prix lunaires (Mondpreise)». Visés notamment, les Etats-Unis qui livrent à grands frais du gaz de schiste liquéfié, leur rêve depuis des années.
Quitte à heurter les dociles suiveurs de la propagande américaine, qui bien sûr incriminent les Russes responsables de tous les maux, alignons quelques faits. A la veille de l’invasion de l’Ukraine, Joe Biden déclarait que dans un tel cas, Nord Stream n’existerait plus. «Nous avons les moyens pour cela», ajoutait-il devant le chancelier Scholz éberlué. La sous-secrétaire d’Etat aux Affaires politiques, Victoria Nuland, a renchéri dans ce sens à plusieurs reprises. Il faut dire que depuis des années, Washington pourfend le projet de ces artères énergétiques. Il n’y a en réalité que deux puissances capables de détruire ces deux gazoducs blindés, à 80-100 mètres de profondeur: les USA et la Russie. Toutes les autres hypothèses paraissent fantaisistes. L’Iran? Il a d’autres soucis. Les sociétés pétrolières auraient engagé des plongeurs? Fariboles. Plus révélateur: les Américains, avec leurs proches alliés polonais, avaient engagé comme par hasard des manœuvres sur la zone avec tout un arsenal voué à la détection des mines englouties dans la mer. Des navires russes rôdaient aussi pas loin.
Logiquement, Poutine n’avait aucun intérêt à détruire ces infrastructures. Le contrôle du robinet, ouvert ou fermé, était une arme politique efficace. On vient de le voir avec une reprise soudaine des livraisons de gaz à l’Italie. En finir une fois pour toutes avec les gazoducs ne lui apporte aucun avantage, restreint ses marges de manœuvre à l’avenir. En revanche, il faut bien admettre que les Etats-Unis avaient de quoi se féliciter de cet attentat qui aboutit à leur vœu maintes fois exprimé.
Tout récemment, Antony Blinken, secrétaire d’Etat, a tenu un point presse à l’occasion d’une rencontre avec la ministre des Affaires étrangères du Canada, Melanie Joly. Le New York Times en a donné le mot-à-mot. Dans un exercice acrobatique, le haut responsable de la diplomatie américaine a rejeté la responsabilité du sabotage, mais s’en est félicité avec insistance: «C’est aussi une opportunité formidable. Une opportunité formidable d’éliminer une fois pour toutes la dépendance à l’énergie russe et ainsi d’enlever à Vladimir Poutine l’arme de l’énergie comme moyen de faire avancer ses projets impériaux. C’est très significatif et cela offre d’énormes opportunités stratégiques pour les années à venir.» Ajoutant, charitable: «Mais pendant ce temps nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour que les conséquences de tout cela ne soient pas supportées par les citoyens de notre pays ou d’ailleurs à travers le monde.» En clair: livrer notre gaz.
Moins aligné sur le récit officiel, le pontet de l’économie, professeur à Columbia University, Jeffrey Sachs, a déclaré sur Bloomberg TV qu’il n’avait aucun doute sur le fait que c’est bien l’armée américaine qui a fait sauter les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Il a souligné que cet évènement allait profondément affecter l’Europe, sur la durée. Car on peut tourner les faits comme on veut, il est certain que les énergies renouvelables ne prendront pas le relai avant longtemps. Et que les nouvelles dépendances, extrêmement coûteuses, poignardent le Vieux Continent. Ses interviewers, fort embarrassés, ont tenté de lui couper la parole. A quoi il a réagi en haussant les épaules, peu surpris par le conformisme des médias.
Un autre connaisseur ne s’y est pas trompé. Mais pour applaudir le coup. L’ex-ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslav Sikorski, époux d’une politologue américaine célèbre, a tweeté peu après le sabotage: «Thank you USA!». Message effacé ensuite quand la doxa anti-russe a repris le dessus. Les Polonais ont en effet de quoi applaudir des deux mains. Depuis le début, ils tempêtent contre ces gazoducs.
Et l’Allemagne, copropriétaire des installations détruites, que dit-elle? Ses dirigeants baragouinent qu’ils vont se joindre aux enquêtes sur l’affaire, après en avoir été écartés, aux côtés de la Suède, de la Norvège et du Danemark. Mais à la marge, la colère commence à s’exprimer. Pas seulement à propos des sabotages. Une part non négligeable de l’opinion allemande estime excessif le prix payé pour ce conflit international localisé, en prolongement d’une guerre civile de plusieurs années. Les dégâts s’annoncent en effet considérables. Parce qu’un grand nombre d’entreprises, petites et grandes, ne seront pas en mesure de payer leurs factures augmentées. Les 200 milliards d’euros promis par le gouvernement pour atténuer le choc ne suffiront pas et cette aide ne sera que temporaire.
Dans le coût d’un produit ou d’un service, une part, plus ou moins importante, est liée à celui de l’énergie. S’il est possible de produire ailleurs moins cher, la tentation de délocaliser est grande. Où? Aux Etats-Unis par exemple! On y ouvre grand les bras aux investisseurs qui se détourneraient de l’Europe. A cela s’ajoute le manque d’autres importations russes, bloquées par les sanctions, notamment des composants azotés, aussi utiles dans l’industrie que dans l’agriculture. Pour parfaire le tableau, un coup de griffe aux exportateurs d’automobiles européens, principalement allemands. Le gouvernement américain subventionne généreusement les acheteurs de véhicules électriques… à condition qu’ils soient fabriqués aux USA, au Canada ou au Mexique. Mercedes, BMW et Volkswagen qui misaient beaucoup sur ce marché se retrouvent Gros-Jean comme devant.
La Commission européenne envisage de «plafonner» les prix du gaz et du pétrole, de toutes origines ou de Russie seulement. Vœu pieux. On ne bouscule pas si facilement les lois du marché. La réponse des Etats du Golfe n’a pas tardé: ils réduisent d’ores et déjà leur production pour maintenir les prix au plus haut.
Les sanctions, la mise au ban de la Russie, les sabotages dits mystérieux plongent l’Europe, plus que partout ailleurs, dans de sévères difficultés à court et à long terme. On peut trouver cette politique justifiée ou irréfléchie, mais on ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité. Le poids économique et politique dans le monde de cette entité – dont la Suisse est de facto partie prenante – s’en trouvera encore un peu plus affaibli.
À lire aussi