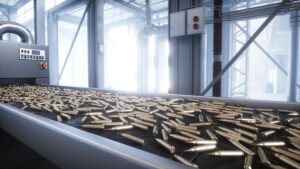Bonnes intentions et mauvaises décisions: comment aider l’Ukraine?
Des volontaires accueillent les réfugiés ukrainiens à la gare de Przemysl (Pologne). – © Pakkin Leung/CC.BY.O4
L’astuce s’est répandue très vite sur les réseaux sociaux la semaine dernière: réservez sur Airbnb un appartement à Kyiv, Kharkiv ou Marioupol, peu importe que l’appartement en question soit toujours debout, et versez ainsi quelques centaines d’euros aux propriétaires sur place ou en exil. La plateforme a même annoncé qu’elle renonçait à prélever ses frais sur les locations en Ukraine. Ce moyen d’«aider» s’ajoute à une longue liste, qui comprenait déjà l’envoi de vêtements, de nourriture, de médicaments aux réfugiés, des collectes ou des ventes de charités lancées par des particuliers, ou encore le volontariat pour aller combattre aux côtés de l’armée ukrainienne.
Plus symboliquement, le boycott de produits russes dans les magasins à l’échelle individuelle, l’exclusion d’artistes ou de sportifs russes à l’échelle des institutions, se pratique aussi massivement depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Mais selon David Comerford, cet excès de zèle, certes bien intentionné, risque souvent au mieux d’être contreproductif, au pire de ne pas tomber dans les bonnes mains.
Les sciences comportementales nous enseignent que, confrontés à une situation de crise, nous avons naturellement tendance à adopter des biais de comportement qui desservent la cause. Le premier, le «biais d’action», nous commande que faire quelque chose est toujours mieux que ne rien faire. Et c’est humain. La guerre nous plonge dans un état d’impuissance vertigineux, nous y remédions comme nous pouvons, et parfois de manière anarchique et inappropriée.
Deuxième biais, la «responsability utility». Comerford explique que le fait d’avoir agi nous donne le sentiment d’être responsable, et nous procure un plaisir égoïste. Même sans nous en vanter, même sans en retirer l’auréole de morale et d’altruisme auprès des autres qui agiraient moins, nous nous trouvons satisfaits, nous nous félicitons intérieurement, d’avoir fait quelque chose. C’est humain aussi, mais il nous revient de nous interroger sur les causes et conséquences de nos actions. Si je m’apprête à faire un geste dont je pourrais faire la publicité auprès de mes proches ou sur mes réseaux sociaux, même dans les meilleures intentions du monde, ne suis-je pas en train de me rassurer avant tout?
La frontière est mince.
Troisième exemple, que nous enseignent les recherches universitaires autour des actions caritatives: le sentiment de «ne pas faire de différence». Des expériences montrent que nous aurions tendance à donner davantage lorsqu’il s’agit de venir en aide à une personne bien identifiée, que lorsqu’il faut secourir un groupe de personnes. En procurant à une personne un nécessaire d’hygiène, des vêtements, un lit et de la nourriture, nous avons la satisfaction d’avoir «réglé le problème». Mais comme il nous est impossible, à l’échelle individuelle, de fournir à des millions de réfugiés et de victimes de guerre suffisamment d’aide, nous donnons un peu au hasard, quelques vêtements, une boite de pansements par-ci, une couverture par-là, sachant bien (et nous en souciant peu, parfois) que ces objets ne feront pas «la différence».
Dans les faits, il est tout à fait possible que ces dons ne fassent effectivement pas de différence. Car il faut se poser et poser aux organisateurs des collectes des questions très pragmatiques, avant de céder à nos pulsions altruistes, même si celles-ci sont honnêtes et pures. Ces dons sont-ils vraiment nécessaires sur place? Seront-ils acheminés jusqu’aux personnes qui en ont besoin? Comment et quand?
En situation de crise humanitaire, la logistique joue le premier rôle. L’approvisionnement des divers produits peut changer drastiquement d’un jour à l’autre. Le passage des frontières, l’accès aux villes assiégées et aux zones de combats est une question cruciale que seuls peuvent résoudre les organismes humanitaires expérimentés, disposant d’un réseau international solide et de relais sur place.
Le propos de David Comerford n’est pas de nous inciter à ne rien faire. Il faut, selon lui, se demander d’abord ce que nous procure, à nous, telle ou telle action et si elle nous semble appropriée pour les victimes; ensuite, nous interroger sur la portée et les conséquences de notre geste. Ce sac de vêtements parviendra-t-il dans l’est de l’Ukraine ou terminera-t-il dans une décharge à ciel ouvert, à la frontière polonaise ou slovaque, faute de moyens d’acheminement? L’argent envoyé aux propriétaires d’appartements sur Airbnb ne serait-il pas plus utile pour secourir celles et ceux qui ne possédaient rien, déjà avant la guerre?
Certes, l’urgence ukrainienne est une urgence morale pour nous, civils, à l’Ouest. Mais dans le doute, le moyen le plus sûr et le plus efficace de se rendre utile, conclut l’expert, est d’envisager des dons d’argent, en euros, en dollars ou même en hryvnias, aux organisations humanitaires au fait des besoins, des contraintes et capables de s’adapter à la réalité très changeante du terrain. Quant à prendre les armes aux côtés des Ukrainiens, mieux vaut laisser cela aux plus entraînés. Mauvais pour notre fil Instagram, mais bon pour les victimes de la guerre.
Lire l’article original.
À lire aussi