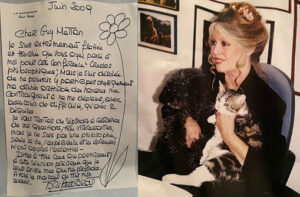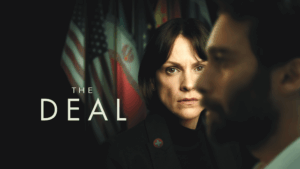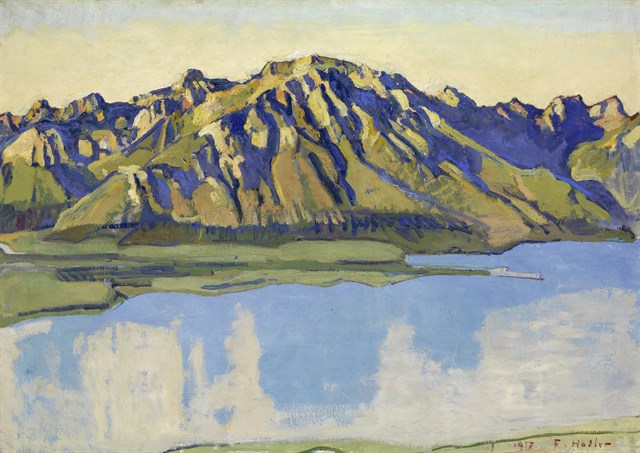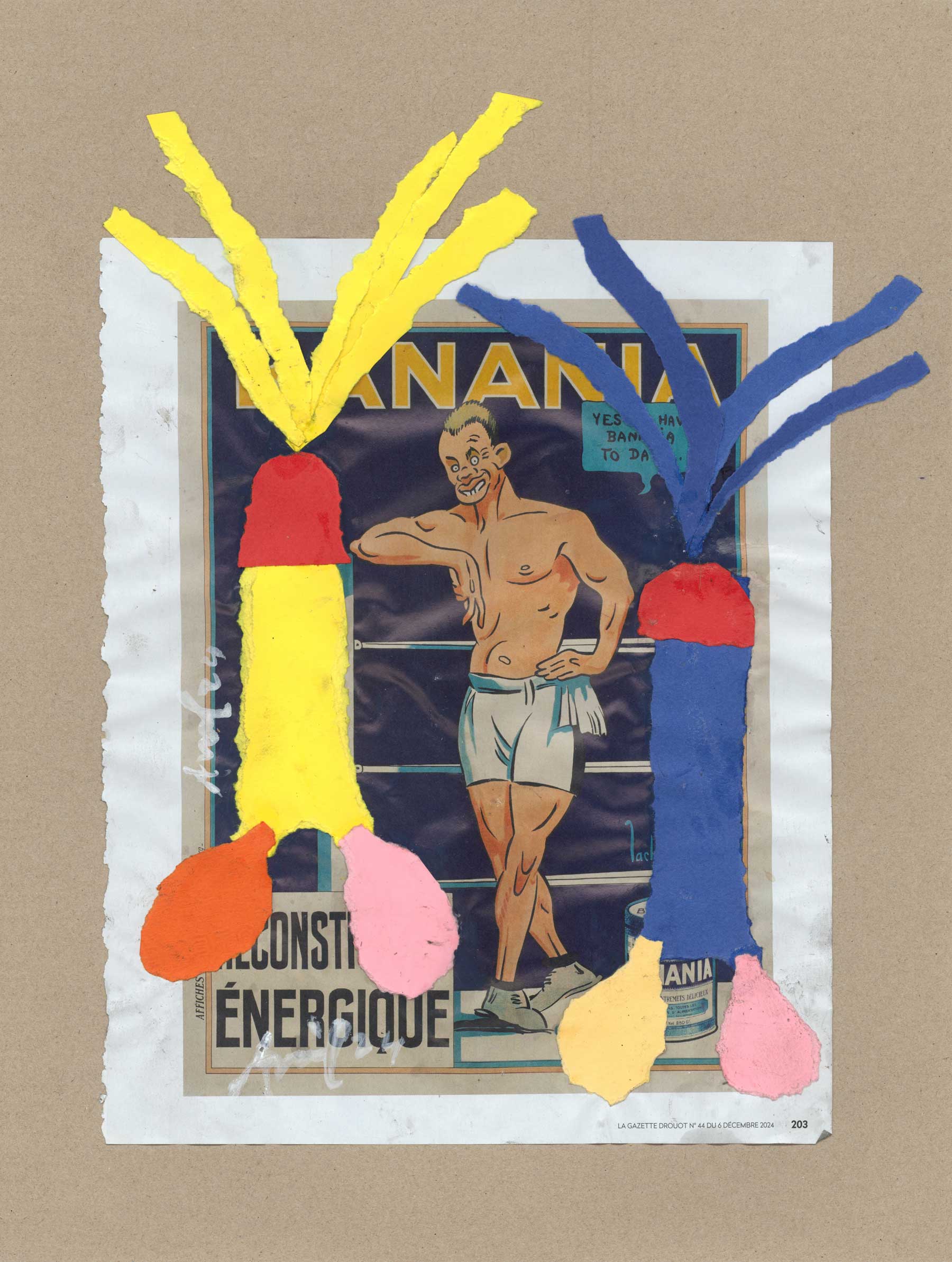Elle et lui, jamais raccords
© Frenetic Films
Jusqu’à son incursion américaine Louder Than Bombs, les premiers films de Joachim Trier, tous coécrits avec son complice Eskil Vogt, questionnaient les paradoxes de l’existence à partir de leurs personnages masculins. Depuis le fantastique Thelma (2017) cependant, le féminin semble en être devenu l’autre enjeu central. Aucun opportunisme dans cette évolution bien dans l’air du temps. Plutôt, la quarantaine venue, le désir d’approcher l’autre côté comme l’ont fait tant de grands cinéastes de l’intime, de Grémillon à Bergman et d’Antonioni à Rohmer. Et ce n’est point trop d’honneur que d’associer le nom de ce nouveau Trier (rien à voir avec Lars) à celui de ces phares du 7e art. Discrètement mais sûrement, le Norvégien est sans doute devenu le cinéaste européen qui sait le mieux traduire nos états d’âme actuels, un peu comme Richard Linklater ou Noah Baumbach outre-Atlantique. D’où l’enchantement qui nous a saisi dès les premières image et paroles (venues d’un narrateur onmiscient) de ce nouveau film.
Introduite en robe de soirée sur une terrasse avec vue sur Oslo, par une belle fin de journée estivale, Julie (Renate Reinsve, jusqu’ici cantonnée à des seconds rôles), 29 ans, fait un bien séduisant mystère. En fait, elle est surtout à un tournant de son existence. Compagne d’Aksel, un auteur de bandes dessinées fêté de quinze ans son aîné (Anders Danielsen Lie, toujours prodigieux de sensibilté), elle va bientôt le quitter pour un autre, sur un coup de tête. Pourquoi donc ce prologue? Pourquoi cette structure romanesque en douze chapitres pour dérouler le récit? Et pourquoi ce titre original (recalé au profit du sous-titre par le distributeur français) qui se traduit par «La pire personne au monde»? Franchement, on n’en sait trop rien, tant ce film restera en partie insaisissable, à l’image de son héroïne. Et c’est parfait ainsi.
Trouver sa voie, puis s’y tenir
Le passé d’étudiante touche-à-tout de Julie, sa rencontre avec Aksel et le début d’une vie de couple travaillée par la question d’avoir ou non des enfants (il en voudrait, elle ne se sent pas prête), tout ceci est expédié en accéléré dès le premier « chapitre ». Où l’on retrouve le jeune auteur de Reprise (2006), si pressé de capter toute la complexité de nos désirs. Puis le rythme va se poser un peu pour raconter les atermoiements de son héroïne, si hésitante à se lancer sur les rails d’une vie adulte. Certes pas jusqu’à se distendre autant que dans le sublime Oslo, 31 août, cet astre noir du cinéma de ce début de millénaire qui rejouait Le Feu follet à travers sa dernière journée d’un ex-drogué et futur suicidé. Non, ce troisième volet d’une sorte de trilogie officieuse reliée par la présence d’Anders Danielsen Lie évolue stylistiquement entre deux, comme pour mieux dire le féminin d’aujourd’hui, écartelé entre tant (trop?) de possibles.
De retour de la réception du début, Julie s’infiltre dans une soirée où elle rencontre un gars de son âge, Eivind (Herbert Nordrum), simple vendeur comme elle et lui aussi engagé dans un relation stable, avec une grande angoissée. Malgré leur décision commune d’éviter les clichés, ils vont bien sûr finir par succomber à leur attirance mutuelle, fondée sur une double insatisfation. On peut toutefois compter sur Trier pour que cela ne ressemble à rien de conventionnel: le moment où Julie se décide enfin donnera ainsi lieu à une séquence poétique assez inoubliable. Mais ce n’est à ce moment que le milieu du film, qui n’en a pas encore fini avec Aksel. Au contraire, c’est lui, avec sa trajectoire d’artiste trahi (sa BD underground devient un grand dessin animé édulcoré) et d’homme blessé livré à la nostalgie (également d’un âge où la culture ne se concevait pas sans supports physiques…), qui devient le coeur d’une mise en abyme aussi inattendue que bouleversante.
Un principe d’incertitude
Entre émancipation féminine et lamento masculin, Trier se refuse à choisir. Cela devient même la tension secrète sur laquelle repose tout ce film, en apparence de plus en plus foutraque. On le croyait féministe? Pas sans accès de misogynie bien sentis! Et de se moquer du politiquement correct à l’occasion d’une séquence d’interview télévisée avant d’offrir à Julie un rêve bien trash pour se libérer d’un paternel indigne. Malgré un goût marqué pour la plus grande netteté d’image et la recherche constante d’une justesse sensible, le style de Trier n’est pas coulé dans le marbre. Au contraire, il se veut ouvert aux inspirations du moment, aux surprises, aux imperfections et aux coups durs de la vie. C’est ainsi qu’on jurerait que l’épilogue, qui retrouve Julie sur un tournage, portant un masque, a été ajouté après l’irruption de la crise du Covid (pour un final pas forcément très convaincant, tant pis).
A Cannes, ce parti pris d’incertitude dialoguait avec celui de Bruno Dumont pour son malheureux France. Mais là où le tiraillement entre satire et conte moral s’avérait fatal au Français devenu brouillon, la tension existentielle entre les âges et les sexes du Norvégien s’avère autrement plus fertile. On sort de là mi-emballé mi-dubitatif, clairement secoué. Julie est-elle belle ou moche, attachante ou énervante, innocente ou coupable? A-t-elle vraiment trouvé sa voie tandis qu’Aksel perdait la sienne? Notre vie est-elle une fête ou une belle saloperie? Le couple une idée condamnée et l’art une maigre consolation? En tous cas, on devine que Joachim Trier et Eskil Vogt se posent toutes ces question le plus honnêtement possible. Et tant pis si le but de leur quête – comprendre le féminin, la complexité des relations humaines, le sens d’une vie – leur échappe partiellement. Tout du long, il y a là des pépites à ramasser, qui peuvent vraiment enrichir l’existence de ceux qui choisiront de se prêter à l’expérience.
«Julie (en 12 chapitres)» («Verdens verste menneske»), de Joachim Trier (Norvège – France – Suède – Danemark, 2021), avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Hans Olav Brenner, Helene Bjørneby, Vidar Sandem. 2h08
À lire aussi