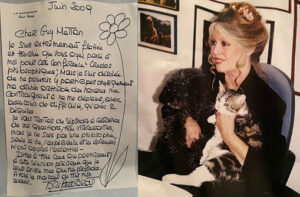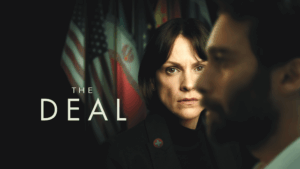Le 7e art à l’heure du ronron des Grands Auteurs
« Showing Up » de Kelly Reichardt. © DIAPHANA
Tout le monde aime Aki Kaurismäki, le Finlandais généreux et déprimé. Au point qu’à Cannes, une presse unanime le propulsait en tête des favoris pour la Palme d’Or avec son nouveau film, Les Feuilles mortes. Encore raté: ce ne fut qu’un modeste Prix du Jury. Pire, on comprend aisément pourquoi en découvrant ce 18ème long-métrage d’une simplicité souveraine mais qui n’amène quasiment plus rien de neuf. Dans le style mesuré qu’on lui connaît depuis toujours, une histoire de violence sociale, d’alcoolisme et de rédemption par l’amour, sur fond de conflit en Ukraine débité à la radio et de citations cinéphiles à gogo. Osera-t-on avouer qu’on n’a pas été vraiment transporté?Pareil pour Le Grand Chariot de Philippe Garrel, chronique de la vie d’artiste dans une troupe familiale de marionnettistes qui se délite, auréolée d’un Prix de la réalisation au Festival de Berlin et vanté toujours par la même frange de la critique. Or, de vagues échos autobiographiques n’en font pas un spectacle plus urgent ni même inspiré, dans un style qui vise l’épure mais frise la paresse. Ici, pas plus de renouvellement en vue, juste un tirage en couleurs plutôt que l’habituel noir et blanc. Quant à Catherine Breillat, autre monomaniaque notoire, elle a surtout bénéficié avec L’Eté dernier d’un retour bien orchestré après dix ans d’absence. Mais le film en lui-même, banale histoire d’un adultère en famille bourgeoise où la cinéaste réaffirme la supériorité des pulsions sur la raison, ne justifie pas vraiment les dithyrambes qui l’ont accueilli.
On pourrait aussi citer Wes Anderson et son Asteroïd City qui n’aura guère amusé que lui-même, Pedro Almodovar et son anecdotique moyen-métrage Strange Way of Life ou même Nanni Moretti et son Il sol dell’avenire essoufflé qui invitait surtout à regarder en arrière. Mais qu’arrive-t-il donc à nos super-auteurs? Simple coup de mou, ou bien le mal est-il plus profond dans un 7e art en pleine mutation? Le public «art et essai» s’éclaircit d’année en année, les plateformes attirent à elles toujours plus de créateurs, une surproduction continue de sévir dans des festivals devenus eux-mêmes pléthoriques et nos grands écrans reflètent de moins en moins le meilleur de la production mondiale. Alors, la critique se rassure en louant systématiquement les mêmes «valeurs sûres». Cette semaine Woody Allen (Coup de chance) et très prochainement Ken Loach (The Old Oak), quels que soient les mérites réels de leurs nouveaux films.
Une érosion de tous côtés
C’est entendu, on est content que ces grands cinéastes puissent encore terminer leur carrière en paix. Car derrière eux, cela devient nettement plus problématique. Aux Etats-Unis, Hollywood a progressivement fait disparaître tout le «cinéma du milieu», ces films à budget moyen qui étaient encore des propositions originales plutôt que des suites ou des «franchises» (l’apparition récente de ce mot dit tout). A côté survit un cinéma indépendant de plus en plus rachitique et à peine distribué. Exit les films de genre classiques, les adaptations littéraires, les commentaires sociaux ou même politiques, les regards d’auteurs singuliers. Seul un Steven Spielberg peut encore s’offrir le luxe d’un film aussi personnel que The Fabelmans et un Christopher Nolan convaincre les financeurs de parier sur l’intérêt d’un Oppenheimer. Tous les autres passent aux séries TV ou alors voient leur films rachetés par des plateformes qui les soustraient au grand écran, quand ils ne se mettent à travailler directement pour elles. Et avec la concurrence impitoyable qui s’est installée, la fenêtre pour des «produits d’appel» ambitieux paraît déjà s’être refermée chez Netflix ou Amazon: place au formatage dicté par les algorithmes.
Côté français, le régime d’exception culturelle (qui soutient à bout de bras l’art et essai mondial par ses co-productions) tient encore, mais tout juste. Son financement obligatoire par les plateformes aussi bien que la TV est désormais acté, mais on tremble quand même à ce que pourrait signifier l’arrivée d’un gouvernement d’extrême droite. Déjà aujourd’hui, nombre de cinéastes sont à la peine, avec des films de moins en moins rentables, bientôt avalés eux aussi par le petit écran. Et ce n’est certes pas mieux dans les autres pays européens, dont on ne reçoit plus guère de nouvelles! Quant au «reste du monde», que peut-on en affirmer? Entre nouveaux modes de visionnement et montée en puissance des dictatures, on ne le sent pas à la fête derrière les rares «films de festivals» qui nous parviennent encore.
En Suisse aussi, on résiste grâce à une solide politique de soutien à l’ensemble de la branche. Mais malgré des réussites aussi prometteuses que Les Particules de Blaise Harrison ou Unrueh de Cyril Schäublin, l’érosion du public en salles est un souci. Jusqu’à quand pourra-t-on justifier de telles dépenses pour si peu de monde? Il y aura bientôt plus de gens pour faire ou plus largement vivre du cinéma que de gens pour le regarder – et on a l’impression de caricaturer à peine. Même la transmission du patrimoine est en panne, avec sa ringardisation décrétée par le «wokisme» et une jeunesse qui préfère se distraire ailleurs, là où c’est moins cher.
Jeunes pousses et vieux sapins
Déclin irréversible du 7e art? Simple dissolution dans un grand bain d’images d’où surnageront toujours les pépites? Allez savoir, mais le problème est assurément plus vaste que le coup de mou d’une poignée d’auteurs révérés. De l’autre côté, on peut se réjouir d’un indéniable gain en diversité, à commencer par les films réalisés par des femmes. Anatomie d’une chute de Justine Triet et la Barbie de Greta Gerwig cartonnent, et cela est parfaitement mérité. Mais ces auteures parviendront-elles à mener des carrières comparables à celles de leurs aînés masculins, voire d’une Agnès Varda?
En attendant, on voit surtout beaucoup de petits films de jeunes cinéastes dont on ne retiendra pas forcément les noms, vu qu’ils tendent à disparaître des radars aussi vite qu’ils sont apparus. Mais tant que surgissent des merveilles telles que The Quiet Girl de l’Irlandais Colm Bairéad, Le Bleu du caftan de la Marocaine Maryam Touzani ou Joyland du Pakistanais Saim Sadiq, on ne va pas trop se plaindre. Et cet automne s’annonce encore riche de noms connus aux titres alléchants, le plus souvent passés par les festivals de Cannes et de Venise.
Entre les sexagénaires David Fincher (The Killer), Hirokazu Kore-Eda (Monster), Alexander Payne (The Holdovers), Todd Haynes (May December), Nuri Bilge Ceylan (Les Herbes sèches), les septuagénaires Robert Guédiguian (Et la fête continue) et Wim Wenders (Anselm et Perfect Days), et les octogénaires Michael Mann (Ferrari), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Hayao Miyazaki (Le Garçon et le héron), Marco Bellocchio (Rapito) et Ridley Scott (Napoléon), cela commence toutefois à sentir le sapin. Circonspection de mise, donc, et gare au réflexe conditionné qui fait claironner au chef-d’œuvre de la semaine. Les vrais, ces films qu’on aura envie de revoir encore et encore, peuvent tout autant surgir d’ailleurs et sont de toute manière beaucoup plus rares. Pire, ils pourraient désormais rester invisibles, comme cela risque d’être le cas pour des candidats aussi sérieux que Cerrar los ojos (Fermer les yeux) de Victor Erice, Master Gardener de Paul Schrader ou Showing Up de Kelly Reichardt. Et bien d’autres encore dont on n’a même plus entendu parler.
À lire aussi