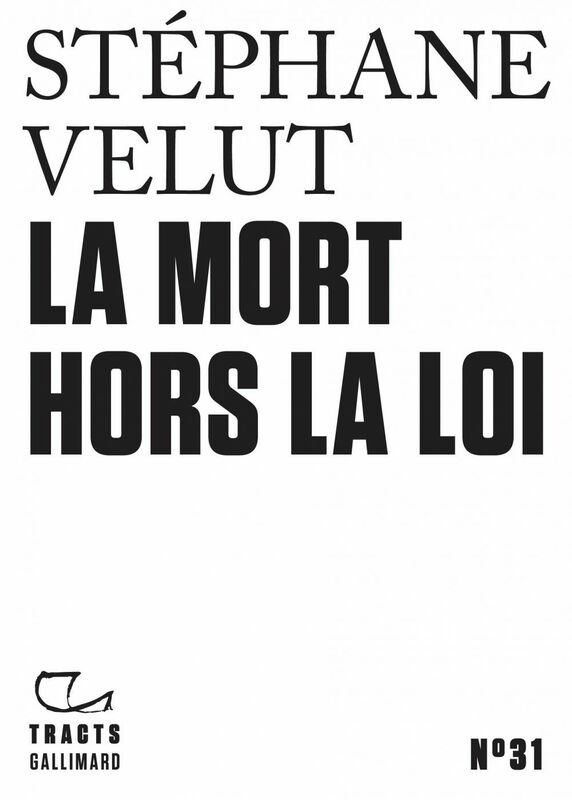La mort à l’épreuve de la loi

© DR
D’où vient que depuis 40 ans, la France ne parvient pas à légiférer sur l’euthanasie? L’avortement et la peine de mort sont désormais des affaires plus ou moins classées, mais «ça» ne l’est pas. Probablement parce que la fin de vie implique de regarder en face la fin de notre vie, l’abstraction, l’abîme subjectif suprême. Comme l’a énoncé La Rochefoucault il y a quatre siècles, «Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement». L’adage est plus que jamais valable en ces temps de scientisme et de classifications à l’extrême.
«Fausse bonne nouvelle»
Stéphane Velut, chef du service de neurochirurgie à l’hôpital de Tours, exerce sur le flanc technique de la question. Son essai s’ouvre sur une expérience vécue en tant que jeune médecin et qui a modelé son approche de la fin de vie, sa conscience aussi des limites à la fois de la médecine et de la loi. Il s’agit d’une enfant de 6 ans, en phase terminale d’un cancer extrêmement douloureux et sans aucun espoir de rémission. Lorsque le père demande aux médecins de «faire quelque chose», c’est l’embarras. Que faire? Il est strictement interdit de «faire ça», c’est-à-dire de mettre fin aux souffrances (et à la vie) de la petite, quelles que soient les raisons, la volonté des parents et les moyens. Le jeune docteur propose une anesthésie générale, pis-aller absurde, impasse éthique comme médicale, car «quand la réveiller, dans ce cas?»…
Les progrès fulgurants de la science et de la médecine vont dans le sens d’une rationalisation, d’une objectivation du corps. Etre malade, développe l’auteur, c’est mettre son corps en réparation. Etre en fin de vie, c’est passer quelque temps dans l’antichambre de la casse. La parcellisation, la codification, la dissection des organes et des pathologies a fait évacuer la notion philosophique de vie au profit de son acception seulement biologique. «La science l’a emporté sur la philosophie: fausse bonne nouvelle».
La peur du gouffre
Ce clivage, poursuit-il, se ressent dans les termes même du débat. Et l’impasse législative dans laquelle se trouve la question de la fin de vie en France ne s’explique pas par la tradition religieuse du pays mais bien plutôt par une mise à distance constante, une objectivation de la vie et de la mort, qui sont par essence particulières et subjectives.
L’expression «fin de vie», pour commencer, qui est entrée dans le langage médiatique et courant, est une manière d’évitement. En éliminant les articles de la locution, on en élimine le subjectif, analyse Stéphane Velut. On dit donc «fin de vie» pour ne pas dire «la fin de la vie», qui pourrait trop rapidement devenir «la fin de ta/ma/votre/notre vie». «Vie» est ici synonyme de «fonctions biologiques» et non plus d’existence. Lorsque l’on parle de «patients en fin de vie», on s’imagine des êtres «hors service», subsistant dans les limbes du lieu-dit «Findevie», dans lequel nous, vivants, ne mettrons jamais les pieds. Nous séparons l’humanité entre vivants et agonisants. Comment, alors, réfléchir à un discours légal sur ces derniers si nous supposons qu’ils ne sont pas nous?
Le mot «bioéthique», employé dans les mêmes circonstances, dissimule le même impensé. De la racine «bio» (la vie), on a progressivement éliminé la vie au sens philosophique, puis la vie humaine tout court, pour forger «biodiversité», «bioéthanol», «biodynamie» ou encore «supermarché bio». On parle de «loi bioéthique», et même un petit effort sémantique pour s’éloigner des carburants et des légumes pour revenir au sens premier du terme ne nous rapproche pas de la vie autrement conçue que comme fonctions organiques.
Le schéma est le même: les mots du législateur permettent d’élever des barricades autour du gouffre de la finitude que nous ne pouvons côtoyer.
Reste, objectera-t-on, le mot d’«euthanasie». Qui est lui aussi un échec d’appréhension, selon Stéphane Velut. Car la mort, même si elle est présente en racine dans ce mot, est absente des textes de loi. Tout au plus parlera-t-on de «décès». Cela recouvre, analyse-t-il, une «hypocrisie fondamentale». En n’envisageant la vie que comme l’ensemble des fonctions organiques, le pouvoir législatif a fini par autoriser, sous certaines strictes conditions, l’arrêt des traitements qui permettent de maintenir ces mêmes fonctions. Mais on n’autorise pas l’euthanasie, «le bien mourir», qui revêt une dimension singulière, subjective, inaccessible à la parole de la loi.
Plus l’on cherche à légiférer, normer et encadrer, plus l’on s’éloigne de ce dont on parle vraiment, plus l’on dissocie le sujet de son corps. Car écrire un texte de loi sur ce sujet revient à écrire l’agonie, tout en conservant une double subjectivité, celle de celui qui la vit et celle de celui qui la voit. Or la langue de la loi ne permet pas la subjectivité. Le législateur doit écrire comme Dieu, en surplombant son sujet. Dans le cas de la mort, dans le cas de l’acte de mettre fin à la vie, le langage de la loi reste muet.
Pourquoi légiférer?
Alors comment sortir de l’impasse? Les débats à l’Assemblée nationale, en septembre dernier, portaient sur une proposition déposée par le député Olivier Falorni (Parti Radical de Gauche) qui prévoyait notamment la validation de la «candidature» à l’aide active à mourir, par une commission de contrôle. Les dispositions de la loi Clayes-Leonetti de 2016 permettent déjà la sédation profonde et continue jusqu’au décès, à condition que le pronostic vital du patient soit engagé à court terme. Ce dernier cadre exclut par exemple les maladies neurodégénératives, les paralysies évolutives, les maladies impliquant des douleurs chroniques allant en s’aggravant.
Quoiqu’il arrive, il y a toujours un vide, une aporie, un écueil et un excès de normes qui étouffe la singularité.
Les opposants à la proposition d’Olivier Falorni dénonçaient non pas le principe mais le risque de dérives: de standardisation des procédures, se substituant à la longue au caractère forcément particulier de chaque cas entrant dans le cadre de la loi. C’est le serpent qui se mord la queue.
L’idée de Stéphane Velut est tout simplement de ne pas légiférer. Ou plutôt, de ne pas légiférer davantage que, par exemple, les Suisses. Les articles 114 et 115 du Code pénal suisse disposent en effet que le meurtre sur demande, même pour abréger des souffrances, et l’aide au suicide apportée pour un «mobile égoïste», sont prohibés. L’euthanasie active est admissible et tolérée, et la jurisprudence de 2010 du Tribunal du district de Boudry (Neuchâtel) tend à autoriser également l’euthanasie active indirecte, lorsqu’une personne est incapable physiquement de pratiquer le geste létal mais en fait la demande explicite et éclairée. Et… c’est tout.
Puisque l’erreur originelle est de penser l’agonie comme un concept juridique, cessons de chercher à traiter par la force l’aphasie du législateur. Stéphane Velut conclut que le degré de civilisation d’une société peut aussi se mesurer à l’amplitude laissée par la loi à la spontanéité de ses membres pour agir et protéger les plus fragiles. Tout discours sur l’agonie étant une glose, ne glosons plus, et agissons.
Stéphane Velut, «La Mort hors la loi», Editions Gallimard («Tracts»), 48 pages.
À lire aussi