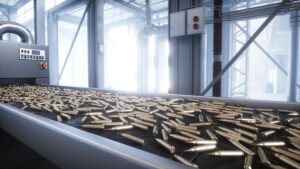«Je ne comprends pas la fascination que la guerre peut exercer sur les gens»

Rony Braumann et Nago Humbert à l’Université de Neuchâtel. – © C.M.
C’était le 16 septembre dernier à l’Université de Neuchâtel, lors d’une conférence intitulée «Décoloniser l’aide humanitaire?», organisée et pilotée par le fondateur de Médecins du Monde Suisse Nago Humbert, sous l’égide de l’Observatoire Ethique et Santé Humanitaire, une association suisse dont il est le responsable, avec pour objectif de «nourrir une réflexion critique sur l’action humanitaire».
Nago Humbert, qui, comme Pierre Krähenbühl ou Rony Braumann, également présent à Neuchâtel, totalise plusieurs décennies d’expérience dans le secteur de l’humanitaire, était il y a quelques mois à Kinshasa en République démocratique du Congo, pour plancher sur un projet de création d’un organe qui coordonne l’aide octroyée à ce pays. Un projet qui a suscité une levée de boucliers de la part des organisations humanitaires sur place, qui souhaitent rester libres de leurs actions sur le terrain, tout en brandissant les risques de détournement de fonds. «Imaginons si des équipes venues de Kinshasa débarquaient à Neuchâtel pour nous aider, sans autorisation, nous serions choqués», commente-t-il avec l’humour qui le caractérise, tout en rappelant que, d’une manière générale, il est malvenu de critiquer l’action des organisations d’aide humanitaire, car «on ne critique pas celles et ceux qui font le bien».
Instrumentalisation de l’aide?
Et pourtant. Nago Humbert a évoqué la manière dont les bailleurs de fonds choisissent les victimes qu’ils vont aider, en fonction de leurs propres intérêts ou du buzz médiatique qui accompagne une guerre ou une catastrophe. «Les plus grands succès de la Chaîne du Bonheur sont le tsunami en Thaïlande et la guerre en Ukraine», rappelle-t-il. Tout en soulignant que parfois, l’aide humanitaire peut se révéler «toxique», et se substituer aux responsabilités politiques des Etats. «Il est convenu de vitupérer contre l’instrumentalisation de l’aide humanitaire, mais s’il n’y a pas d’instrumentalisation, il n’y a pas d’action sur le terrain» a réagi Rony Braumann, actuel directeur d’études à la Fondation Médecins sans Frontières (MSF). C’est que selon lui, «ce qui fait qu’on est accepté ou non dans un pays, c’est l’intérêt que nous représentons pour les autorités du pays où nous intervenons». Si un mouvement de guérilla ou un gouvernement accepte qu’une organisation humanitaire intervienne sur son territoire, c’est parce qu’elle leur est utile. «Nous sommes instrumentalisés dès la signature d’un accord nous autorisant à intervenir, relève-t-il, ce n’est pas à déplorer, juste une vision réaliste».
Neutralité et jugement
Rony Braumann, qui demeure une véritable référence en matière de réflexion sur l’aide humanitaire, pourfend également le principe de neutralité «paralysant et stupide». Et selon lui «ridicule» au vu des prises de position de MSF. «Lorsque nous dénonçons les conditions dans lesquelles les demandeurs d’asile sont traités, on ne peut plus parler de neutralité, estime-t-il; et si MSF refusait de sauver des migrants en mer, l’organisation ne pourrait pas être qualifiée d’humanitaire». Ce principe de neutralité est toutefois à la base de l’action du CICR. Pierre Krähenbühl le revendique totalement. Tout comme l’importance d’éviter de laisser transparaître tout jugement, lorsque par exemple, il avait eu l’occasion de dialoguer avec un directeur d’une prison où la torture était largement pratiquée. «En sortant de cette prison, mon premier réflexe aurait été de dénoncer ce que j’avais vu, mais l’objectif était de revenir, d’avoir accès aux prisonniers; et selon ce que vous dites, vous ne reviendrez plus». Il a également plaidé pour une certaine modestie dans le jugement qu’on peut porter. «Si un conflit avait lieu dans mon pays, qui aurais-je été? Nous pensons pouvoir répondre à cette question, mais la guerre nous broie, et face à la guerre, personne ne peut dire comment il se serait comporté».
Logique du soupçon
Chacun des orateurs présents à Neuchâtel a évoqué une forme de «racisme» au sein des organisations humanitaires, dont le financement et les hiérarchies demeurent largement en «mains occidentales». C’est pourquoi au terme de «décolonisation» d’une aide humanitaire, le sociologue et professeur à l’Université de Bouaké en Côte d’Ivoire Francis Akindes préfère le terme de «désoccidentalisation». Ses enquêtes sur le terrain font ressortir la frustration des collaborateurs et collaboratrices locaux, dont la rémunération, à compétences égales, est systématiquement inférieure à celle des «expatriés» occidentaux. «Nous sommes dans une logique du soupçon: les organisations locales soupçonnent les organisations internationales de vouloir les rendre dépendantes pour pérenniser leur présence, et de ne pas vouloir les former pour éviter de signer ainsi leur inutilité», a-t-il conclu.
À lire aussi