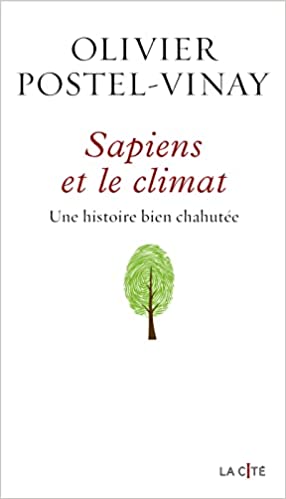Climat: le piège de la courte vue

Le port de Lindau, sur le lac de Constance, en hiver 1962-1963. – © DR
Quelques leçons à retenir de ces 350 pages très denses. Du fond des âges jusqu’à aujourd’hui, le climat n’a pas cessé de connaître des bouleversements, pas les mêmes, pas simultanément, tout autour de la planète, parfois sur des temps longs et parfois très courts, souvent avec une violence que l’on n’imagine pas. Les paléoclimatologues qui tentent de tracer cette histoire mouvementée ont fait des progrès considérables ces vingt dernières années. Par l’analyse des végétaux, de leurs restes enfouis, des ossements anciens, par les découvertes archéologiques, la technologie moderne permet de dater des périodes de chaleur et de refroidissement, de sécheresses et d’inondations, au fil de centaines de milliers d’années, des siècles, des décennies plus récentes. Tout cela est raconté avec concision et clarté.
L’auteur est aussi fasciné par les effets que ces bouleversements ont provoqués chez les humains. Sur les errances de l’homo sapiens parti d’Afrique, sur les peuples qui ont si souvent fui devant les malédictions du climat, qui se sont sans cesse adaptés aux circonstances non sans perdre des pans entiers de leurs sociétés. En Europe comme en Afrique, en Asie, comme en Chine par exemple dont tout le destin, les empires successifs, ont été chahutés à plusieurs reprises par les faveurs et les défaveurs du ciel. En fait cet ouvrage historique décrit les parcours, fort divers, de l’humanité dans son combat pour la survie, face à la famine et à la maladie, avec ses inventions, ses peurs et ses élans, avec les pulsions spirituelles qui accompagnaient et accompagnent encore ces changements.
L’invitation suggérée est claire. Cesser de s’obnubiler sur des variations de températures, actuellement minimes au regard d’autres, même récentes, beaucoup plus marquées. Refuser le «présentisme», lever le nez du guidon. Considérer ce qui nous arrive avec un peu de recul temporel et la prise en compte des nouvelles connaissances.
Rappeler qu’une grande partie de l’Europe a connu des périodes si sèches qu’elle n’était plus guère qu’une vaste toundra et devenait ensuite, au fil des siècles, si bien arrosée qu’elle se couvrait de forêts, c’est surprenant mais il est facile de se dire «tout cela est si ancien que cela n’a rien à voir avec aujourd’hui». Alors tournons-nous vers le XXème siècle. Souvenons-nous des Raisins de la colère (1939) de John Steinbeck qui évoque la tragédie de ces millions d’Américains amenés à fuir, dans les années 30, une effroyable sécheresse et un tsunami de poussière (le Dust Bowl). 49 degrés dans l’Oklahoma et le Kansas en 1936, record non battu. En Europe de l’Ouest, après le réchauffement des années 1920-1940, «un nouveau refroidissement s’installe, particulièrement sensible – au point qu’une bonne partie de la communauté scientifique sonne le tocsin: notre ère interglaciaire s’achève, un nouvel âge glaciaire arrive!» Les alarmes partent alors dans tous les sens. En 1968, un professeur de biologie de Stanford vend deux millions d’exemplaires de son livre La Bombe P (P pour population) où il prévoit que dans les années 70 «des centaines de millions de gens mourront de faim». En 1974, le Club de Rome lance la phrase qui fait florès aujourd’hui: «Le monde a un cancer et ce cancer c’est l’homme.» En 1972, un colloque se tient à Rhode Island, avec une large brochette de climatologues internationaux. La plupart tombent d’accord – pas tous il est vrai – sur le fait que «l’on doit s’attendre à un refroidissement global». Impressionnés par l’hiver 1962-1963, où l’on a vu le lac de Constance ou le bassin d’Arcachon «pris par les glaces». La presse américaine glosait abondamment sur le «global cooling». La suite des évènements a fait oublier ces thèses.
Le réchauffement actuel est-il dû aux émissions massives de CO2? Postel-Vinay l’avoue: il n’en sait rien. C’est possible, pour une part minime ou considérable, peut-être déterminante. Mais il est vraisemblable que d’autres facteurs interviennent de surcroît. Comme l’axe de la rotation terrestre ou les variations solaires. L’univers est sans cesse en mouvement. Et il reste encore beaucoup d’incertitudes à cet égard. Les proclamations catégoriques du GIEC impressionnent peu l’auteur: quand les scientifiques se font tribuns, tournant le dos à la nécessité du doute, ils se sont si souvent trompés. Constat qui ne contredit nullement la nécessité de limiter notre consommation d’hydrocarbures et de développer des modes plus raisonnables de production énergétique.
Après de longues années d’étude du sujet, l’auteur refuse l’affolement. Il ose dire qu’«au regard des crises climatiques auxquelles Sapiens puis l’homme moderne ont été confrontés, nous vivons aujourd’hui un optimum… une époque particulièrement privilégiée». Avec trois nouveautés cependant. Les pays riches peuvent mieux que jamais «lisser» les effets des «microcrises» actuelles. Il est vrai aussi que jamais les gaz à effets de serre n’ont atteint un tel niveau. Enfin, pour Postel-Vinay, «nous vivons une crise climatique réellement sans précédent, en ce qu’elle se fonde non pas sur des événements concrets entraînés par un changement catastrophique, mais sur l’inquiétude générée par des scénarios élaborés par des spécialistes sur une crise à venir… Sapiens vit une crise climatique par anticipation.»
Ces considérations choqueront. Car les opinions publiques, traumatisées par les discours des scientifiques prétendument unanimes et les médias qui les répercutent et les simplifient, sont pénétrées par la dimension tragique du phénomène. Le posant entre les pôles du Bien et du Mal. Dans une perception à tournure religieuse. Comme ce fut le cas à toutes les époques quand les peuples affrontaient les chaos climatiques en invoquant les divinités. Les Valaisans de Fiesch n’imploraient-ils pas le pape en 1786 de freiner l’avance du glacier par la prière? C’est en 2010 qu’ils lui ont écrit à nouveau pour lui demander d’inverser la demande.
Puisque nous prenons par ces lignes le risque de heurter, cela dans le souci d’élargir la réflexion, concluons avec le coup de gueule du romancier américano-suisse Jon Ferguson (publié dans 24 Heures du 27 avril). Olivier Postel-Vinay tient un propos à peu près semblable dans les interviews qu’il a accordées à la sortie de son livre en décembre dernier.
«Dernièrement avant de me coucher, j’ai consulté mes courriels. Il y avait un message d’une amie rencontrée récemment, une personne qui m’avait semblé charmante et intelligente. Elle me racontait qu’elle avait « marché pour le climat » de Pully à Puidoux. Je ne lui ai pas répondu personnellement. Aujourd’hui, au risque de perdre son amitié (et beaucoup d’autres), je vais lui répondre publiquement – à elle et aux millions de personnes dans le monde qui disent qu’elles « marchent pour le climat », c’est-à-dire, « vous ne marchez pas pour le climat, vous marchez pour vous-mêmes ». Je dis cela pour plusieurs raisons. La première est que je crois que personne ne sait ce qu’est « le climat ». Le climat n’est pas une chose, identifiable et finie. C’est un « flux » complexe de « matière » qui change constamment et qui est infiniment compliqué. Quiconque prétend connaître ou comprendre « le climat » est, à mon avis, un imposteur. Bien sûr, des millions – voire des milliards – de personnes dans le monde parlent aujourd’hui du « climat » comme si elles « savaient » de quoi elles parlent. Je pense que personne ne le sait. Je n’essaie pas d’être dérangeant ou de faire le malin. J’essaie simplement d’être honnête. Pendant près de 2000 ans, l’Occident a cru que Dieu avait créé le monde, que Jésus était né d’une mère vierge et était mort pour nous sauver de nos péchés, que le paradis et l’enfer attendaient les morts ressuscités… Les gens qui ne croyaient pas en ces choses étaient ridiculisés, ostracisés, torturés, emprisonnés et même massacrés… Aujourd’hui, j’ose le dire, nous avons remplacé Jésus sur la croix par l’ours polaire sur l’iceberg en train de fondre. Et nous avons remplacé « sauver nos âmes » par « sauver la planète ». (…) Je ne suis pas le seul à le penser. Cependant, étant donné la nature du troupeau humain, les personnes qui ne croyaient pas au « christianisme » ont été réduites au silence pendant près de deux millénaires. Aujourd’hui, les personnes qui osent douter de ce qu’il est convenu d’appeler le « changement climatique » sont bâillonnées, ostracisées et censurées de la même manière.»
«Sapiens et le climat. Une histoire bien chahutée», Olivier Postel Vinay, Editions La Cité, 350 pages.
À lire aussi